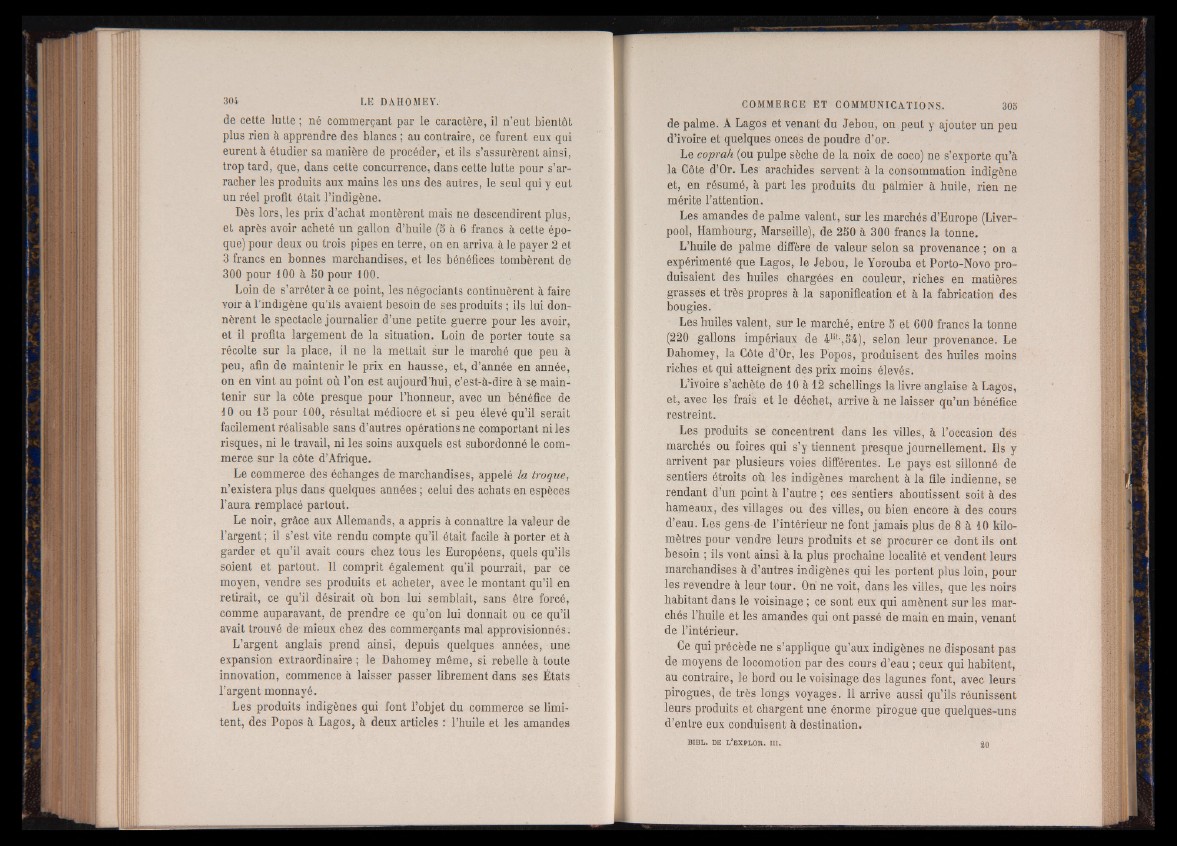
de cette lutte ; né commerçant par le caractère, il n’eut bientôt
plus rien à apprendre des blancs ; au contraire, ce furent eux qui
eurent à étudier sa manière de procéder, et ils s’assurèrent ainsi,
trop tard, que, dans cette concurrence, dans cette lutte pour s’arracher
les produits aux mains les uns des autres, le seul qui y eut
un réel profit était l’indigène.
Dès lors, les prix d’achat montèrent mais ne descendirent plus,
et après avoir acheté un gallon d’huile (S à 6 francs à cette époque)
pour deux ou trois pipes en terre, on en arriva à le payer 2 et
3 francs en bonnes marchandises, et les bénéfices tombèrent de
300 pour 100 à 50 pour 100.
Loin de s’arrêter à ce point, les négociants continuèrent à faire
voir à l’indigène qu’ils avaient besoin de ses produits ; ils lui donnèrent
le spectacle journalier d’une petite guerre pour les avoir,
et il profita largement de la situation. Loin de porter toute sa
récolte sur la place, il ne la mettait sur le xnarché que peu à
peu, afin de maintenir le prix en hausse, et, d’année en année,
on en vint au point où l’on est aujourd’hui, c’est-à-dire à se maintenir
sur la côte presque pour l’honneur, avec un bénéfice de
10 ou 15 pour 100, résultat médiocre et si peu élevé qu’il serait
facilement réalisable sans d’autres opérations ne comportant ni les
risques, ni le travail, ni les soins auxquels est subordonné le commerce
sur la côte d’Afrique.
Le commerce des échanges de marchandises, appelé la troque,
n’existera plus dans quelques années ; celui des achats en espèces
l’aura remplacé partout.
Le noir, grâce aux Allemands, a appris à connaître la valeur de
l’argent ; il s’est vite rendu compte qu’il était facile à porter et à
garder et qu’il avait cours chez tous les Européens, quels qu’ils
soient et partout. Il comprit également qu’il pourrait, par ce
moyen, vendre ses produits et acheter, avec le montant qu’il en
retirait, ce qu’il désirait où bon lui semblait, sans être forcé,
comme auparavant, de prendre ce qu’on lui donnait ou ce qu’il
avait trouvé de mieux chez des commerçants mal approvisionnés ;
L’argent anglais prend ainsi, depuis quelques années, une
expansion extraordinaire ; le Dahomey même, si rebelle à toute
innovation, commence à laisser passer librement dans ses États
l’argent monnayé.
Les produits indigènes qui font l’objet du commerce se limitent,
des Popos à Lagos, à deux articles : l’huile et les amandes
de palme. A Lagos et venant du Jebou, on peut y ajouter un peu
d’ivoire et quelques onces de poudre d’or.
Le coprah (ou pulpe sèche de la noix de coco) ne s’exporte qu’à
la Côte d’Or. Les arachides servent à la consommation indigène
et, en résumé, à part les produits du palmier à huile, rien ne
mérite l’attention.
Les amandes de palme valent, sur les marchés d’Europe (Liver-
pool, Hambourg, Marseille), de 250 à 300 francs la tonne.
L’huile de palme diffère de valeur selon sa provenance ; on a
expérimenté que Lagos, le Jebou, le Yorouba et Porto-Novo produisaient
des huiles chargées en couleur, riches en matières
grasses et très propres à la saponification et à la fabrication des
bougies.
Les huiles valent, sur le marché, entre 5 et 600 francs la tonne
(220 gallons impériaux de A1“-,54), selon leur provenance. Le
Dahomey, la Côte d’Or, les Popos, produisent des huiles moins
riches et qui atteignent des prix moins élevés.
L’ivoire s’achète de 10 à 12 schellings la livre anglaise à Lagos,
et, avec les frais et le déchet, arrive à ne laisser qu’un bénéfice
restreint.
Les produits se concentrent dans les villes, à l’occasion des
marchés ou foires qui s’y tiennent presque journellement. Ils y
arrivent par plusieurs voies différentes. Le pays est sillonné de
sentiers étroits où les indigènes marchent à la file indienne, se
rendant d’un point à l’autre ; ces sentiers aboutissent soit à des
hameaux, des villages ou des villes, ou bien encore à des cours
d’eau. Les gens de l’intérieur ne font jamais plus de 8 à 10 kilomètres
pour vendre leurs produits et se procurer ce dont ils ont
besoin ; ils vont ainsi à la plus prochaine localité et, vendent leurs
marchandises à d’autres indigènes qui les portent plus loin, pour
les revendre à leur tour. Oh ne voit, dans les villes, que les noirs
habitant dans le voisinage ; ce sont eux qui amènent sur les marchés
l’huile et les amandes qui ont passé de main en main, venant
de l’intérieur.
Ce qui précède ne s’applique qu’aux indigènes ne disposant pas
de moyens de locomotion par des cours d’eau ; ceux qui habitent,
au contraire, le bord ou le voisinage des lagunes font, avec leurs
pirogues, de très longs voyages. 11 arrive aussi qu’ils réunissent
leurs produits et chargent une énorme pirogue que quelques-uns
d’entre eux conduisent à destination.