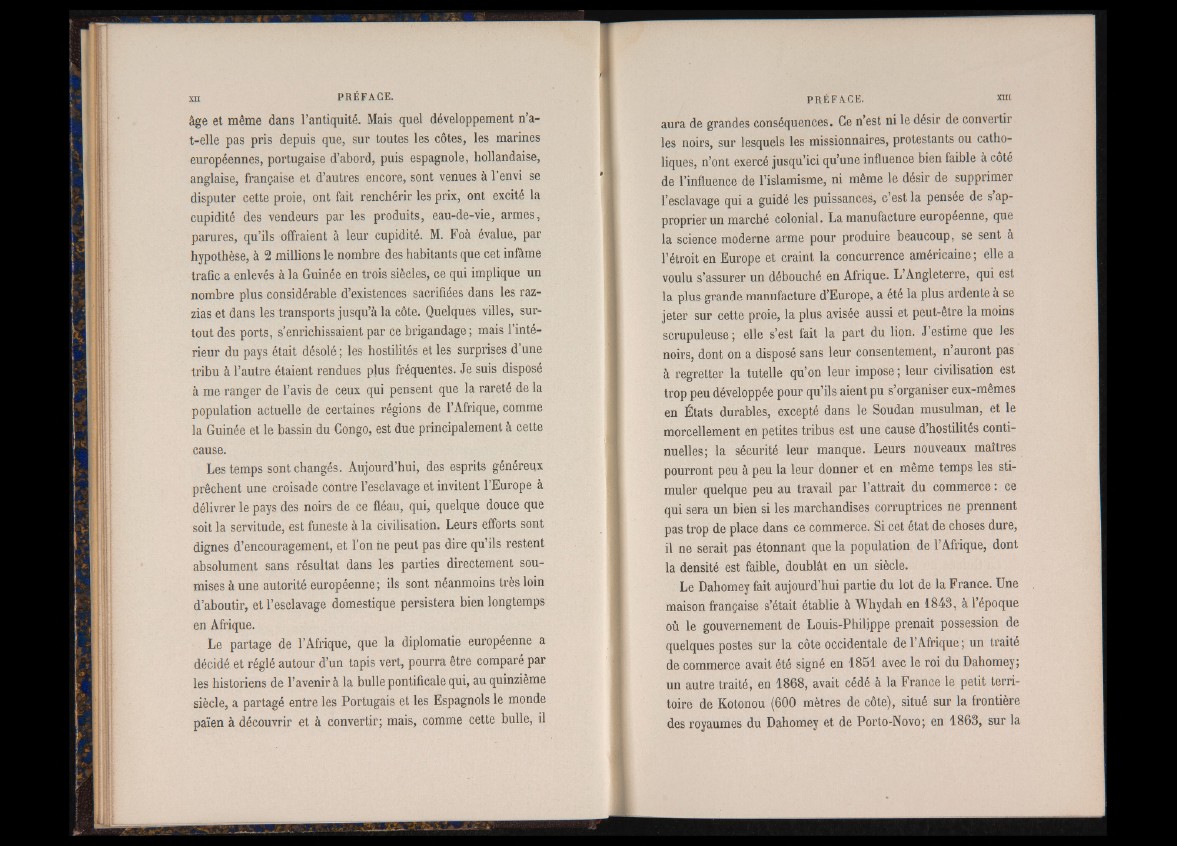
XII PRÉFACE.
âge et même dans l’antiquité. Mais quel développement n’a-
t-elle pas pris depuis que, sur toutes les côtes, les marines
européennes, portugaise d’abord, puis espagnole, hollandaise,
anglaise, française et d’autres encore, sont venues à l’envi se
disputer cette proie, ont fait renchérir les prix, ont excité la
cupidité des vendeurs par les produits, eau-de-vie, armes,
parures, qu’ils offraient à leur cupidité. M. Foà évalue, par
hypothèse, à 2 millions le nombre des habitants que cet infâme
trafic a enlevés à la Guinée en trois siècles, ce qui implique un
nombre plus considérable d’existences sacrifiées dans les razzias
et dans les transports jusqu’à la côte. Quelques villes, surtout
des ports, s’enrichissaient par ce brigandage; mais l’intérieur
du pays était désolé ; les hostilités et les surprises d une
tribu à l’autre étaient rendues plus fréquentes. Je suis disposé
à me ranger de l’avis de ceux qui pensent que la rareté de la
population actuelle de certaines régions de l’Afrique, comme
la Guinée et le bassin du Congo, est due principalement à cette
cause.
Les temps sont changés. Aujourd’hui, des esprits généreux
prêchent une croisade contre l’esclavage et invitent l ’Europe à
délivrer le pays des noirs de ce fléau, qui, quelque douce que
soit la servitude, est funeste à la civilisation. Leurs efforts sont
dignes d’encouragement, et l’on iie peut pas dire qu’ils restent
absolument sans résultat dans les parties directement soumises
à une autorité européenne; ils sont néanmoins très loin
d’aboutir, et l’esclavage domestique persistera bien longtemps
en Afrique.
Le partage de l’Afrique, que la diplomatie européenne a
décidé et réglé autour d’un tapis vert, pourra être comparé par
les historiens de l’avenir à la bulle pontificale qui, au quinzième
siècle, a partagé entre les Portugais et les Espagnols le monde
païen à découvrir et à convertir; mais, comme cette bulle, il
PRÉFACE. xm
aura de grandes conséquences. Ce n’est ni le désir de convertir
les noirs, sur lesquels les missionnaires, protestants ou catholiques,
n’ont exercé jusqu’ici qu’une influence bien faible à côté
de l’influence de l’islamisme, ni même le désir de supprimer
l’esclavage qui a guidé les puissances, c est la pensée de s approprier
un marché colonial. La manufacture européenne, que
la science moderne arme pour produire beaucoup, se sent à
l’étroit en Europe et craint la concurrence américaine ; elle a
voulu s’assurer un débouché en Afrique. L’Angleterre, qui est
la plus grande manufacture d’Europe, a été la plus ardente à se
jeter sur cette proie, la plus avisée aussi et peut-être la moins
scrupuleuse ; elle s’est fait la part du lion. J estime que les
noirs, dont on a disposé sans leur consentement, n auront pas
à regretter la tutelle qu’on leur impose; leur civilisation est
trop peu développée pour qu’ils aient pu s’organiser eux-mêmes
en États durables, excepté dans le Soudan musulman, et le
morcellement en petites tribus est une cause d’hostilités continuelles;
la sécurité leur manque. Leurs nouveaux maîtres
pourront peu à peu la leur donner et en même temps les stimuler
quelque peu au travail par l’attrait du commerce : ce
qui sera un bien si les marchandises corruptrices ne prennent
pas trop de place dans ce commerce. Si cet état de choses dure,
il ne serait pas étonnant que la population de l’Afrique, dont
la densité est faible, doublât en un siècle.
Le Dahomey fait aujourd’hui partie du lot de la France. Une
maison française s’était établie à Whydah en 1843, à l’époque
où le gouvernement de Louis-Philippe prenait possession de
quelques postes sur la côte occidentale de l’Afrique ; un traité
de commerce avait été signé en 1851 avec le roi du Dahomey;
un autre traité, en 1868, avait cédé à la France le petit territoire
de Kotonou (600 mètres de côte), situé sur la frontière
des royaumes du Dahomey et de Porto-Novo; en 1863, sur la