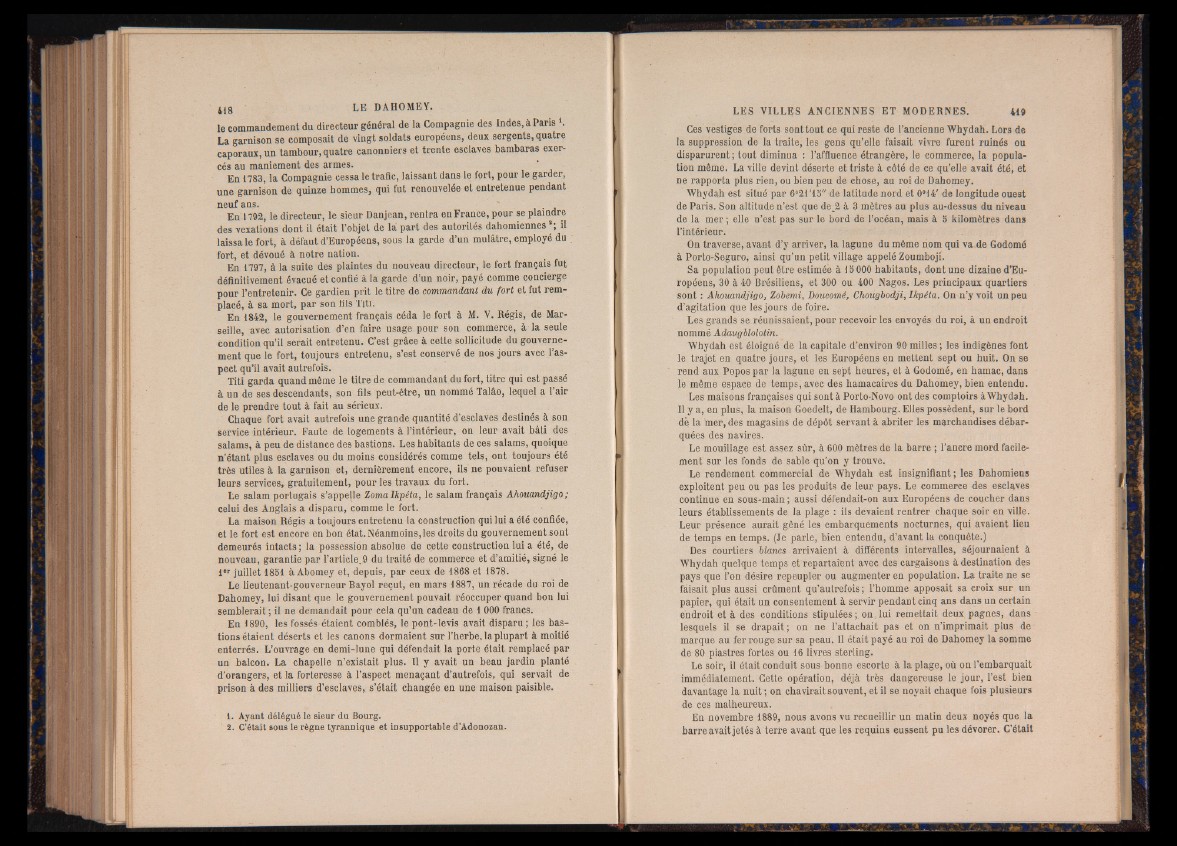
le commandement du directeur général de la Compagnie des Indes, à Paris *.
La garnison se composait de vingt soldats européens, deux sergents, quatre
caporaux, un tambour, quatre canonniers et trente esclaves bambaras exercés
au maniement des armes.
En 1783, la Compagnie cessa le trafic, laissant dans le fort, pour le garder,
une garnison de quinze hommes, qui fut renouvelée et entretenue pendant
neuf ans. '
En 1792, le directeur, le sieur Danjean, ren tra en France, pour se plaindre
des vexations dont il était l’objet de là p a rt des autorités dahomiennes ; il
laissa le fort, à défaut d’Européens, sous la garde d’un mulâtre, employé du
fort, et dévoué à notre nation.
En 1797, à la suite des plaintes du nouveau directeur, le fort français fut
définitivement évacué et confié à la garde d’un noir, payé comme concierge
pour l’entretenir. Ce gardien p rit le titre de commandant du fort et fut remplacé,
à sa mort, p ar son fils Titi.
En 1842, le gouvernement français céda le fort à M. V. Régis, de Marseille,
avec autorisation d’en faire usage pour son commerce, à la seule
condition qu’il serait entretenu. C’est grâce à cette sollicitude du gouvernement
que le fort, toujours entretenu, s’est conservé de nos jours avec l’aspect
qu’il avait autrefois.
Titi garda quand même le titre de commandant du fort, titre qui est passé
à un de ses descendants, son fils peut-être, un nommé Talâo, lequel a l’air
de le prendre tout à fait au sérieux.
Chaque fort avait autrefois une grande quantité d’esclaves destinés à son
service intérieur. Faute de logements à l’intérieur, on leur avait bâti des
salams, à peu de distance des bastions. Les habitants de ces salams, quoique
n ’étant plus esclaves ou du moins considérés comme tels, ont toujours été
trè s utiles à la garnison et, dernièrement encore, ils ne pouvaient refuser
leurs services, gratuitement, pour les travaux du fort.
Le salam portugais s’appelle Zomalkpéta, le salam français Ahouandjigo;
celui des Anglais a disparu, comme le fort.
La maison Régis a toujours entretenu la construction qui lui a été confiée,
e t le fort est encore en bon état. Néanmoins,les droits du gouvernement sont
demeurés intacts ; la possession absolue de cette construction lui a été, de
nouveau, garantie p ar l’a rtic le ^ du tra ité de commerce et d’amitié, signé le
1” juillet 1851 àAbomey et, depuis, p ar ceux de 1868 et 1878.
Le lieutenant-gouverneur Bayol reçut, en mars 1887, un récade du roi de
Dahomey, lui disant que le gouvernement pouvait réoccuper quand bon lui
semblerait ; il ne demandait pour cela qu’un cadeau de 1 000 francs.
En 1890, les fossés étaient comblés, le pont-levis avait disparu ; les bastions
étaient déserts et les canons dormaient sur l’herbe, la plupart à moitié
enterrés. L’ouvrage en demi-lune qui défendait la porte était remplacé par
un balcon. La chapelle n ’existait plus. Il y avait un beau ja rd in planté
d ’orangers, et la forteresse à l’aspect menaçant d’autrefois, qui servait de
prison à des milliers d’esclaves, s ’était changée en une maison paisible.
1. Ayant délégué le sieur du Bourg.
2. C’était sous le règne tyrannique et insupportable d'Adonozan.
Ces vestiges de forts sont tout ce qui reste de l’ancienne Whydah. Lors de
la suppression de la traite, les gens qu’elle faisait vivre furent ruinés ou
disparurent ; tout diminua : l’affluence étrangère, le commerce, la population
même. La ville devint déserte et triste à côté de ce qu’elle avait été, et
ne rapporta plus rien, ou bien peu de chose, au roi de Dahomey.
Whydah est situé par 6°21T5" de latitude nord e t 0°14' de longitude ouest
de Paris. Son altitude n ’est que de_2 à 3 mètres au plus au-dessus du niveau
de la mer ; elle n ’est pas sur le bord de l’océan, mais à 5 kilomètres dans
l’intérieur.
On traverse, avant d’y arriver, la lagune du même nom qui va de Godomé
à Porto-Seguro, ainsi qu’un petit village appelé Zoumboji.
Sa population peut être estimée à 15 000 habitants, dont une dizaine d’Européens,
30 à 40 Brésiliens, et 300 ou 400 Nagos. Les principaux quartiers
sont : Ahouandjigo, Zobemi, Doucomé, Chougbodji, Ikpéta. On n ’y voit un peu
d’agitation que lés jours de foire.
Les grands se réunissaient, pour recevoir les envoyés du roi, à un endroit
nommé Adaugblolotin.
Whydah est éloigné de la capitale d’environ 90 milles ; les indigènes font
le tra je t en quatre jours, et les Européens en mettent sept ou huit. On se
rend aux Popos p a r la lagune en sept heures, et à Godomé, en hamac, dans
le même espace de temps, avec des hamacaires du Dahomey, bien entendu.
Les maisons françaises qui sont à Porto-Novo ont des comptoirs àWhydah.
Il y a, en plus, la maison Goedelt, de Hambourg. Elles possèdent, sur le bord
dè la mer, des magasins de dépôt servant à abriter les marchandises débarquées
des navires.
Le mouillage est assez sûr, à 600 mètres de la barre ; l’ancre mord facilement
sur les fonds de sable qu’on y trouve.
Le rendement commercial de Whydah est insignifiant ; les Dahomiens
exploitent peu ou pas les produits de leur pays. Le commerce des esclaves
continue en sous-main ; aussi défendait-on aux Européens de coucher dans
leurs établissements de la plage : ils devaient ren tre r chaque soir en ville.
Leur présence aurait gêné les embarquements nocturnes, qui avaient lieu
de temps en temps. (Je parle, bien entendu, d’avant la conquête.)
Des courtiers blancs arrivaient à différents intervalles, séjournaient à
Whydah quelque temps et repartaient avec des cargaisons à destination des
pays que l’on désire repeupler ou augmenter en population. La traite ne se
faisait plus aussi crûment qu’autrefois ; l’homme apposait sa croix su r un
papier, qui était un consentement à servir pendant cinq ans dans un certain
endroit et à des conditions stipulées o n , lui remettait deux pagnes, dans
lesquels il se drapait ; on ne l’attachait pas et on n ’imprimait plus de
marque au fer rouge sur sa peau. Il était payé au roi de Dahomey la somme
de 80 piastres fortes ou 16 livres sterling.
Le soir, il était conduit sous bonne escorte à la plage, où on l’embarquait
immédiatement. Cette opération, déjà très dangereuse le jour, l’est bien
davantage la nuit ; on chavirait souvent, et il se noyait chaque fois plusieurs
de ces malheureux.
En novembre 1889, nous avons vu recueillir un matin deux noyés que la
barre avait jetés à te rre avant que les requins eussent pu les dévorer. C’était