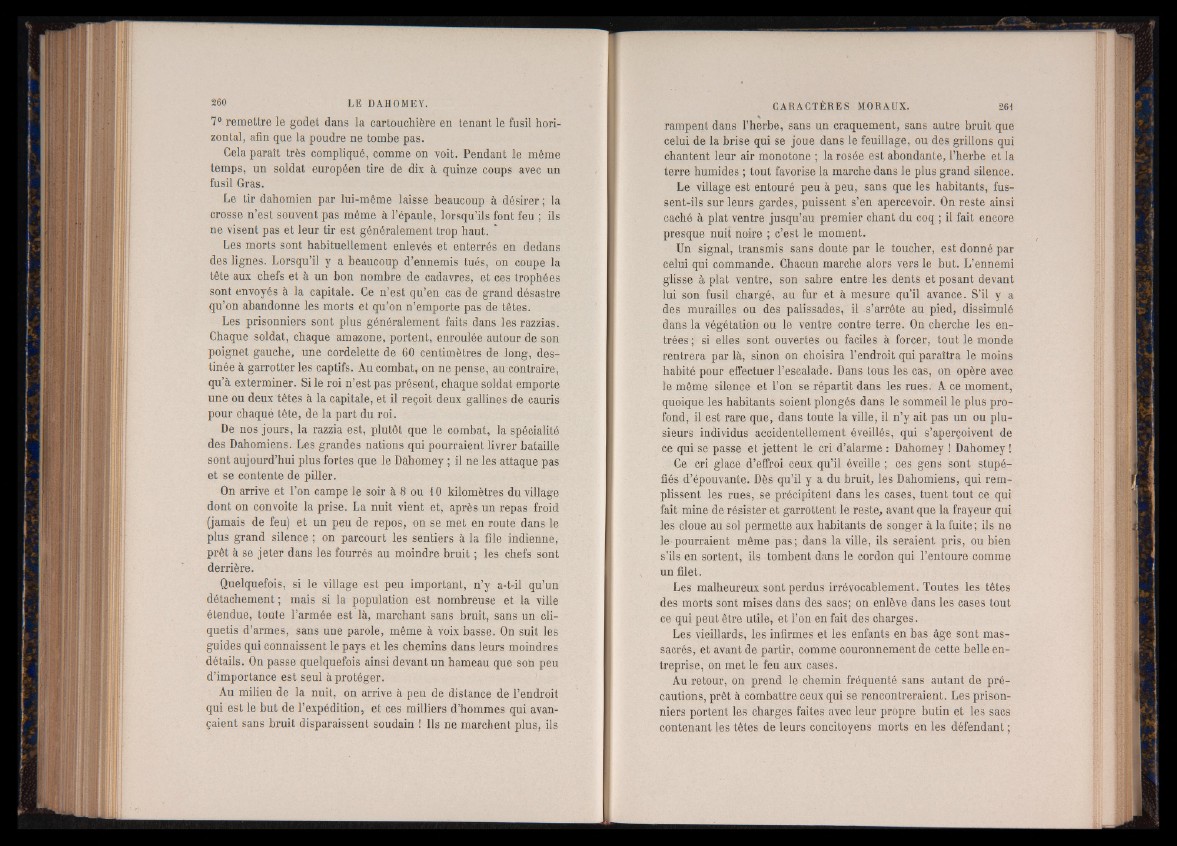
7° remettre le godet dans la cartouchière en tenant le fusil horizontal,
afin que la poudre ne tombe pas.
Cela paraît très compliqué, comme on voit. Pendant le même
temps, un soldat européen tire de dix à quinze coups avec un
fusil Gras.
Le tir dahomien par lui-même laisse beaucoup à désirer ; la
crosse n’est souvent pas même à l’épaule, lorsqu’ils font feu ; ils
ne visent pas et leur tir est généralement trop haut, i
Les morts sont habituellement enlevés et enterrés en dedans
des lignes. Lorsqu’il y a beaucoup d’ennemis tués, on coupe la
tête aux chefs et à un bon nombre de cadavres, et ces trophées
sont envoyés à la capitale. Ce n’est qu’en cas de grand désastre
qu’on abandonne les morts et qu’on n’emporte pas de têtes.
Les prisonniers sont plus généralement faits dans les razzias.
Chaque soldat, chaque amaaone, portent, enroulée autour de son
poignet gauche, une cordelette de 60 centimètres de long, destinée
à garrotter les captifs. Au combat, on ne pense, au contraire,
qu’à exterminer. Si le roi n’est pas présent, chaque soldat emporte
une ou deux têtes à la capitale, et il reçoit deux gallines de cauris
pour chaqué tête, de la part du roi.
De nos jours, la razzia est, plutôt que le combat, la spécialité
des Dahomiens. Les grandes nations qui pourraient livrer bataille
sont aujourd’hui plus fortes que le Dahomey ; il ne les attaque pas
et se contente de piller.
On arrive et l’on campe le soir à 8 ou 10 kilomètres du village
dont on convoite la prise. La nuit vient et, après un repas froid
(jamais de feu) et un peu de repos, on se met en route dans le
plus grand silence ; on parcourt les sentiers à la file indienne,
prêt à se jeter dans les fourrés au moindre bruit ; les chefs sont
derrière.
Quelquefois, si le village est peu important, n’y a-t-il qu’un
détachement ; mais si la population est nombreuse et la ville
étendue, toute l’armée est là, marchant sans bruit, sans un cliquetis
d’armes, sans une parole, même à voix basse. On suit les
guides qui connaissent le pays et les chemins dans leurs moindres
détails. On passe quelquefois ainsi devant un hameau que son peu
d’importance est seul à protéger.
Au milieu de la nuit, on arrive à peu de distance de l’endroit
qui est le but de l’expédition, et ces milliers d’hommes qui avançaient
sans bruit disparaissent soudain ! Ils ne marchent plus, ils
rampent dans l’herbe, sans un craquement, sans autre bruit que
celui de la brise qui se joue dans le feuillage, ou des grillons qui
chantent leur air monotone ; la rosée est abondante, l’herbe et la
terre humides ; tout favorise la marche dans le plus grand silence.
Le village est entouré peu à peu, sans que les habitants, fussent
ils sur leurs gardes, puissent s’en apercevoir. On reste ainsi
caché à plat ventre jusqu’au premier chant du coq ; il fait encore
presque nuit noire ; c’est le moment.
Un signal, transmis sans doute par le toucher, est donné par
celui qui commande. Chacun marche alors vers le but. L’ennemi
glisse à plat ventre, son sabre entre les dents et posant devant
lui son fusil chargé, au fur et à mesure qu’il avance. S’il y a
des murailles ou des palissades, il s’arrête au pied, dissimulé
dans la végétation ou le ventre contre terre. On cherche les entrées
; si elles sont ouvertes ou faciles à forcer, tout le monde
rentrera par là, sinon on choisira l’endroit qui paraîtra le moins
habité pour effectuer l’escalade. Dans tous les cas, on opère avec
le même silence et l’on se répartit dans les rues. A ce moment,
quoique les habitants soient plongés dans le sommeil le plus profond,
il est rare que, dans toute la ville, il n’y ait pas un ou plusieurs
individus accidentellement éveillés, qui s’aperçoivent de
ce qui se passe et jettent le cri d’alarme : Dahomey ! Dahomey !
Ce cri glace d’effroi ceux qu’il éveille ; ces gens sont stupéfiés
d’épouvante. Dès qu’il y a du bruit, les Dahomiens, qui remplissent
les rues, se précipitent dans les cases, tuent tout ce qui
fait mine de résister et garrottent le reste, avant que la frayeur qui
les cloue au sol permette aux habitants de songer à la fuite; ils ne
le pourraient même pas; dans la ville, ils seraient pris, ou bien
s’ils en sortent, ils tombent dans le cordon qui l’entoure comme
un filet.
Les malheureux sont perdus irrévocablement. Toutes les têtes
des morts sont mises dans des sacs; on enlève dans les cases tout
ce qui peut être utile, et l’on en fait des charges.
Les vieillards, les infirmes et les enfants en bas âge sont massacrés,
et avant de partir, comme couronnement de cette belle entreprise,
on met le feu aux cases.
Au retour, on prend le chemin fréquenté sans autant de précautions,
prêt à combattre ceux qui se rencontreraient. Les prisonniers
portent les charges faites avec leur propre butin et les sacs
contenant les têtes de leurs concitoyens morts en les défendant ;