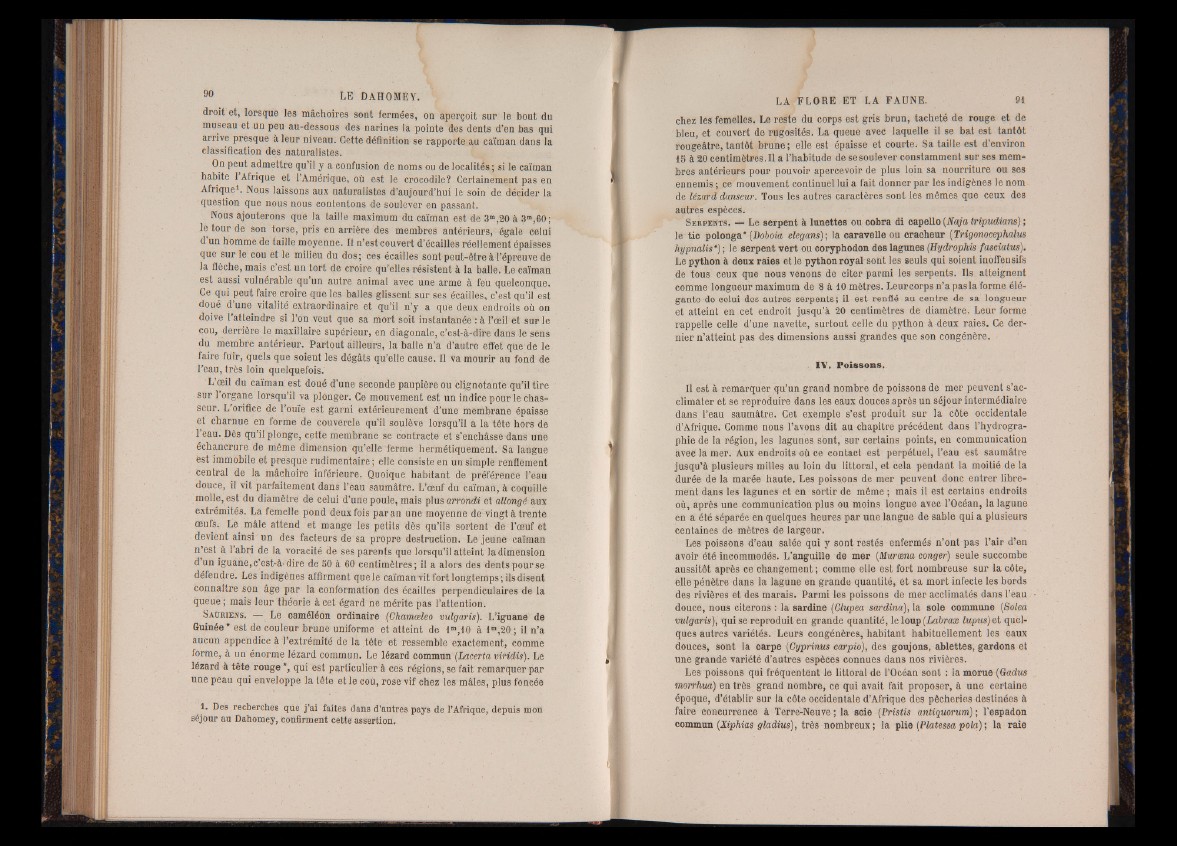
droit et, lorsque les mâchoires sont fermées, on aperçoit sur le bout du
museau et un peu au-dessous des narines la pointe des dents d’en bas qui
arrive presque à leur niveau. Cette définition se rapporte au caïman dans la
classification des naturalistes.
On peut admettre qu’il y a confusion de noms ou de localités ; si le caïman
habite 1 Afrique et l’Amérique, où est le crocodile? Certainement pas en
Afrique1. Nous laissons aux naturalistes d ’aujourd’hui le soin de décider la
question que nous nous contentons de soulever en passant.
Nous ajouterons que la taille maximum du caïman est de 3m,20 à 3“ ,60;
Je to u r de son torse, pris en arrière des membres antérieurs, égale celui
d un homme de taille moyenne. Il n’est couvert d’écailles réellement épaisses
que su r le cou et le milieu du dos; ces écailles sont peut-être à l’épreuve de
Ja flèche, mais c’est un to rt de croire qu’elles résistent à la balle. Le caïman
est aussi vulnérable qu’un autre animal avec une arme à feu quelconque.
Ce qui peut faire croire que les balles glissent sur ses écailles, c’est qu’il est
doué d une vitalité extraordinaire et qu’il n ’y a que deux endroits où on
doive l’atteindre si l’on veut que sa mort soit instantanée : à l’oeil et sur le
cou, derrière le maxillaire supérieur, en diagonale, c’est-à-dire dans le sens
du membre antérieur. Partout ailleurs, la balle n ’a d’autre effet que de le
faire fuir, quels que soient les dégâts qu’elle cause. II va mourir au fond de
l ’eau, très loin quelquefois.
L oeil du caïman est doué d’une seconde paupière ou clignotante qu’il tire
su r l’organe lorsqu’il va plonger. Ce mouvement est un indice pour le chasseur.
L’orifice de l’ouïe est garni extérieurement d’une membrane épaisse
et charnue en forme de couvercle qu’il soulève lorsqu’il a la tête hors de
1 eau. Dès qu’il plonge, cette membrane se contracte et s'enchâsse dans une
échancrure de même dimension qu’elle ferme hermétiquement. Sa langue
est immobile et presque rudimentaire ; elle consiste en un simple reuflement
central de la mâchoire inférieure. Quoique habitant de préférence l’eau
douce, il vit parfaitement dans l’eau saumâtre. L’oeuf du caïman, à coquille
molle, est du diamètre de celui d’une poule, mais plus arrondi et allongé aux
extrémités. La femelle pond deux fois p a r an une moyenne de vingt à tren te
oeufs. Le mâle attend et mange les petits dès qu’ils sortent de l’oeuf et
devient ainsi un des facteurs de sa propre destruction. Lé jeune caïman
n ’est à l’abri de la voracité de ses parents que lorsqu’il atteint la dimension
d’un iguane, c’est-à-dire de 50 à 60 centimètres; il a alors des dents pour se
défendre. Les indigènes affirment que le caïman vit fort longtemps; ils disent
connaître son âge p ar la conformation des écailles perpendiculaires de la
queue; mais leur théorie à c e t égard ne mérite pas l’attention.
Sauriens. — Le caméléon ordinaire (Ghamoeleo vulgaris). L’iguane de
Guinée* est de couleur brune uniforme et atteint de Im, I 0 à l m,20; il n ’a
aucun appendice à l’extrémité de la tête et ressemble exactement, Comme
forme, à un énorme lézard commun. Le lézard commun (Lacerta viHdis). Le
lézard à tê te rouge *, qui est particulier à ces régions, se fait remarquer par
une peau qui enveloppe la tête et le coù, rose vif chez les mâles, plus foncée
1. Des recherches que j ’ai faites dans d’autres pays de l’Afrique, depuis mon
séjour au Dahomey, confirment cette assertion.
chez les femelles. Le reste du corps est gris brun, tacheté de rouge e t de
bleu, et couvert de rugosités. La queue avec laquelle il se bat est tan tô t
rougeâtre, tan tô t brune ; elle est épaisse et courte. Sa taille est d’environ
15 à 20 centimètres. Il a l’habitude de se soulever constamment sur ses membres
antérieurs pour pouvoir apercevoir de plus loin sa nourriture ou ses
ennemis ; ce mouvement continuel lui a fait donner p ar les indigènes le nom
de lézard danseur. Tous les autres caractères sont les mêmes que ceux des
autres espèces.
Serpents. — Le serpent à lunettes ou cobra di capello (Naja tripudians) ;
le tic polonga* (Doboia elegans)-, la caravelle ou cracheur (Trigonocephalus
hypnalis*) ; le serpent v e rt ou ooryphodon des lagunes (Hydrophis fasciatus).
Le python à deux raies et le python royal sont les seuls qui soient inoffensifs
de tous ceux que nous venons de citer parmi les serpents. Ils atteignent
comme longueur maximum de 8 à 10 mètres. Leurcorps n’a pasla forme élégante
de celui des autres serpents ; il est renflé au centre de sa longueur
et atteint en cet endroit jusqu’à 20 centimètres de diamètre. Leur forme
rappelle celle d’une navette, surtout celle du python à deux raies. Ce dernier
n ’atteint pas des dimensions aussi grandes que son congénère.
IV. P o is s o n s .
Il est à remarquer qu’un grand nombre de poissons de mer peuvent s’acclimater
et se reproduire dans les eaux douces après un séjour intermédiaire
dans l’eau saumâtre. Cet exemple s’est produit sur la côte occidentale
d’Afrique. Comme nous l’avons dit au chapitre précédent dans l’hydrographie
de la région, les lagunes sont, sur certains points, en communication
avec la mer. Aux endroits où ce contact est perpétuel, l’eau est saumâtre
jusqu’à plusieurs milles au loin du littoral, et cela pendant la moitié de la
durée de la marée haute. Les poissons de mer peuvent donc en tre r librement
dans les lagunes e t en sortir de même ; mais il est certains endroits
où, après une communication plus ou moins longue avec l’Océan, lalag u n è
en a été séparée en quelques heures p ar une langue de sable qui a plusieurs
centaines de mètres de largeur.
Les poissons d’eau salée qui y sont restés enfermés n’ont pas l’a ir d’en
avoir été incommodés. L’anguille de mer (Murcena conger) seule succombe
aussitôt après ce changement ; comme elle est fort nombreuse su r la côte,
elle pénètre dans la lagune en grande quantité, et sa mort infecte les bords
des rivières et des marais. Parmi les poissons de mer acclimatés dans l’eau
doucé, nous citerons : la sardine (Clupea sardina), la sole commune [Solea
vulgaris), qui se reproduit en grande quantité, le loup (Labraæ lupus) et quelques
autres variétés. Leurs congénères, habitant habituellement les eaux
douces, sont la carpe (Cyprinus carpio), des goujons, ablettes, gardons et
une grande variété d’autres espèces connues dans nos rivières.
Les poissons qui fréquentent le littoral de l’Océan sont : la morue (Gadus
morrhua) e n tr é s grand nombre, ce qui avait fait proposer, à une certaine
époque, d’établir sur la côte occidentale d’Afrique dès pêcheries destinées à
faire concurrence à Terre-Neuve ; la scie (Pristis antiquorum) ; l’espadon
commun (Xiphias gladius), très nombreux; la plie [Platessa pola) ; la raie