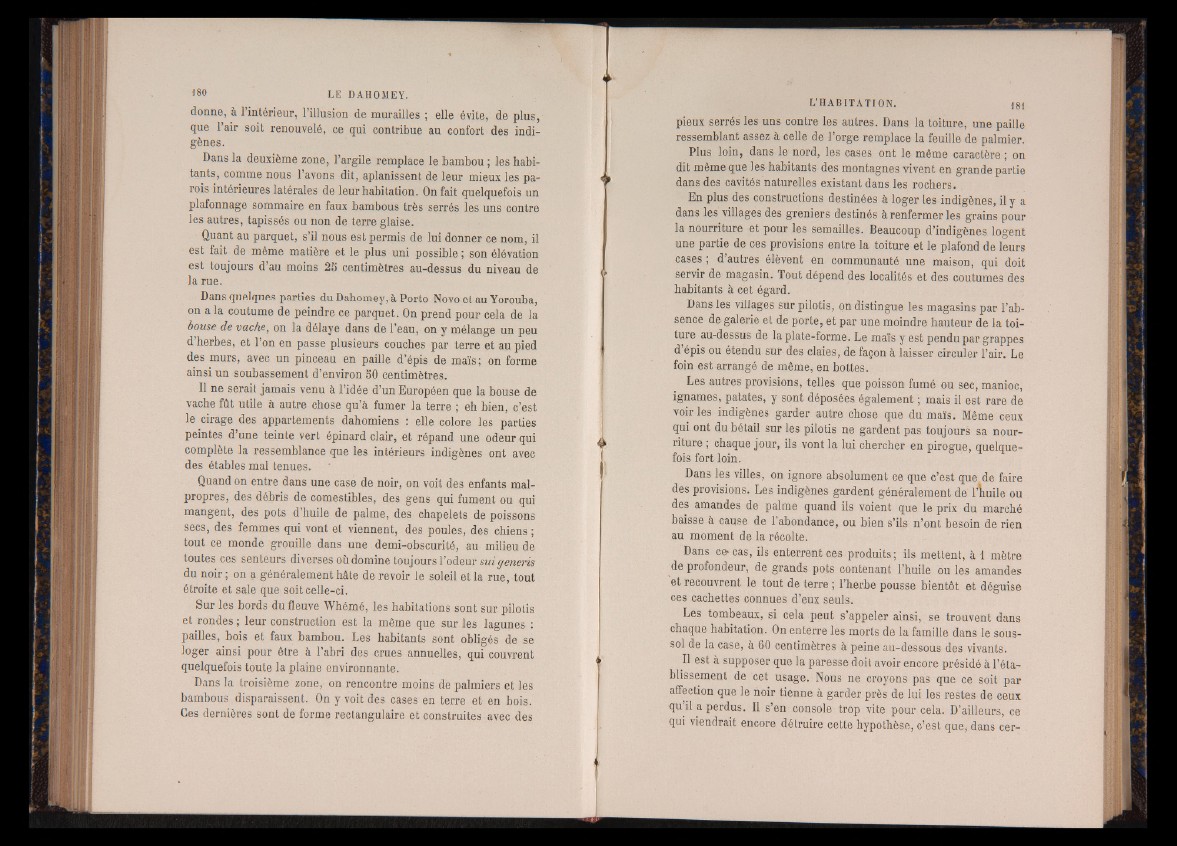
donne, à l’intérieur, l’illusion de murailles ; elle évite, de plus,
que l’air soit renouvelé, ce qui contribue au confort des indigènes.
Dans la deuxième zone, l’argile remplace le bambou ; les habitants,
comme nous l’avons dit, aplanissent de leur mieux les parois
intérieures latérales de leur habitation. On fait quelquefois un
plafonnage sommaire en faux bambous très serrés les uns contre
les autres, tapissés ou non de terre glaise.
Quant au parquet, s’il nous est permis de lui donner ce nom, il
est fait de même matière et le plus uni possible ; son élévation
est toujours d au moins 25 centimètres au-dessus du niveau de
la rue.
Dans quelques parties du Dahomey, à Porto-Novo et au Yorouba,
on a la coutume de peindre ce parquet. On prend pour cela de la
bouse de vache, on la délaye dans de l’eau, on y mélange un peu
d’herbes, et l’on en passe plusieurs couches par terre et au pied
des murs, avec un pinceau en paille d’épis de maïs; on forme
ainsi un soubassement d’environ 50 centimètres.
Il ne serait jamais venu à l’idée d’un Européen que la bouse de
vache fût utile à autre chose qu’à fumer la terre ; eh bien, c’est
le cirage des appartements dahomiens : elle colore les parties
peintes d’une teinte vert épinard clair, et répand une odeur qui
complète la ressemblance que les intérieurs indigènes ont avec
des étables mal tenues.
Quand on entre dans une case de noir, on voit des enfants malpropres,
des débris de comestibles, des gens qui fument ou qui
mangent, des pots d’huile de palme, des chapelets de poissons
secs, des femmes qui vont et viennent, des poules, des chiens ;
tout ce monde grouille dans une demi-obscurité, au milieu de
toutes ces senteurs diverses où domine toujours l’odeur suigeneris
du noir; on a généralement hâte de revoir le soleil et la rue, tout
étroite et sale que soit celle-ci.
Sur les bords du fleuve Whémé, les habitations sont sur pilotis
et rondes ; leur construction est la meme que sur les lagunes ;
pailles, bois et faux bambou. Les habitants sont obligés de se
loger ainsi pour être à l’abri des crues annuelles, qui couvrent
quelquefois toute la plaine environnante.
Dans la troisième zone, on rencontre moins de palmiers et les
bambous disparaissent. On y voit des cases en terre et en bois.
Ces dernières sont de forme rectangulaire et construites avec des
L’HABITATION. jg l
pieux serrés les uns contre les autres. Dans la toiture, une paille
ressemblant assez à celle de l’orge remplace la feuille de palmier.
Plus loin, dans le nord, les cases ont le même caractère ; on
dit même que les habitants des montagnes vivent en grande partie
dans des cavités naturelles existant dans les rochers.
En plus des constructions destinées à loger les indigènes, il y a
dans les villages des greniers destinés à renfermer les grains pour
la nourriture et pour les semailles. Beaucoup d’indigènes logent
une partie de ces provisions entre la toiture et le plafond de leurs
cases ; d’autres élèvent en communauté une maison, qui doit
servir de magasin. Tout dépend des localités et des coutumes des
habitants à cet égard.
Dans les villages sur pilotis, on distingue les magasins par l’absence
de galerie et de porte, et par une moindre hauteur de la toiture
au-dessus de la plate-forme. Le maïs y est pendu par grappes
d épis ou étendu sur des claies, de façon à laisser circuler l’air. Le
foin est arrangé de même, en bottes.
Les autres provisions, telles que poisson fumé ou sec, manioc,
ignames, patates, y sont déposées également ; mais il est rare de
voiries indigènes garder autre chose que du maïs. Même ceux
qui ont du bétail sur les pilotis ne gardent pas toujours sa nourriture
; chaque jour, ils vont la lui chercher en pirogue, quelquefois
fort loin.
Dans les villes, on ignore absolument ce que c’est que de faire
des provisions. Les indigènes gardent généralement de lmuile ou
des amandes de palme quand ils voient que le prix du marché
baisse à cause de 1 abondance, ou bien s’ils n ’ont besoin de rien
au moment de la récolte.
Dans ce- cas, ils enterrent ces produits; ils mettent, à 1 mètre
de profondeur, de grands pots contenant l’huile ou les amandes
et recouvrent le tout de terre ; l’herbe pousse bientôt et déguise
ces cachettes connues d’eux seuls.
Les tombeaux, si cela peut s’appeler ainsi, se trouvent dans
chaque habitation. On enterre les morts de la famille dans le sous-
sol de la case, à 60 centimètres à peine au-dessous des vivants.
Il est à supposer que la paresse doit avoir encore présidé à l’établissement
de cet usage. Nous ne croyons pas que ce soit par
affection que le noir tienne à garder près de lui les restes de ceux
qu’il a perdus. Il s’en console trop vite pour cela. D’ailleurs, ce
qui viendrait encore détruire cette hypothèse, c’est que, dans cer