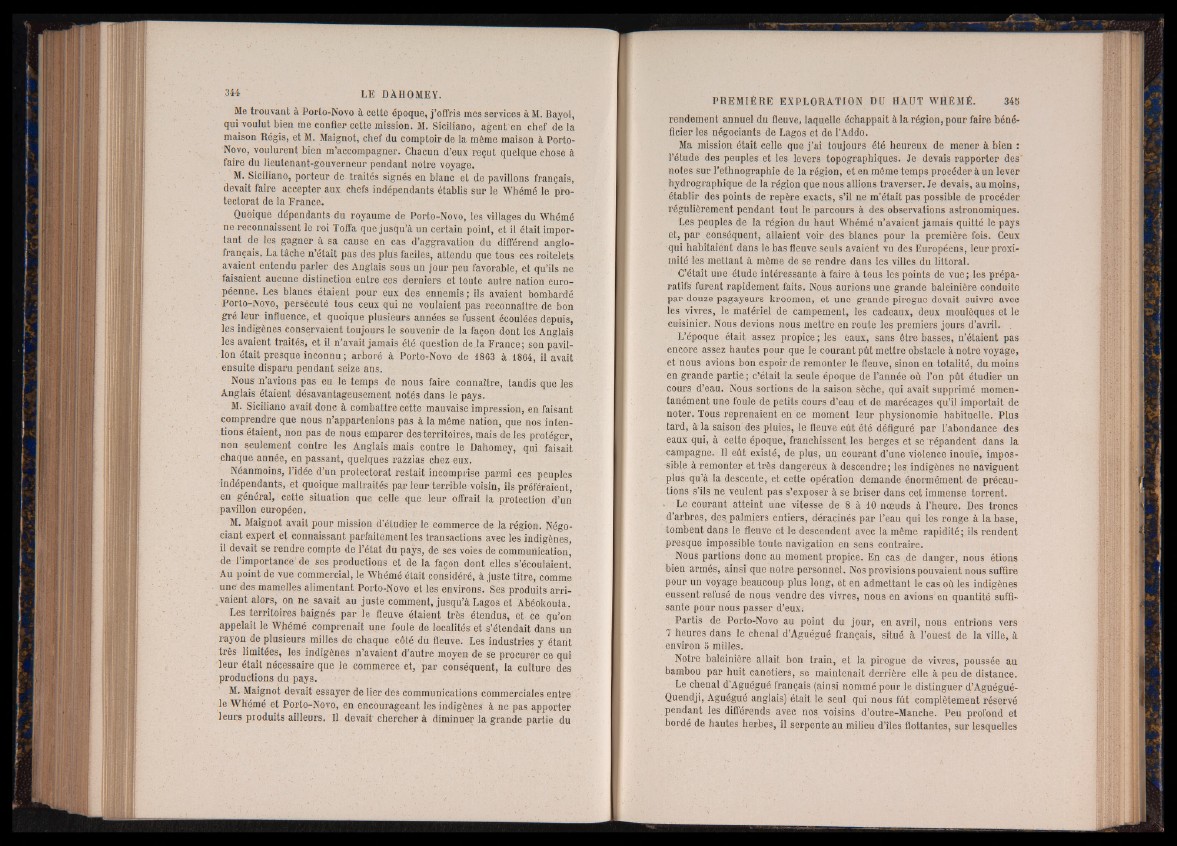
Me trouvant à Porto-Novo à cette époque, j ’offris mes services à M. Bayol,
qui voulut bien me confier cette mission. M. Siciliano, agent en chef de la
maison Régis, et M. Maignot, chef du comptoir de la même maison à Porto-
Novo, voulurent bien m’accompagner. Chacun d’eux reçut quelque chose à
faire du lieutenant-gouverneur pendant noire voyage.
M. Siciliano, porteur de traités signés en blanc et de pavillons français,
devait faire accepter aux chefs indépendants établis sur le Whémé le protectorat
de la France.
Quoique dépendants du royaume de Porto-Novo, le? villages du Whémé
ne reconnaissent le roi Toffa que jusqu’à un certain point, et il était importan
t de les gagner à sa cause en cas d’aggravation du différend anglo-
français, La tâche n ’était pas des plus faciles, attendu que tous ces roitelets
avaient entendu parler des Anglais sous un jo u r peu favorable, et qu’ils ne
faisaient aucune distinction entre ces derniers et toute autre nation européenne.
Les blancs étaient pour eux des ennemis ; ils avaient bombardé
Porto-Novo, persécuté tous ceux qui ne voulaient pas reconnaître de bon
gré leur influence, et quoique plusieurs années se lussent écoulées depuis,
les indigènes conservaient toujours le souvenir de la façon dont les Anglais
les avaient traités, et il n ’avait jamais été question de.la France; son pavillon
était presque inconnu ; arboré à Porto-Novo de 1863 à 1864, il avait
ensuite disparu pendant seize ans.
Nous n ’avions pas eu le temps de nous faire connaître, tandis que les
Anglais étaient désavantageusement notés dans le pays.
M. Siciliano avait donc à combattre cette mauvaise impression, en faisant
comprendre que nous n ’appartenions pas à la même nation, que nos intentions
étaient, non pas de nous emparer des territoires, mais de les protéger,
non seulement contre les Anglais mais contre le Dahomey, qui faisait
chaque année, en passant, quelques razzias chez eux.
Néanmoins, l’idée d’un protectorat restait incomprise parmi ces peuples
indépendants, et quoique maltraités p a r leur terrible voisin, ils préféraient,
en général, cette situation que celle que leur offrait la protection d’un
pavillon européen.
M. Maignot avait pour mission d’étudier le commerce de la région. Négociant
expert et connaissant parfaitement les transactions avec les indigènes,
il devait se rendre compte de l’é ta t du pays, de ses voies de communication,
de l’importance de ses productions e t de la façon dont elles s ’écoulaient.
Au point de vue commercial, le Whémé était considéré, à juste titre, comme
une des mamelles alimentant Porto-Novo et les environs. Ses produits a rrivaient
alors, on ne savait au juste comment, jusqu’à Lagos et Abéokouta.
Les territoires baignés p a r le fleuve étaient très étendus, et ce qu’on
appelait le Whémé comprenait une foule de localités et s’étendait dans un
rayon de plusieurs milles de chaque côté du fleuve. Les industries y étant
trè s limitées, les indigènes n ’avaient d’autre moyen de se procurer ce qui
le u r était nécessaire que le commerce et, p a r conséquent, la culture des
productions du pays.
M. Maignot devait essayer de lier des communications commerciales entre
le Whémé e t Porto-Novo, en encourageant les indigènes à ne pas apporter
leurs produits ailleurs. Il devait chercher à diminuer la grande partie du
rendement annuel du fleuve, laquelle échappait à la région, pour faire bénéficier
les négociants de Lagos et de l’Addo.
Ma mission était celle que j ’ai toujours été heureux de mener à bien :
l’étude des peuples et les levers topographiques. Je devais rap p o rter des’
notes sur l’ethnographie de la région, e t en même temps procéder à un lever
hydrographique de la région que nous allions traverser. Je devais, au moins,
établir des points de repère exacts, s’il ne m’était pas possible de procéder
régùlièrement pendant tout le parcours à des observations astronomiques.
Les peuples de la région du haut Whémé n ’avaient jamais quitté le pays
et, p a r conséquent, allaient voir des blancs pour la première fois. Ceux
qui habitaient dans le bas fleuve seuls avaient vu des Européens, leur proximité
les mettant à même de se ren d re dans les villes du littoral.
C’était une étude intéressante à faire à tous les points de vue; les préparatifs
furent rapidement faits. Nous aurions une grande baleinière conduite
par douze pagayeurs kroomen, et une grande pirogue devait suivre avec
les vivres, le matériel de campement, les cadeaux, deux moulèques et le
cuisinier. Nous devions nous mettre en route les premiers jours d’avril. .
L’époque était assez propice ; les eaux, sans être basses, n ’étaient pas
encore assez hautes pour que le courant pût m ettre obstacle à notre voyage,
e t nous avions bon espoir de remonter le fleuve, sinon en totalité, du moins
en grande p a rtie ; c’était la seule époque de Tannée où Ton pût étudier un
cours d’eau. Nous sortions de la saison sèche, qui avait supprimé momentanément
une foule de petits cours d’eau et de marécages qu’il importait de
noter. Tous reprenaient en ce moment leur physionomie habituelle. Plus
tard, à la saison des pluies, le fleuve eût été défiguré p a r l’abondance des
eaux qui, à cette époque, franchissent les berges et se répandent dans la
campagne. Il eût existé, de plus, u n courant d’une violence inouïe, impossible
à remonter et trè s dangereux à descendre; les indigènes ne naviguent
plus qu’à la descente, et cette opération demande énormément de précautions
s’ils ne veulent pas s’exposer à se briser dans cet immense torrent.
■ Le courant atteint une vitesse de 8 à 10 noeuds à l’heure. Des troncs
d’arbres, des. palmiers entiers, déracinés p ar l’eau qui les ronge à la base,
tombent dans le fleuve et le descendent avec la même rapidité; ils rendent
presque impossible toute navigation en sens contraire.
Nous partions donc au moment propice. En cas de danger, nous étions
bien armés, ainsi que notre personnel. Nos provisions pouvaient nous suffire
pour un voyage beaucoup plus long, et en admettant le cas où les indigènes
eussent refusé de nous vendre des vivres, nous en avions en quantité suffisante
pour nous passer d’eux;
Partis de Porto-Novo au point du jo u r, en avril, nous entrions vers
7 heures dans le chenal d’Aguégué français, situé à l’ouest de la ville, à
environ 5 milles.
Notre baleinière allait bon tra in , e t la pirogue de vivres, poussée au
bambou p a r huit canotiers, se maintenait derrière elle à peu de distance.
Le chenal d’Aguégué français (ainsi nommé pour le distinguer d’Aguégué-
Quendji, Aguégué anglais) était le seul qui nous fût complètement réservé
pendant les différends avec nos voisins d ’outre-Manche. Peu profond et
bordé de hautes herbes, il serpente au milieu d’îles flottantes, sur lesquelles