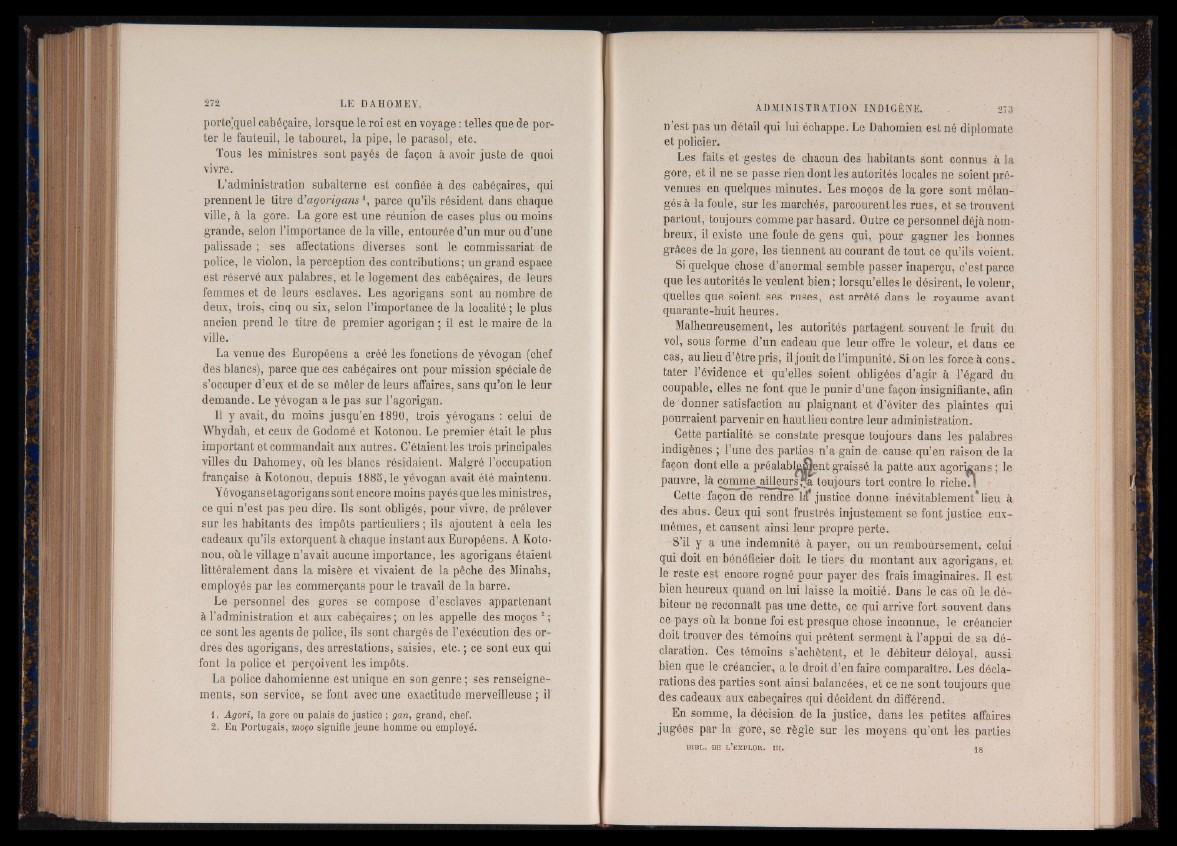
porte quel cabéçaire, lorsque le roi est en voyage : telles que de porter
le fauteuil, le tabouret, la pipe, le parasol, etc.
Tous les ministres sont payés de façon à avoir juste de quoi
vivre.
L’administration subalterne est confiée à des cabéçaires, qui
prennent le titre d'agorigans1, parce qu’ils résident dans chaque
ville, à la gore. La gore est une réunion de cases plus ou moins
grande, selon l’importance de la ville, entourée d’un mur ou d’une
palissade ; ses affectations diverses sont le commissariat de
police, le violon, la perception des contributions ; un grand espace
est réservé aux palabres, et le logement des cabéçaires, de leurs
femmes et de leurs esclaves. Les agorigans sont au nombre de
deux, trois, cinq ou six, selon l’importance de la localité ; le plus
ancien prend le titre de premier agorigan ; il est le maire de la
ville.
La venue des Européens a créé les fonctions de yévogan (chef
des blancs), parce que ces cabéçaires ont pour mission spéciale de
s’occuper d’eux et de se mêler de leurs affaires,, sans qu’on le leur
demande. Le yévogan a le pas sur l’agorigan.
Il y avait, du moins jusqu’en 1890, trois yévogans : celui de
Whydah, et ceux de Godomé et Kotonou. Le premier était le plus
important et commandait aux autres. C’étaient les trois principales
villes du Dahomey, où les blancs résidaient. Malgré l’occupation
française à Kotonou, depuis 1885, le yévogan avait été maintenu.
Yévogans et agorigans sont encore moins payés que les ministres,
ce qui n’est pas peu dire. Ils sont obligés, pour vivre, de prélever
sur les habitants des impôts particuliers ; ils ajoutent à cela les
cadeaux qu’ils extorquent à chaque instant aux Européens. A Kotonou,
oùle village n’avait aucune importance, les agorigans étaient
littéralement dans la misère et vivaient de la pêche des Minahs,
employés par les commerçants pour le travail de la barre.
Le personnel des gores se compose d’esclaves appartenant
à l’administration et aux cabéçaires ; on les appelle des moços 2 ;
ce sont les agents de police, ils sont chargés de l’exécution des ordres
des agorigans, des arrestations, saisies, etc. ; ce sont eux qui
font la police et perçoivent les impôts.
La police dahomienne est unique en son genre ; ses renseignements,
son service, se font avec une exactitude merveilleuse ; il
1. Agori, la gore ou palais de justice ; gan, grand, chef.
2. En Portugais, moço signifie jeune homme ou employé.
n’est pas un détail qui lui échappe. Le Dahomien est né diplomate
et policier.
Les faits et gestes de chacun des habitants sont connus à la
gore, et il ne se passe rien dont les autorités locales ne soient prévenues
en quelques minutes. Les moços de la gore sont mélangés
à la foulé, sur les marchés, parcourentles rues, et se trouvent
partout, toujours comme par hasard. Outre ce personnel déjà nombreux,
il existe une foule de gens qui, pour gagner les bonnes
grâces de la gore, les tiennent au courant de tout ce qu’ils voient.
Si quelque chose d’anormal semble passer inaperçu, c’est parce
que les autorités le' veulent bien ; lorsqu’elles le désirent, le voleur,
quelles que soient ses ruses, est arrêté dans le royaume avant
quarante-huit heures.
Malheureusement, les autorités partagent souvent le fruit du
vol, sous forme d’un cadeau que leur offre le voleur, et dans ep
cas, au lieu d’être pris, iljoüit de l’impunité. Si on les force à cons.
tater l’évidence et qu’elles Soient obligées d’agir à l’égard du
coupable, elles ne font que le punir d’une façon insignifiante, afin
de donner satisfaction au plaignant et d’éviter des plaintes qui
pourraient parvenir en haut lieu contre leur administration.
Cette partialité, se constate presque toujours dans les palabres
indigènes l’une des parties n’a gain de cause qu!en raison de la
façon dont elle a préalablement graissé la patte aux agorkans ; le
pauvre, là commejtiüeurs,*a toujours tort contre le riche;!
Cette façon de rendre lcf justice donne inévitablement* lieu à
des abus. Ceux qui sont frustrés injustement se font justice eux-
mêmes, et causent ainsi leur propre perte.
S’il y a une indemnité à payer, ou un remboursement, celui
qui doit en bénéficier doit le tiers du montant aux agorigans, et
le reste est encore rogné pour payer des frais imaginaires. Il est
bien heureux quand on lui laisse la moitié. Dans le cas où le débiteur
ne reconnaît pas une dette, ce qui arrive fort souvent dans
ce pays où la bonne foi est presque chose inconnue, le créancier
doit trouver des témoins qui prêtent serment à l’appui de sa déclaration.
Ces témoins s’achètent, et le débiteur déloyal, aussi
bien que le créancier, a le droit d’en faire comparaître. Les déclarations
des parties sont ainsi balancées, et ce ne sont toujours que
des cadeauxvaux cabeçaires qui décident du différend.
En somme, la décision de la justice, dans les petites affaires
jugées par la gore, se règle sur les moyens qu’ont les parties
BIBL. DE l ’e XPLOR. I II . *