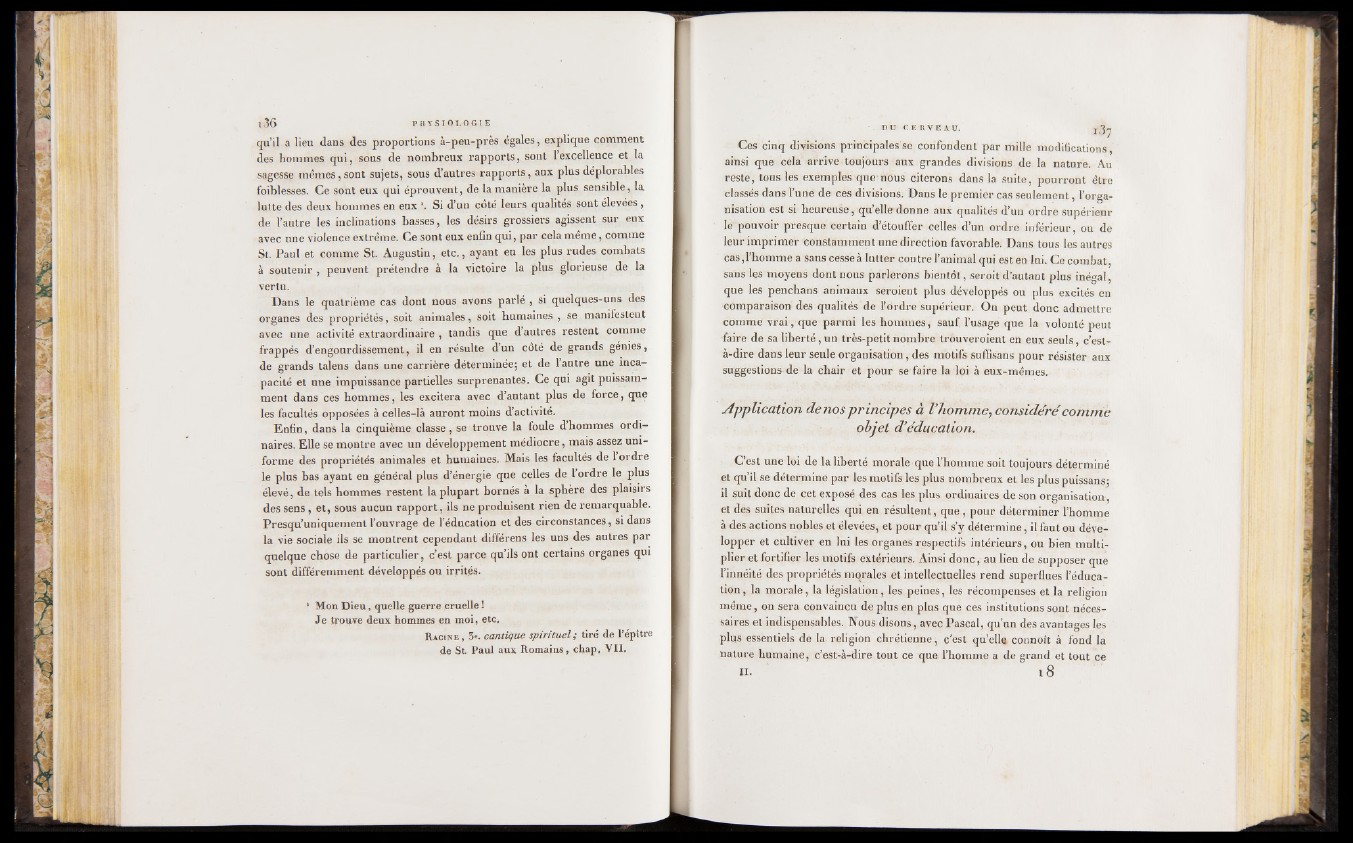
qu’il a lieu dans des proportions à-peu-près égales, explique comment
des hommes qui, sous de nombreux rapports, sont l’excellence et la
sagesse mêmes,sont sujets, sous d’autres rapports, aux plus déplorables
foiblesses. Ce sont eux qui éprouvent, de la manière la plus sensible, la
lutte des deux hommes en eux '. Si d’un coté leurs qualités sont élevées,
de l’autre les inclinations basses, les désirs grossiers agissent sur eux
avec une violence extrême. Ce sont eux enfin qui, par cela même, comme
St. Paul et comme St. Augustin, etc., ayant eu les plus rudes combats
à soutenir , peuvent prétendre à la victoire la plus glorieuse de la
vertu.
Dans le quatrième cas dont nous avons parle , si quelques-uns des
organes des propriétés, soit animales, soit humaines , se manifestent
avec une activité extraordinaire , tandis que d autres restent comme
frappés d’engourdissement, il en résulte d’un coté de grands génies,
de grands talens dans une carrière déterminée; et de l’autre une incapacité
et une impuissance partielles surprenantes. Ce qui agit puissamment
dans ces hommes, les excitera avec d’autant plus de force, que
les facultés opposées à celles-là auront moins d’activité.
Enfin, dans la cinquième classe, se trouve la foule d hommes ordinaires.
Elle se montre avec un développement médiocre, mais assez uniforme
des propriétés animales et humaines. Mais les facultés de 1 ordre
le plus bas ayant en général plus d’énergie que celles de 1 ordre le plus
élevé, de tels hommes restent la plupart bornés à la sphère des plaisirs
des sens, et, sous aucun rapport, ils ne produisent rien de remarquable.
Presqu’uniquement l’ouvrage de l’éducation et des circonstances, si dans
la vie sociale ils se montrent cependant différens les uns des autres par
quelque chose de partiçulier, c’est parce qu’ils ont certains organes qui
sont différemment développés ou irrités- *
* Mon Dieu, quelle guerre cruelle !
Je trouve deux hommes en moi, etc.
Racine, 3e. cantique spirituel; tiré de l’épitre
de St. Paul aux Romains, chap, VII.
Ces cinq divisions principales se confondent par mille modifications
ainsi que cela arrive toujours aux grandes divisions de la nature. Au
resté, tous les exemples que nous citerons dans la suite, pourront être
classés dans l’une de ces divisions. Dans le premier cas seulement, l’organisation
est si heureuse, qu’elle-donne aux qualités d’un ordre supérieur
le pouvoir presque certain d’étouffer celles d’un ordre inférieur, ou de
leur imprimer constamment une direction favorable. Dans tous les autres
cas, l’homme a sans cesse à lutter contre l’animal qui est en lui. Ce combat,
sans les moyens dont nous parlerons bientôt, serait d’autant plus inégal,
que les penchans animaux seroient plus développés ou plus excités en
comparaison des qualités de l'ordre supérieur. On peut donc admettre
comme vrai, que parmi les hommes, sauf, l’usage que la volonté peut
■ faire de sa liberté, un très-petit nombre trouveraient en eux seuls, c’est-
à-dire dans leur seule organisation, des motifs suffisans pour résister aux
suggestions de la chair et pour se faire la loi à eux-mêmes.
Application de nos principes à l’homme, considéré comme
objet d’éducation.
C’est une loi de la liberté morale que l’homme soit toujours déterminé
et qu’il se détermine par les motifs les plus nombreux et les plus puissans;
il suit donc de cet exposé des cas les plus ordinaires de son organisation
et des suites naturelles qui en résultent, que, pour déterminer l’homme
à des actions nobles et élevées, et pour qu’il s’y détermine, il faut ou développer
et cultiver en lui les organes respectifs intérieurs, ou bien multiplier
et fortifier les motifs extérieurs. Ainsi donc, au lieu de supposer que
l’innéité des propriétés morales et intellectuelles rend superflues l’éducation,
la morale, la législation, les peines, les récompenses et la religion
même, on sera convaincu de plus en plus que ces institutions sont nécessaires
et indispensables. Nous disons, avec Pascal, qu’un des avantages les
plus essentiels de la religion chrétienne, c'est qu’elle connoît à fond la
nature humaine, c’est-à-dire tout ce que l’homme a de grand et tout ce
II. 1 8