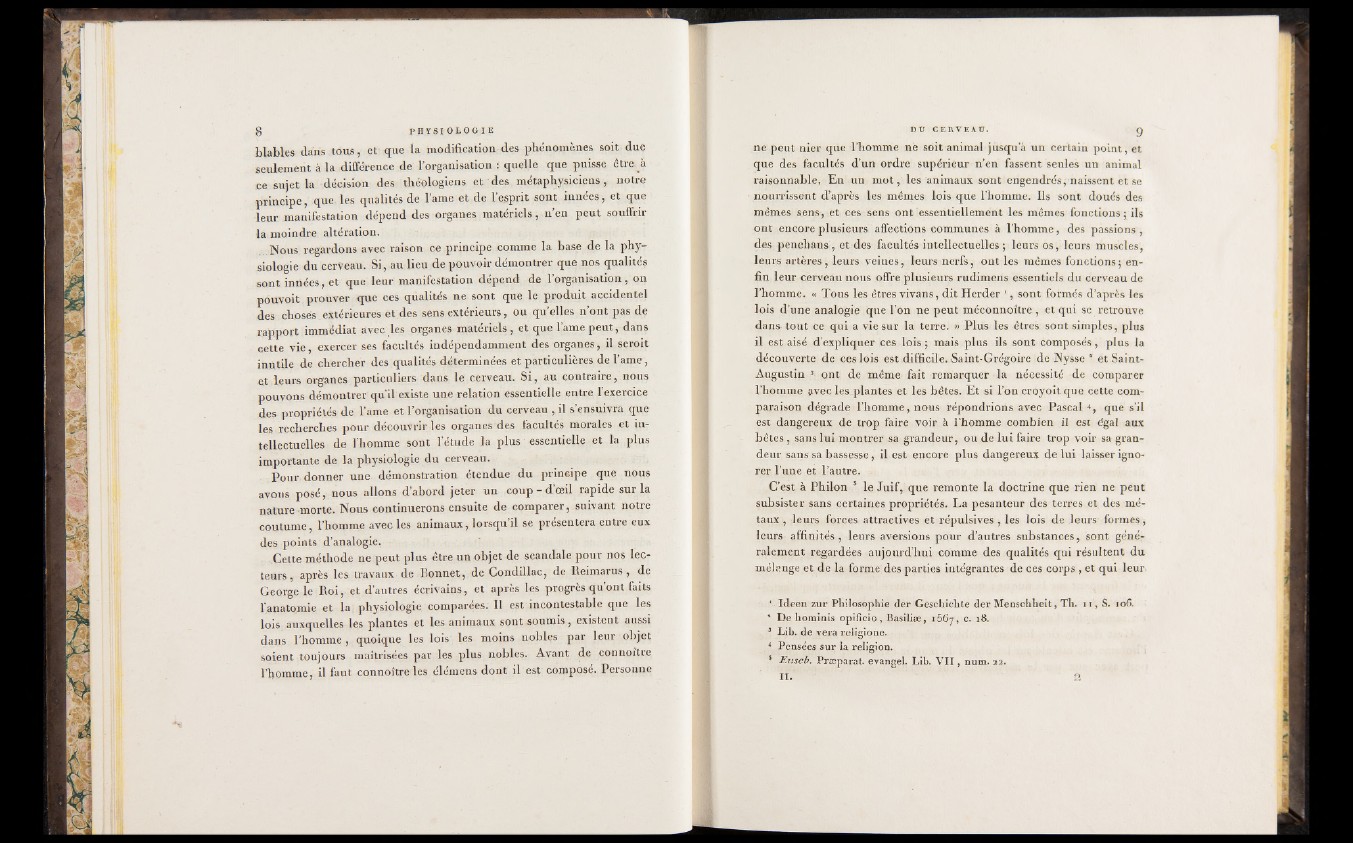
blables dans tous, et que la modification des phénomènes soit due
seulement à la différence de l’organisation : quelle que puisse étre.à
ce sujet la décision des théologiens et des métaphysiciens, notre
principe, que les qualités de l’ame et de l’esprit sont innées, et que
leur manifestation dépend des organes matériels, n’en peut souffrir
la moindre altération.
. . Nous regardons avec raison ce principe comme la base de la physiologie
du cerveau. Si, au lieu de pouvoir démontrer que nos qualités
sont innées, et que leur manifestation dépend de l’organisation, on
pouvoit prouver que ces qualités ne sont que le produit accidentel
des choses extérieures et. des sens extérieurs, ou qu’elles n’ont pas de
rapport immédiat avec les organes matériels , et que lame peut, dans
cette vie, exercer ses facultés indépendamment des organes, il seroit
inutile de chercher des qualités déterminées et particulières de lame,
et leurs organes particuliers dans le cerveau. Si, au contraire, nous
pouvons démontrer qu’il existe une relation essentielle entre l’exercice
des propriétés de lame et l ’organisation du cerveau , il s’ensuivra que
les recherches pour découvrir les organes dés facultés morales et intellectuelles
de l’homme sont l’étude la plus essentielle et la plus
importante de la physiologie du cerveau.
Pour donner une démonstration étendue du principe que nous
avons posé, nous allons d’abord jeter un coup - d’oeil rapide sur la
nature morte. Nous continuerons ensuite de comparer, suivant notre
coutume, l’homme avec les animaux, lorsqu’il se présentera entre eux
des points d’analogie,
Cette méthode ne peut plus être un objet de scandale pour nos lecteurs
, après les travaux de Bonnet, de Condillac, de Reimarus, de
George le Roi , et d’autres écrivains, et après les progrès qu ont faits
l’anatomie et la physiologie comparées. Il est incontestable que les
lois auxquelles les plantes et les animaux sont .soumis, existent aussi
dans l'homme, quoique les lois les moins nobles par leur objet
soient toujours maîtrisées par les plus nobles. Avant de connoitre
l’homme, il faut connoître les élémens dont il est compose. Personne
ne peut nier que l ’homme nè soit animal jusqu’à un certain point, et
que des facultés d’un ordre supérieur n’en fassent seules un animal
raisonnable, En un mot, les animaux sont engendrés, naissent et se
nourrissent d’après les mêmes lois que l homme. Us sont doués des
mêmes sens-, et ces sens ont essentiellement les mêmes fonctions ; ils
ont encore plusieurs affections communes à l’homme, des passions,
des penchans, et des facultés intellectuelles; leurs os, leurs muscles,
leurs artères, leurs veines, leurs nerfs, ont les mêmes fonctions ; enfin
leur cerveau nous offre plusieurs rudimens essentiels du cerveau de
l’homme. « Tous les êtres vivans, dit Herder ‘ , sont formés d’après les
lois d’une analogie que l’on ne peut méconnoître, et qui se retrouve
dans tout ce qui a vie sur la terre. » Plus les êtres sont simples, plus
il est aisé d’expliquer ces lois ; mais plus ils sont composés, plus la
découverte de ces lois est difficile. Saint-Grégoire de Nysse * et Saint-
Augustin ;3j ont de même fait remarquer la nécessité de comparer
l ’homme avec les plantes et les bêtes. Et si l’on croyoit que cette comparaison
dégrade l ’homme, nous répondrions avec Pascal ■ *, que s’il
est dangereux de trop faire voir à l’homme combien il est égal aux
bêtes , sans lui montrer sa grandeur, ou de lui faire trop voir sa grandeur
sans sa bassesse, il est encore plus dangereux de lui laisser ignorer
l’une et l’autre.
C’est à Philon 5 le Juif, que remonte la doctrine que rien ne peut
subsister sans certaines propriétés. La pesanteur des terres et des métaux
, leurs forces attractives et répulsives , les lois de leurs formes,
leurs affinités , leurs aversions pour d’autres substances, sont généralement
regardées aujourd’hui comme des qualités qui résultent du
mélange et de la forme des parties intégrantes de ces corps, et qui leur
fl Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Th. 1 1 , S. 106.
* De hominis opificio, Basiliae, i 56y, c. 18.
3 Lib. de vera religione.
4 Pensees sur Ia religion.
5 Euseb. Präparat. evangel. Lib. V I I , num. 22.
11. " ........... St