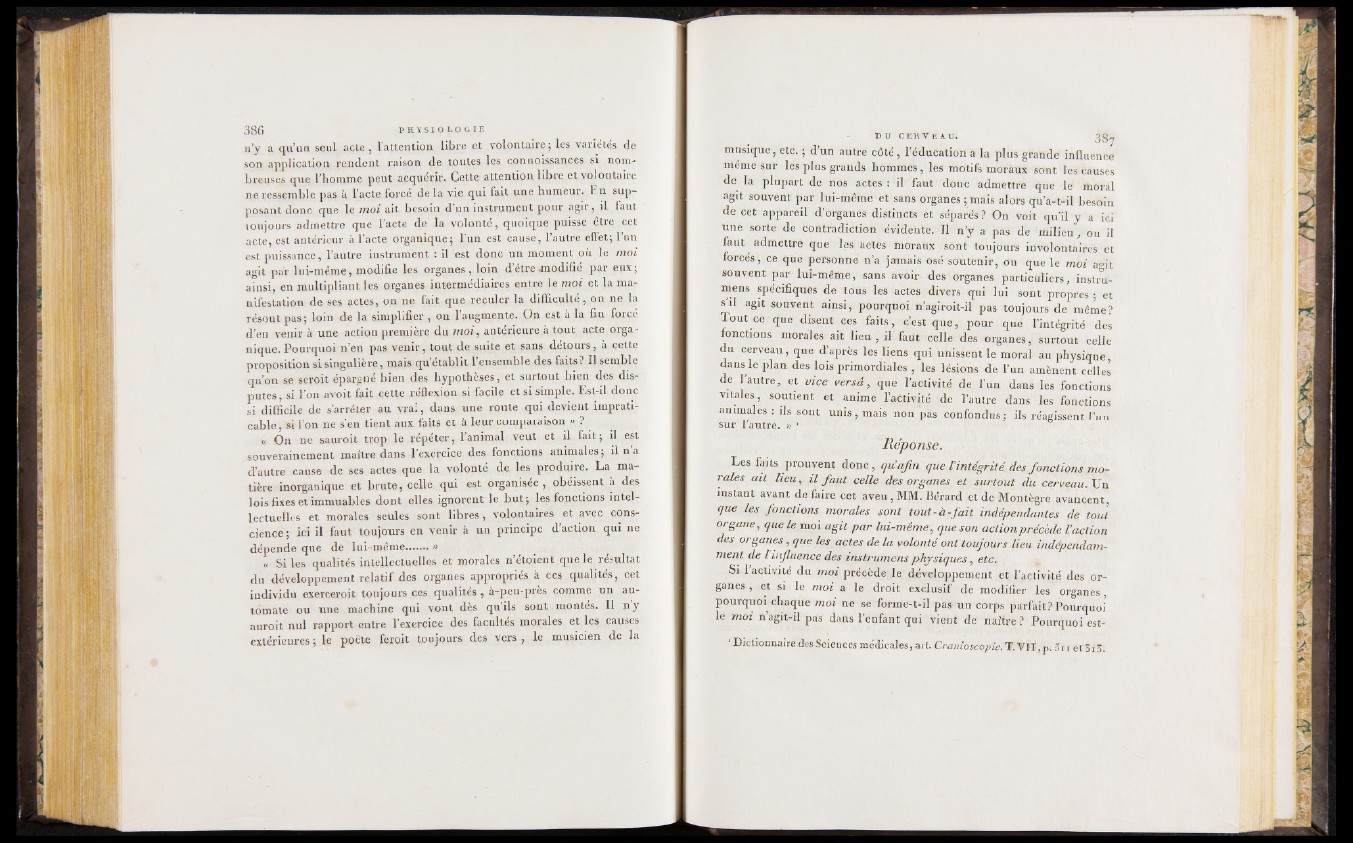
3 8 6 P H Y S I O L O G I E
n’y a qu’un seul acte 5 l’attention libre et volontaire, les variétés de
son application rendent raison de toutes les connoissances si nom-
breuses que l ’homme peut acquérir. Cette attention libre et volontaire
ne ressemble pas à l’acte forcé de la vie qui fait une humeur. Il n supposant
donc que le moi ait besoin d’un instrument pour agir, il faut
loujours admettre que l’acte de la volonté, quoique puisse être cet
acte, est antérieur à l’acte organique; l'un est cause, l’autre effet; l’un
est puissance, l’autre instrument : il est donc un moment où le moi
agit par lui-même, modifie les organes, loin d’être .modifié par eux;
ainsi, en multipliant les organes intermédiaires entre le moi et la manifestation
de ses actes, on ne fait que reeuler la difficulté, on ne la
résout pas; loin de la simplifier , on l’augmente. On est à la fin forcé
d’en venir à une action première du moi, anterieure atout acte organique.
Pourquoi n’en pas venir, tout de suite et sans détours, à çette
proposition si singulière, mais qu’établit l’ensemble des faits? Il semble
qu’on se seroit épargné bien des hypothèses, et surtout bien des disputes,
si l ’on avoit fait cette réflexion si facile et si simple. Est-il donc
si difficile de s’arrêter au vrai, dans une route qui devient impraticable
, si l’on ne s’en tient aux faits et à leur comparaison » ?
v On ne sauroit trop le répéter, 1 animal veut et il fait ; il est
souverainement maître dans l ’exercice des fonctions animales; il n a
d’autre cause de ses actes que la volonté de les produire. La matière
inorganique et brute, celle qui est organisée , obéissent à des
lois fixes et immuables dont elles ignorent le but; les fonctions intellectuelles
et morales seules .sont libres, volontaires et avec conscience
; ici il faut toujours en venir à un principe d’action qui ne
dépende que de lui-même....... »
« Si les qualités intellectuelles et morales n’étoient que le résultat
du développement relatif des organes appropries à ces qualités, cet
individu exerceroit toujours ces qualités , à-peu-près comme un automate
ou une machine qui vont des qu ils sont montes. Il n y
auroit nul rapport entre l’exercice des facultés morales et les causes
extérieures ; le poète feroit toujours des vers , le musicien de la
D U C EK V E AU . 3 g _
musique, etc. ; d’un autre côté, l’éducation a la plus grande influence
même sur les plus grands hommes, les motifs moraux sont les causes
de la plupart de nos actes : il faut donc admettre que le moral
agit souvent par lui-même et sans organes ; mais alors qu’a-t-il besoin
de cet appareil d’organés distincts et séparés ? On voit qu’il y a ici
une sorte de contradiction évidente. Il n’y a pas de milieu, ou il
faut admettre que les actes moraux sont toujours involontaires et
forcés, ce que personne n’a jamais osé soutenir, du que le moi agit
souvent par lui-même, sans avoir des organes particuliers, instru-
mens spécifiques de tous les actes divers qui lui sont propres ; et
ahl agit souvent ainsi, pourquoi n’agiroit-il pas toujours de même?
Tout ce que disent ces faits , c’est que , pour que l’intégrité des
onctions morales ait lieu, il faut celle des organes, surtout celle
du cerveau, que d’après les liens qui unissent le moral au physique
dans le plan des lois primordiales , les lésions de l’un amènent celles
de l ’autre, et vice versa, que l’activité de l’un dans les fonctions
vitales, soutient et anime l'activité de l’autre dans les fonctions
animales : ils sont unis, mais non pas confondus ; ils réagissent l ’un
sur l’autre. *.*■ '
Réponse.
Les faits prouvent donc, quajin que l ’intégrité des fonctions morales
ait lieu, il faut celle des organes et surtout du cerveau. Un
instant avant dé faire cet aveu, MM. Be’rard et de Montègre avancent,
que les fonctions morales sont tout-à-fait indépendantes de tout
organe, que le moi agit par lui-même, que son action précède l ’action
des organes, que les actes de la volonté ont toujours lieu indépendamment
de l influence des instrumens physiques, etc.
Si l activité du moi précède le développement et l’activité des organes
, et si le moi a le droit exclusif de modifier les organes,
pourquoi chaque moi ne se forme-t-il pas un corps parfait? Pourquoi
le moi n’agit-il pas dans l’enfant qui vient de naître? Pourquoi est-
‘ Dictionnaire des Sciences médicales, art. Cranioscopie. T. VII, p. ai r ét 3i3.
(*■
PK
N
f l
g«“
jsji