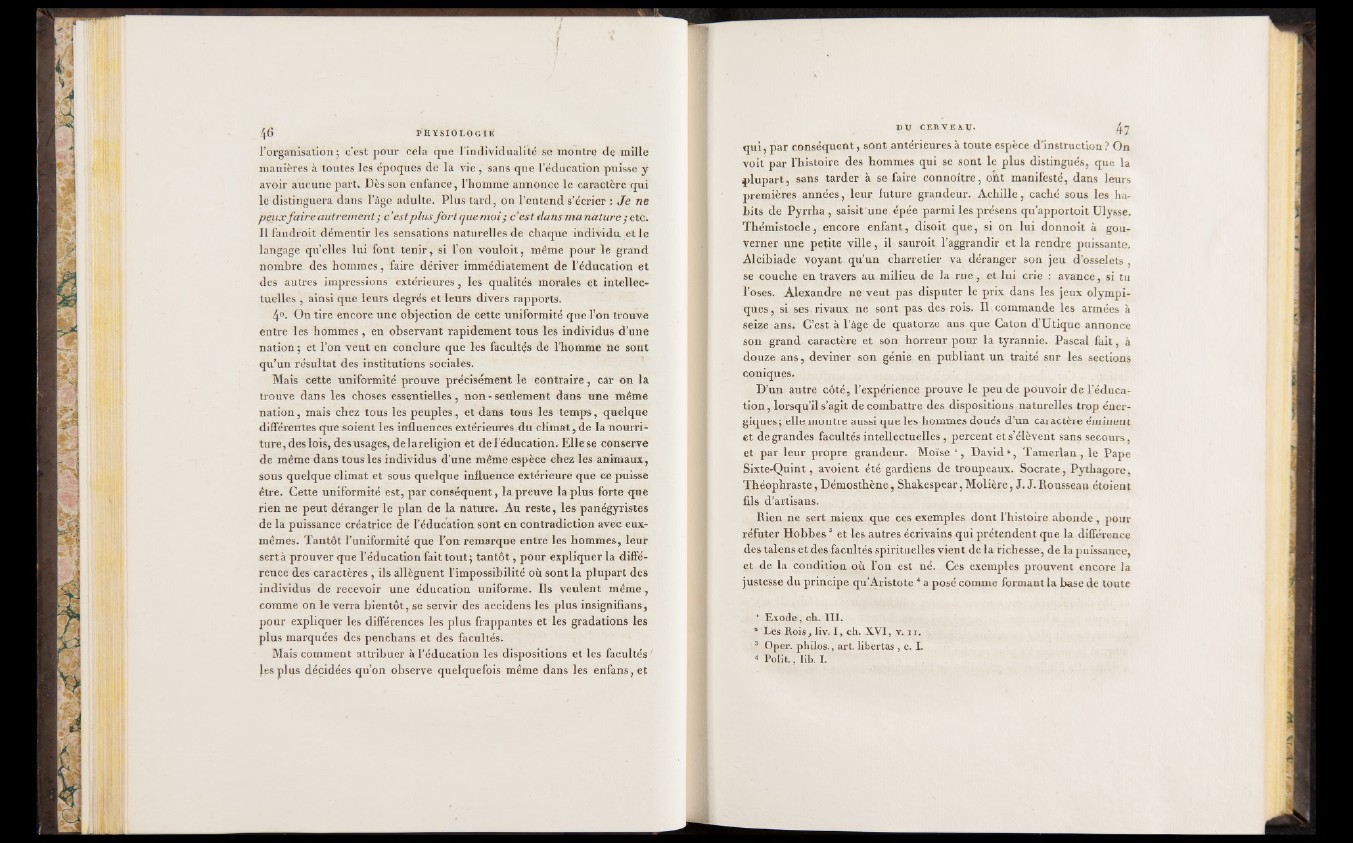
l’organisation; c’est pour cela que l ’individualité se montre de mille
manières à toutes les époques de la vie , sans que l’éducation puisse y
avoir aucune part. Dès son enfance, l’homme annonce le caractère qui
le distinguera dans l’àge adulte. Plus tard, on l’entend s’écrier : Je ne
peux faire autrement ; c’est plus fortquemoi; c’est dans ma nature ; etc..
Il faudrait démentir les sensations naturelles de chaque individu et le
langage qu’elles lui font tenir, si l’on vouloit, même pour le grand
nombre des hommes, faire dériver immédiatement de l’éducation et
des autres impressions extérieures, les qualités morales et intellect
tuelles , ainsi que leurs degrés et leurs divers rapports.
4°. On tire encore une objection de cette uniformité que Ton trouvé
entre les hommes , en observant rapidement tous les individus d’une
nation; et Ton veut en conclure que les facultés de l’homme ne sont
qu’un résultat des institutions sociales.
Mais cette uniformité prouve précisément le contraire, car on la
trouve dans les choses essentielles, non-seulement dans une même
nation, mais chez tous les peuples, et dans tous les temps, quelque
différentes que soient les influences extérieures du climat, de la nourriture,
des lois, des usages, de la religion et de l ’éducation. Elle se conserve
de même dans tous les individus d’une même espèce chez les animaux ,
sous quelque climat et sous quelque influence extérieure que ce puisse
être. Cette uniformité est, par conséquent, la preuve la plus forte que
rien ne peut déranger le plan de la nature. Au reste, les panégyristes
de la puissance créatrice de l’éducation sont en contradiction avec eux-
mêmes. Tantôt l’uniformité que Ton remarque entre les hommes, leur
sertà prouver que l’éducation fait tout; tantôt, pour expliquer la différence
des caractères , ils allèguent l’impossibilité où sont la plupart des
individus de recevoir une éducation uniforme. Ils veulent même ,
comme on le verra bientôt,se servir des accidens les plus insignifians,
pour expliquer les différences les plus frappantes et les gradations les
plus marquées des penchans et des facultés.
Mais comment attribuer à l’éducation les dispositions et les facultés
Jesplqs décidées qu’on observe quelquefois même dans les enfans, et
qui, par conséquent, sont antérieures à toute espèce d’instruction ? On
voit par l’histoire des hommes qui se sont le plus distingués, que la
plupart, sans tarder à se faire connoitre, ont manifesté, dans leurs
premières années, leur future grandeur. Achille, caché sous les habits
de Pyrrha , saisit une épée parmi les présens qu’apportoit Ulysse.
Thémistocle, encore enfant, disoit que, si on lui donnoit à gouverner
une petite ville, il saurait l’aggrandir et la rendre puissante.
Alcibiade voyant qu’un charretier va déranger son jeu d’osselets
se couche en travers au milieu de la rue, et lui crie : avance, si tu
l’oses. Alexandre ne veut pas disputer le prix dans les jeux olympiques,
si ses rivaux ne sont pas des rois. Il commande les armées à
seize ans. C’est à l’âge de quatorze ans que Caton d’Utique annonce
son grand caractère et son horreur pour la tyrannie. Pascal fait, à
douze ans, deviner son génie en publiant un traité sur les sections
coniques.
D’un autre côté, l’expérience prouve le peu de pouvoir de l’éducation
, lorsqu’il s’agit de combattre des dispositions naturelles trop énergiques;
elle montre aussi que les hommes doués d’un caractère éminent
et de grandes facultés intellectuelles, percent et s’élèvent sans secours,
et par leur propre grandeur. Moïse *, David*, Tamerlan, le Pape
Sixte-Quint, avoient été gardiens de troupeaux. Socrate, Pythagore,
Théophraste, Démosthène, Shakespear, Molière, J. J. Rousseau étoient
fils d’artisans.
Rien ne sert mieux que ces exemples dont l’histoire abonde, pour
réfuter Hobbes3 et les autres écrivains qui prétendent que la différence
des talens et des facultés spirituelles vient de la richesse, de la puissance,
et de la condition où Ton est né. Ces exemples prouvent encore la
justesse du principe qu’Aristote 4 a posé comme formant la base de toute
' Exode, ch. III.
* Les Rois, liv. I, ch. XVI, v. n .
3 Oper. philos., art. libertas , c. I.
4 Polit., lib. I.