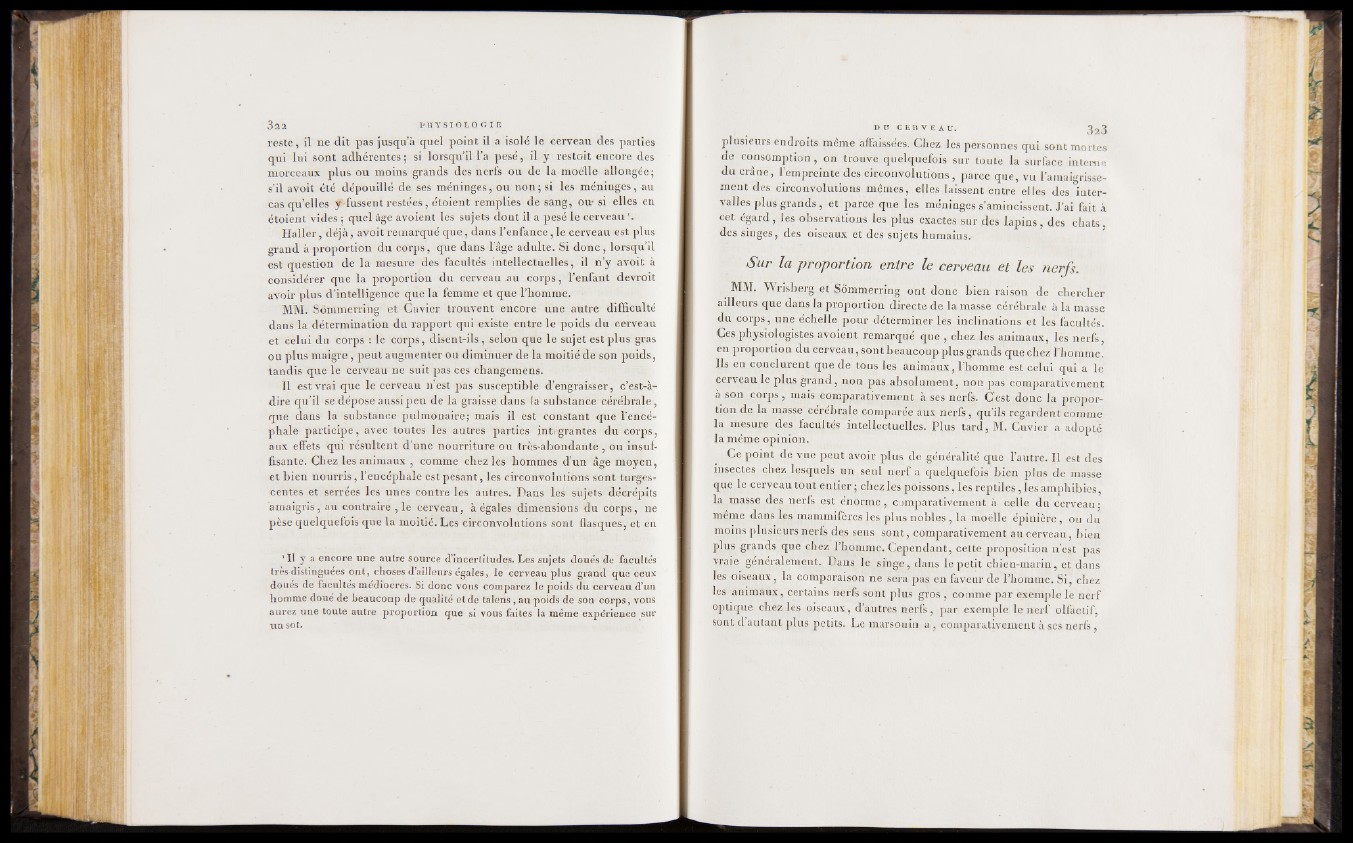
reste, il ne dit pas jusqu’à quel point il a isolé le cerveau des parties
qui lui sont adhérentes; si lorsqu’il l’a pesé, il y restoit encore des
morceaux plus ou moins grands des nerfs ou de la moelle allongée;
s’il avoit été dépouillé de ses méninges, ou non; si les méninges, au
cas quelles y-fussent restées, étoient remplies de sang, ou- si elles en
étoient vides ; quel âge avoient les sujets dont il a pesé le cerveau'.
Haller déjà, avoit remarqué que, dans l’enfance, le cerveau est plus
grand à proportion du corps, que dans l ’âge adulte. Si donc, lorsqu’il
est question de la mesure des facultés intellectuelles, il n’y avoit à
considérer que la proportion du cerveau .au corps, l’enfant devroit
avoir plus d’intelligence que la femme et que l’homme.
MM. Sômmerring et Cuvier trouvent encore une autre difficulté
dans la détermination du rapport qui existe entre le poids du cerveau
et celui du corps : le corps, disent-ils, selon que le sujet est plus gras
ou plus maigre, péut augmenter ou diminuer de la moitié de son poids,
tandis que le cerveau ne suit pas ces changemens.
Il est vrai que le cerveau n’est pas susceptible d’engraisser, c’est-à-
dire qu’il se dépose aussi peu de la graisse dans la substance cérébrale,
que dans la substance pulmonaire; mais il est constant que l’encéphale
participe, avec toutes les autres parties intégrantes du corps,
aux effets qui résultent d’une nourriture ou très-abondante , ou insuffisante.
Chez les animaux , comme chez les hommes d’un âge moyen,
et bien nourris, l’encéphale est pesant, les circonvolutions sont turges-
centes et serrées les unes contre les autres. Dans les sujets décrépits
amaigris, au contraire , le cerveau, à égales dimensions du corps, ne
pèse quelquefois que la moitié. Les circonvolutions sont flasques, et en
'11 y a encore une autre source d’incertitudes. Les sujets doue's de facultés
très-distinguees ont, choses d’ailleurs égales, le cerveau plus grand que ceux
doues de facultés médiocres. Si donc vous comparez le poids du cerveau d’un
homme doué de beaucoup de qualité et de talens, au poids de son corps, vous
aurez une toute autre proportion que si vous faites la même expe'rience sur
un sot.
plusieurs endroits meme affaissées. Chez les personnes qui sont mortes
de consomption , on trouve quelquefois sur toute la surface interne
du crâne, l’empreinte des circonvolutions, parce que, vu l’amaigrissement
des circonvolutions mêmes, elles laissent entre elles des intervalles
plus grands, et parce que les méninges s’amincissent. J’ai fait à
cet égard, les observations les plus exactes sur des lapins, des chats,
des singes, des oiseaux et des sujets humains.
Sur la proportion entre le cerveau et les nerfs.
MM. Wrisberg et Sômmerring ont donc bien raison de chercher
ailleurs que dans la proportion directe de la masse cérébrale à la masse
du corps, une échelle pour déterminer les inclinations et les facultés.
Ces physiologistes avoient remarqué que , chez les animaux, les nerfs,
en proportion du cerveau, sont beaucoup plus grands que chez l'homme.
Ils en conclurent que de tous les animaux, l’homme est celui qui a le
cerveau le plus grand, non pas absolument, non pas comparativement
à son corps, mais comparativement à ses nerfs. Cest donc la proportion
de la masse cérébrale comparée aux nerfs, qu’ils regardent comme
la mesure des facultés intellectuelles. Plus tard, M. Cuvier a adopté
la même opinion.
Ce point de vue peut avoir plus de généralité que l’autre. Il est des
insectes chez lesquels un seul nerf a quelquefois bien plus de masse
que le cerveau tout entier ; chez les poissons, les reptiles, les amphibies,
la masse des nerfs est énorme , comparativement à celle du cerveau •
meme dans les mammifères les plus nobles , la moelle épinière, ou du
moins plusieurs nerfs des sens sont, comparativement au cerveau, bien
plus grands que chez l’homme. Cependant, cette proposition n’est pas
vraie généralement. Dans le singe, dans le petit chien-marin, et dans
les oiseaux, la comparaison ne sera pas en faveur de l’homme. Si, chez
les animaux, certains nerfs sont plus gros , comme par exemple le nerf
optique chez les oiseaux, d’autres nerfs, par exemple le nerf olfactif,
sont d’autant plus petits. Le marsouin a , comparativement à ses nerfs,