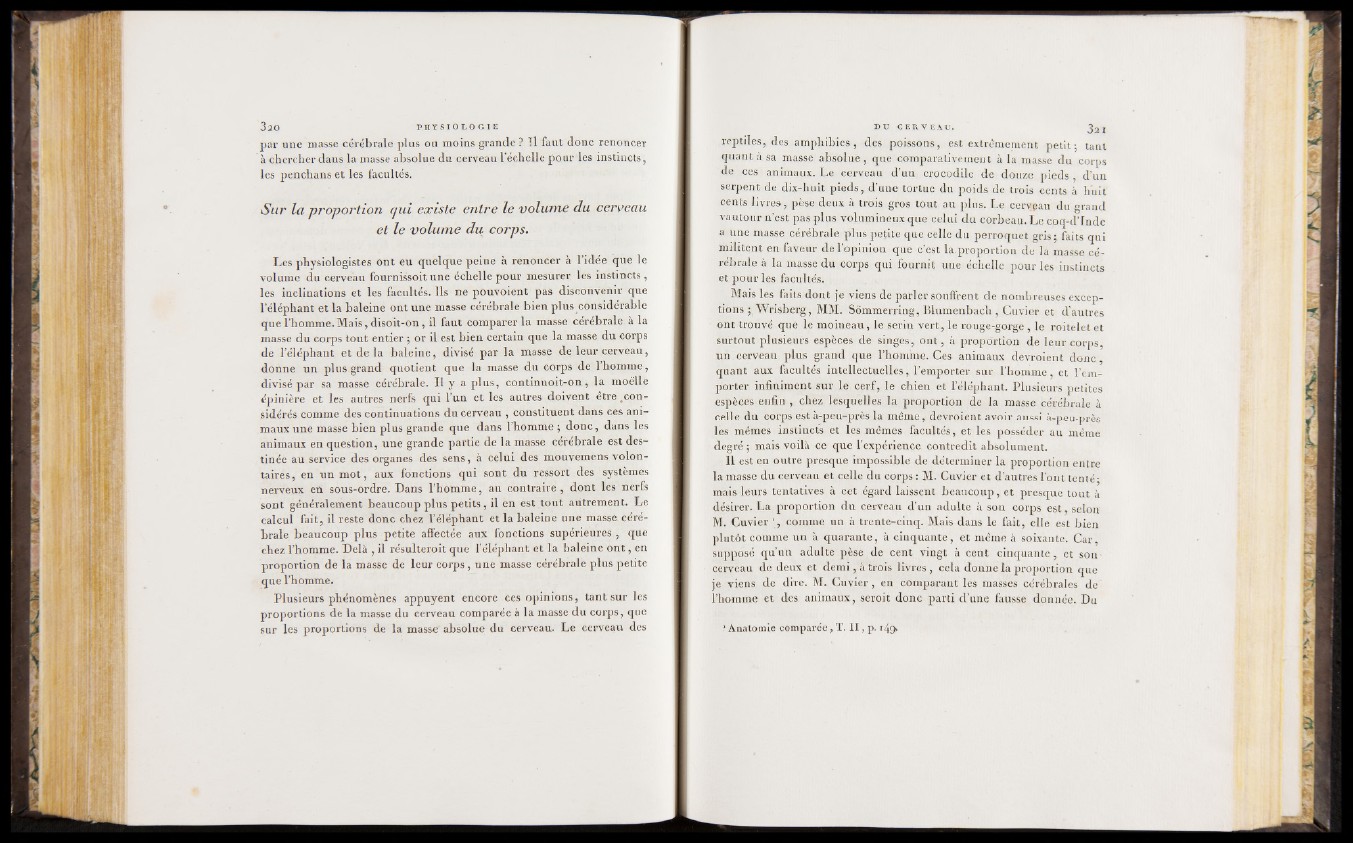
3 2 0 P H Y S I O L O G I E
par une masse cérébrale plus ou moins grande ? Tl faut donc renoncer
à chercher dans la masse absolue du cerveau l’échelle pour les instincts,
les penchans et les facultés.
Sur la proportion qui existe entre le volume du cerveau
et le volume du corps.
Les physiologistes ont eu quelque peine à renoncer à l’idée que le
volume du cerveau fournissoit une échelle pour mesurer les instincts,
les inclinations et les facultés. Ils ne pouvoient pas disconvenir que
l ’éléphant et la baleine ont une masse cérébrale bien plus considérable
que l’homme. Mais, disoit-on, il faut comparer la masse cerebrale à la
masse du corps tout entier ; or il est bien certain que la masse du corps
de l’éléphant et delà baleine, divisé par la masse de leur cerveau,
donne un plus grand quotient que la masse du corps de l’homme,
divisé par sa masse cérébrale. Il y a plus, continuoit-on, la moelle
épinière et les autres nerfs qui l’un et les autres doivent etre „considérés
comme des continuations du cerveau , constituent dans ces animaux
une masse bien plus grande que dans l’homme ; donc, dans les
animaux en question, une grande partie de la masse cérébrale est destinée
au service des organes des sens, à celui des mouvemens volon-
tairés, en un mot, aux fonctions qui sont du ressort des systèmes
nerveux en sous-ordre. Dans l’homme, au contraire , dont les nerfs
sont généralement beaucoup plus petits, il en est tout autrement. Le
calcul fait, il reste donc chez l’éléphant et la baleine une masse cérébrale
beaucoup plus petite affectée aux fonctions supérieures , que
chez l’homme. Delà , il résulterait que l’éléphant et la baleine ont, en
proportion de la masse de leur corps, une masse cérébrale plus petite
que l’homme.
Plusieurs phénomènes appuyent encore ces opinions, tant sur les
proportions de la masse du cerveau comparée à la masse du corps, que
sur les proportions de la masse' absolue du cerveau. Le cerveau des
reptiles, des amphibies, des poissons, est extrêmement petit; tant
quant à sa masse absolue , que comparativement à la masse du corps
de ces animaux. Le cerveau d’un crocodile de douze pieds , d’un
serpent de dix-huit pieds, d’une tortue du poids de trois cents à huit
cents livres, pèse deux à trois gros tout au plus. Le cerveau du grand
vautour n’est pas plus volumineux que celui du corbeau. Le coq-d’lnde
a une masse cérébrale plus petite que celle du perroquet gris; faits qui
militent en faveur de l’opinion que c’est la proportion de la masse cérébrale
à la masse du corps qui fournit une échelle pour les instincts
et pour les facultés. x
Mais les faits dont je viens de parler souffrent de nombreuses exceptions
j^Wrisberg, MM. Sômmerring, Blumenbach , Cuvier et d’autres
ont trouvé que le moineau, le serin vert, le rouge-gorge , le roitelet et
surtout plusieurs espèces de singes, ont, à proportion de leur corps,
un cerveau plus grand que l’homme. Ces animaux devroient donc
quant aux facultés intellectuelles, l’emporter sur l’homme, et l’emporter
infiniment sur le cerf, le chien et l’éléphant. Plusieurs petites
espèces enfin , chez lesquelles la proportion de la masse cérébrale à
celle du corps est à-peu-près la même, devroient avoir aussi à-peu-près
les mêmes instincts et les mêmes facultés, et les posséder au même
degré ; mais voilà ce que l’expérience contredit absolument.
11 est en outre presque impossible de déterminer la proportion entre
la masse du cerveau et celle du corps : M. Cuvier et d’autres l’ont tenté-
mais leurs tentatives à cet égard laissent beaucoup, et presque tout à
désirer. La proportion du cerveau d’un adulte à son corps est r selon
M. Cuvier ', comme un à trente-cinq. Mais dans le fait, elle est bien
plutôt comme un à quarante, à cinquante, et même à soixante. Car
supposé qu’un adulte pèse de cent vingt à cent cinquante, et son
cerveau de deux et demi, à trois livres , cela donne la proportion que
je viens de dire. M. Cuvier, en comparant les masses cérébrales de
l’homme et des animaux, serait donc parti d’une fausse donnée. Du
.* Anatomie comparée, T. I I , p. i4<>