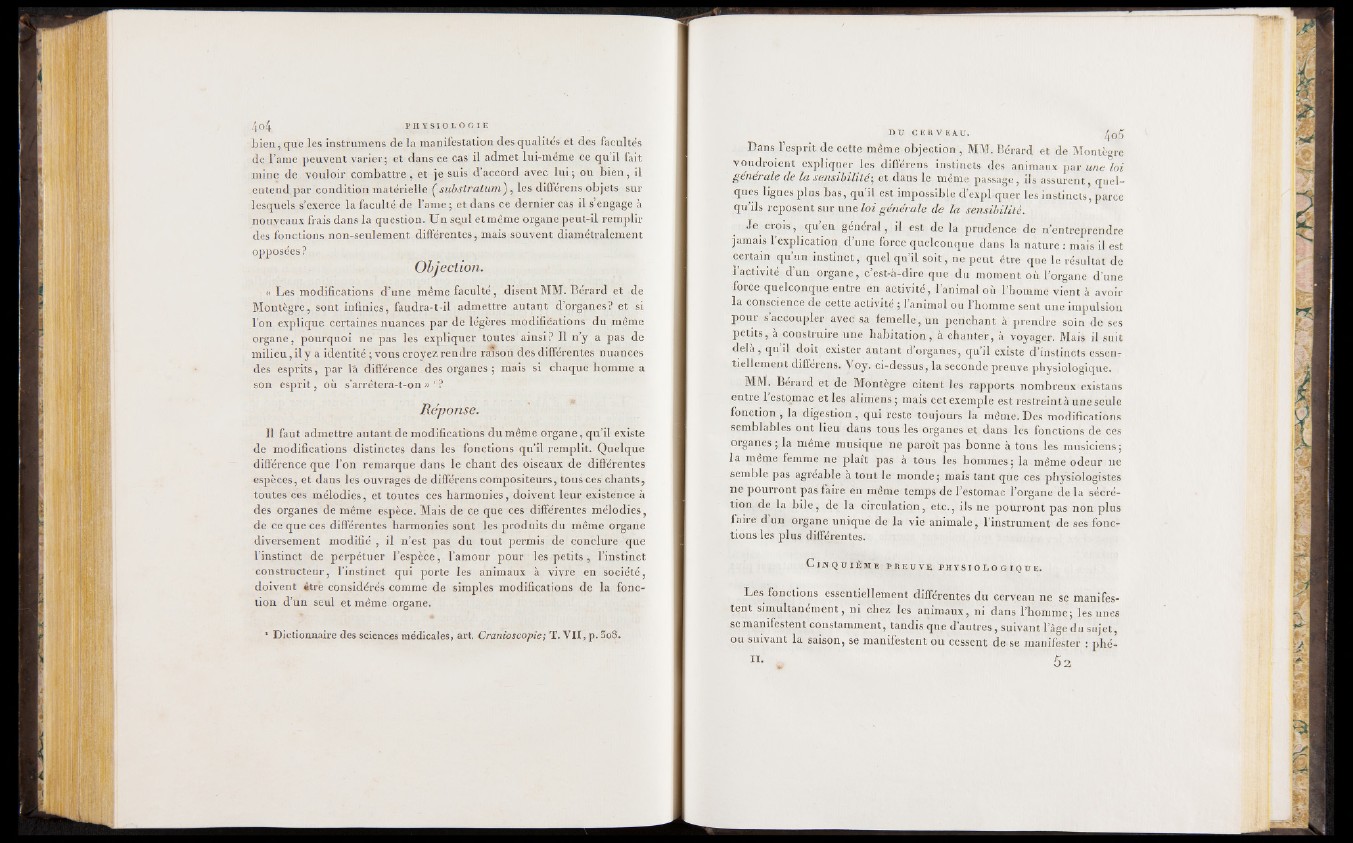
bien, que les instrumens de la manifestation des qualités et des facultés
de l’ame peuvent varier; et dans ce cas il admet lui-même ce qu’il fait
mine de vouloir combattre , et je suis d’accord avec lui ; ou bien, il
entend, par condition matérielle ( substratum}, les différens objets sur
lesquels s’exerce la faculté de l’ame; et dans ce dernier cas il s’engage à
nouveaux frais dans la question. Un sç,ul etmême organe peut-il remplir
des fonctions non-seulement différentes, mais souvent diamétralement
opposées?
Objection.
« Les modifications d’une même faculté, disent MM. Bérard et de
Montègre, sont infinies, faudra-t-il admettre autant d’organes? et si
l ’on explique certaines nuances par de légères modifiéations du même
organe, pourquoi ne pas les expliquer toutes ainsi? Il n’y a pas de
milieu, il y a identité ; vous croyez rendre rÉuson des différentes nuances
des esprits, par la différence des organes ; mais si chaque homme a
son esprit, où s’arrétera-t-on i> ' ?
Réponse.
Il faut admettre autant de modifications du même organe, qu’il existe
de modifications distinctes dans les fonctions qu’il remplit. Quelque
différence que l’on remarque dans le chant des oiseaux de différentes
espèces, et dans les ouvrages de différens compositeurs, tous ces chants,
toutes ces mélodies, et toutes ces harmonies, doivent leur existence à
des organes de même espèce. Mais de ce que ces différentes mélodies,
de ce que ces différentes harmonies sont les produits du même organe
diversement modifié , il n’est pas du tout permis de conclure que
l’instinct de perpétuer l ’espèce, l’amour pour les petits , l’instinct
constructeur, l’instinct qui porte les animaux à vivre en société,
doivent être considérés comme de simples modifications de la fonction
d’un seul et même organe,
B Dictionnaire des sciences médicales, art. Cranioscopie; X. V I I , p. 3o8.
D U C E R V E A U . ^ 0 5
Dans l’esprit de cette même objection , MM. Bérard et de Montègre
voudroient expliquer les différens instincts des animaux par une loi
générale de la sensibilité; et dans le même passage, ils assurent, quelques
lignes plus bas, qu’il est impossible d’expl quer les instincts, parce
qu’ils reposent sur une loi générale de la sensibilité.
Je crois, qu en général, il est de la prudence de n’entreprendre
jamais l’explication d’une force quelconque dans la nature : mais il est
certain qu’un instinct, quel qu’il soit, ne peut être que le résultat de
1 activité dun organe, c’est-à-dire que du moment où l’organe d’une
■ force quelconque entre en activité, l’animal où l ’homme vient à avoir
la conscience de cette activité ; l’animal ou l’homme sent une impulsion
pour s’accoupler avec sa femelle, un penchant à prendre soin de ses
petits, a construire une habitation, à chanter, à voyager. Mais il suit
delà, qu il doit exister autant d organes, qu’il existe d’instincts essentiellement
différens. Voy. ci-dessus, la seconde preuve physiologique.
MM. Bérard et de Montègre citent les rapports nombreux existans
entre 1 estomac et les alimens ; mais cet exemple est restreint à une seule
fonction , la digestion , qui reste toujours la même. Des modifications
semblables ont lieu dans tous les organes et dans les fonctions de ces
organes ; la même musique ne paroît pas bonne à tous les musiciens ;
la meme femme ne plaît pas a tous les hommes; la même odeur ne
semble pas agréable à tout le monde; mais tant que ces physiologistes
ne pourront pas faire en même temps de l’estomac l’organe de la sécrétion
de la bile, de la circulation, etc., ils ne pourront pas non plus
faire d’un organe unique de la vie animale, l’instrument de ses fonctions
les plus différentes.
C i n q u i è m e p r e u v e p h y s i o l o g i q u e .
Les fonctions essentiellement différentes du cerveau ne se manifestent
simultanément, ni chez les animaux, ni dans l’homme; les unes
se manifestent constamment, tandis que d’autres, suivant l’âge du sujet,
ou suivant la saison, se manifestent ou cessent de se manifester : phé-
II. . K ^
è m \
a s