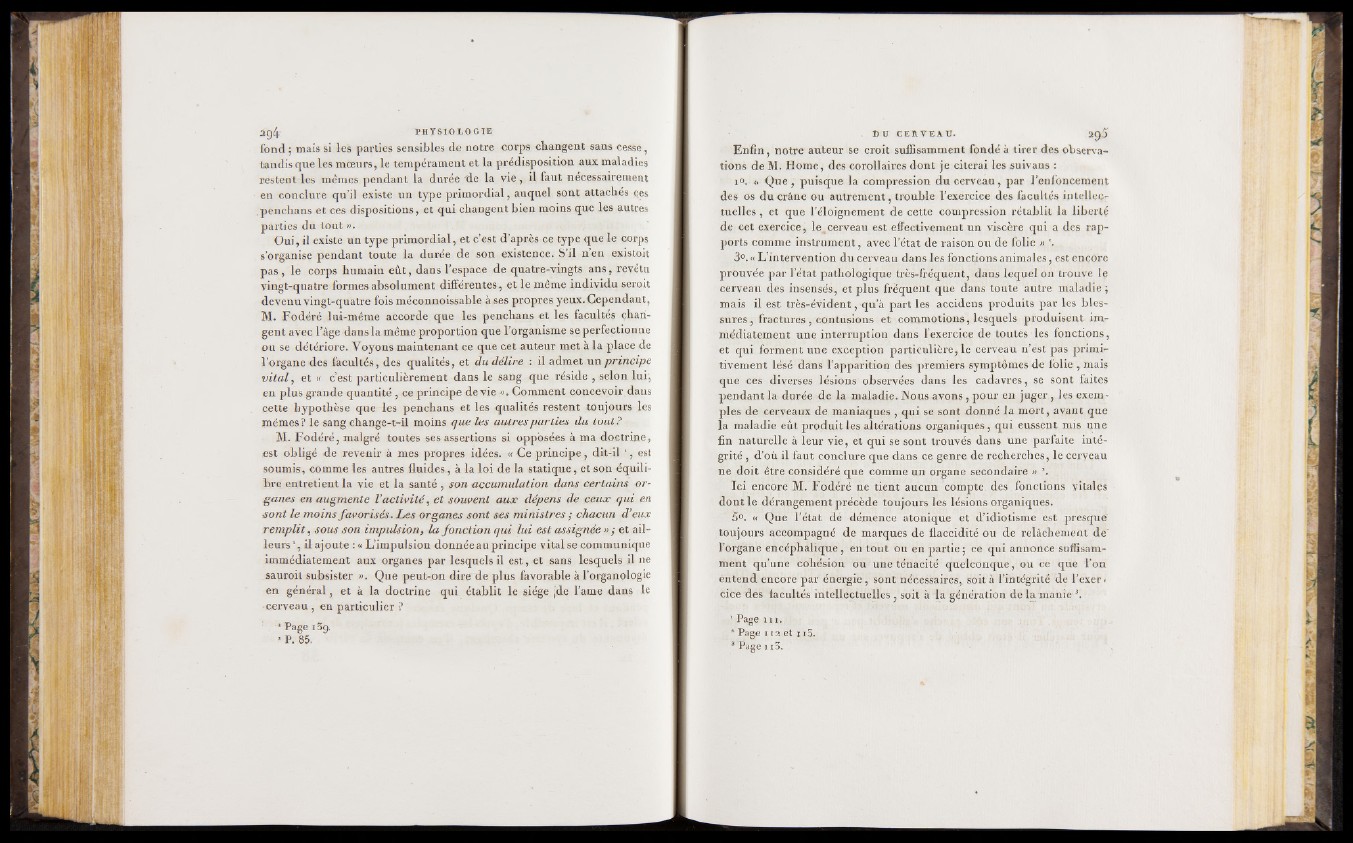
fond ; mais si les parties sensibles de notre corps changent sans cesse,
tandis que les moeurs, le tempérament et la prédisposition aux maladies
restent les mêmes pendant la durée île la vie , il faut nécessairement
en conclure qu’il existe un type primordial, auquel sont attachés ces
penchans et ces dispositions, et qui changent bien moins que les autres
parties du tout »,
Oui, il existe un type primordial, et c’est d’après ce type que le corps
s’organise pendant toute la durée de son existence. S’il n’en existoit
pas, le corps humain eût, dans l’espace de quatre-vingts ans, revêtu
vingt-quatre formes absolument différentes, et le même individu seroit
devenu vingt-quatre fois méconnoissable à ses propres yeux. Cependant,
M. Fodéré lui-même accorde que les penchans et les facultés changent
avec l’âge dans la même proportion que l’organisme se perfectionne
ou se détériore. Voyons maintenant ce que cet auteur met à la place de
l ’organe des facultés, des qualités, et du délire : il admet un principe
vital, et « c’est particulièrement dans le sang que réside , selon lui;
en plus grande quantité , ce principe de vie ». Comment concevoir dans
cette hypothèse que les penchans et les qualités restent toujours les
mêmes? le sang change-t-il moins que les autres parties du tout?
M. Fodéré, malgré toutes ses assertions si opposées à ma doctrine,
est obligé de revenir à mes propres idées. « -Ce principe, dit-il 1, est
soumis, comme les autres fluides., à la loi de la statique, et son équilibre
entretient la vie et la santé, son accumulation dans certains organes
en augmente l’activité, et souvent aux dépens de ceux qui en
sont le moins favorisés. Les organes sont ses ministres ; chacun d’eux
remplit, sous son impulsion, la fonction qui lui est assignée » ; et ailleurs
’ , il ajoute : « L’impulsion donnée au principe vital se communique
immédiatement aux organes par lesquels il est, et sans lesquels il ne
sauroit subsister ». Que peut-on dire de plus favorable à l’organologie
en général, et à la doctrine qui établit le siège jde l’ame dans le
• cerveau , en particulier ?
* Page i 3g.
» P. 85.
Enfin, notre auteur se croit suffisamment fondé à tirer des observations
de M. Home, des corollaires dont je citerai les suivans :
i°. « Que, puisque la compression du cerveau, par l’enfoncement
des os du crâne ou autrement, trouble l’exercice des facultés intellectuelles
, et que l’éloignement de cette compression rétablit la liberté
de cet exercice, le^cerveau est effectivement un viscère qui a des rapports
comme instrument, avec l’état de raison ou de folie » '.
3°. « L’intervention du cerveau dans les fonctions animales, est encore
prouvée par l’état pathologique très-fréquent, dans lequel on trouve le
cerveau des insensés, et plus fréquent que dans toute autre maladie ;
mais il est très-évident, qu’à part les accidens produits par les blessures
, fractures, contusions et commotions, lesquels produisent immédiatement
une interruption dans l’exercice de toutes les fonctions,
et qui forment une exception particulière, le cerveau n’est pas primitivement
lésé dans l’apparition des premiers symptômes de folie , mais
que ces diverses lésions observées dans les cadavres, se sont faites
pendant la durée de la maladie. Nous avons, pour en juger , les exemples
de cerveaux de maniaques , qui se sont donné la mort, avant que
la maladie eût produit les altérations organiques, qui eussent mis une
fin naturelle à leur vie, et qui se sont trouvés dans une parfaite intégrité
, d’où il faut conclure que dans ce genre de recherches, le ceryeau
ne doit être considéré que comme un organe secondaire » *.
Ici encore M. Fodéré ne tient aucun compte des fonctions vitales
dont le dérangement précède toujours les lésions organiques.
5°. « Que l ’état dé démence atonique et d’idiotisme est presque'
toujours accompagné de marques de flaccidité ou de relâchement dé'
l’organe encéphalique, en tout ou en partie ; ce qui annonce suffisamment
qu’une cohésion ou une ténacité quelconque, ou ce que l ’on
entend encore par énergie , sont nécessaires, soit à l’intégrité de l’exer.
cice des facultés intellectuelles, soit à la génération de la manie 3.
1 Page n i .
* Page 1 12 et 1 13.
3 Page 113.