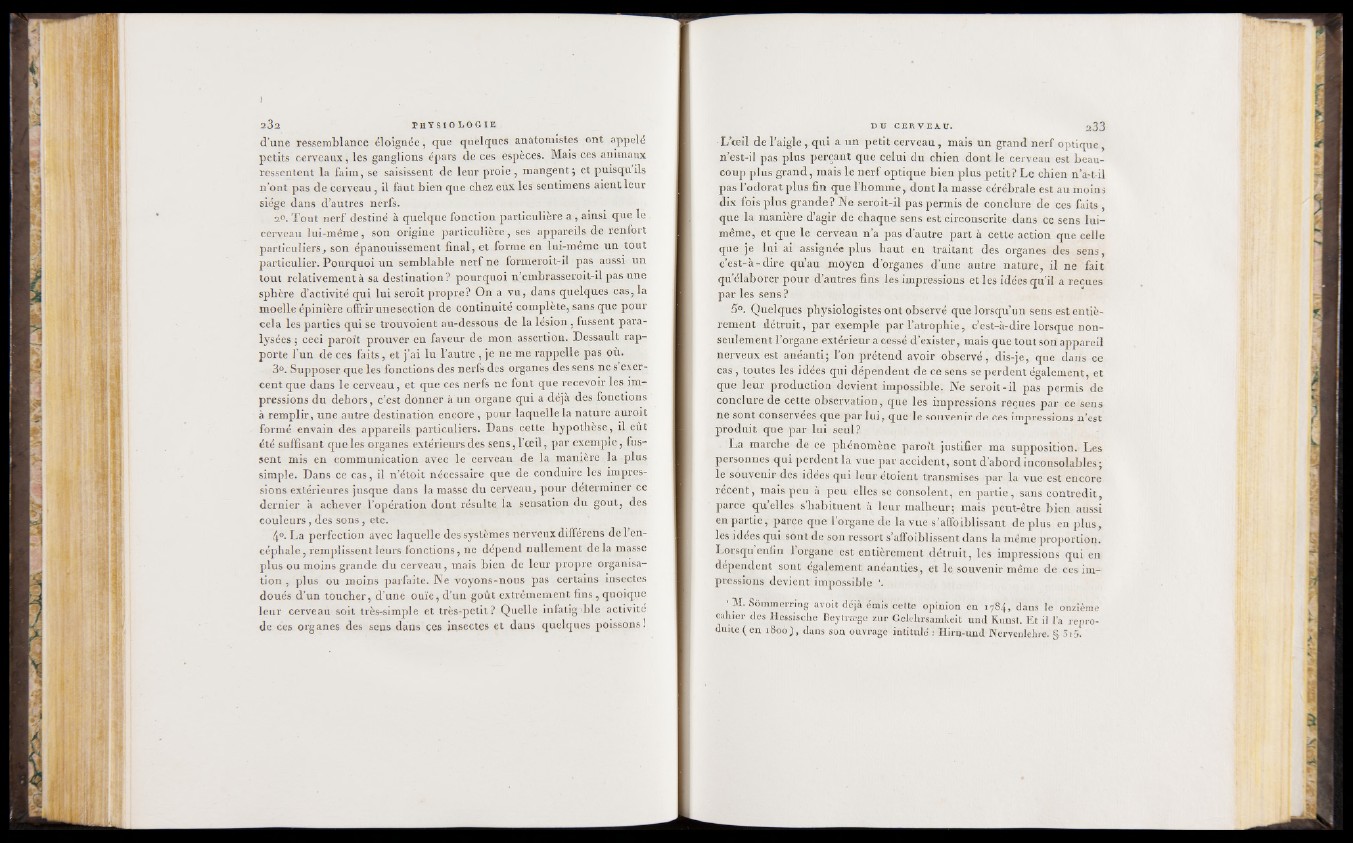
d’une ressemblance éloignée, que quelques anatomistes ont appelé
petits cerveaux, les ganglions épars de ces espèces. Mais ces animaux
ressentent la faim, se saisissent de leur proie , mangent; etpuisqjiils
n’ont pas de cerveau, il faut bien que chez eux les sentimens aient leur
siège dans d’autres nerfs.
2°. Tout nerf destiné à quelque fonction particulière a , ainsi que le
cerveau lui-même, son origine particulière, ses appareils de renfort
particuliers, son épanouissement final, et forme en lui-même un tout
particulier. Pourquoi un semblable nerf ne formeroit-il pas aussi un
tout relativement à sa destination? pourquoi n’embrasseroit-il pas une
sphère d’activité qui lui seroit propre? On a vu, dans quelques cas, la
moelle épinière offrir une section de continuité complète, sans que pour
cela les parties qui se trouvoient au-dessous de la lésion, fussent paralysées
; ceci paroît prouver en faveur de mon assertion. Dessault rapporte
l’un de ces faits, et j’ai lu l'autre , je ne me rappelle pas où.
3°. Supposer que les fonctions des nerfs des organes des sens ne s exercent
que dans le cerveau, et que ces nerfs ne font que recevoir les impressions
du dehors, c’est donner à un organe qui a déjà des fonctions
à remplir, une autre destination encore, pour laquelle la nature auroit
formé envain des appareils particuliers. Dans cette hypothèse, il eut
été suffisant que les organes extérieurs des sens, l’oeil, par exemple, fussent
mis en communication avec le cerveau de la manière la plus
simple. Dans ce cas, il n’étoit nécessaire que de conduire les impressions
extérieures jusque dans la masse du cerveau, pour déterminer ce
dernier à achever l ’opération dont résulte la sensation du goût, des
couleurs, des sons , etc.
4°. La perfection avec laquelle des systèmes nerveux différens de l’encéphale,
remplissent lëurs fonctions, ne dépend nullement delà masse
plus ou moins grande du cerveau, mais bien de leur propre organisation
, plus ou moins parfaite. Ne voyons-nous pas certains insectes
doués d’un toucher, d’une ouïe, d’un goût extrêmement fins, quoique
leur cerveau soit très-simple et très-petit? Quelle infatigable activité
de ces organes des sens dans ces insectes et dans quelques poissons!
■ L’oeil de l’aigle, qui a un petit cerveau , mais un grand nerf optique,
n’est-il pas plus perçant que celui du chien dont le cerveau est beaucoup
plus grand, mais le nerf optique bien plus petit? Le chien n’a-t-il
pas l’odorat plus fin que l’homme, dont la masse cérébrale est au moins
dix fois plus grande? Ne seroit-il pas permis de conclure de ces faits ,
que la manière d’agir de chaque sens est circonscrite dans ce sens lui-
même, et que le cerveau n’a pas d’autre part à cette action que celle
que je lui ai assignée plus haut en traitant des organes des sens,
c’est-à-dire qu’au moyen d’organes d’une autre nature, il ne fait
qu’élaborer pour d’autres fins les impressions et les idées qu’il a reçues
par les sens ?
5°. Quelques physiologistes ont observé que lorsqu’un sens est entièrement
détruit, par exemple par l’atrophie, c’est-à-dire lorsque non-
seulement l’organe extérieur a cessé d’exister, mais que tout son appareil
nerveux est anéanti; l’on prétend avoir observé, dis-je, que dans ce
cas, toutes les idées qui dépendent de ce sens se perdent également, et
que leur production devient impossible. Ne seroit-il pas permis de
conclure de cette observation, que les impressions reçues par ce sens
ne sont conservées que par lui, que le souvenir de ces impressions n’est
produit que par lui seul?
La marche de ce phénomène paroît justifier ma supposition. Les
personnes qui perdent la vue par accident, sont d’abord inconsolables;
le souvenir des idees qui leur etoienl transmises par la vue est encore
recent, mais peu à peu elles se consolent, en partie, sans contredit,
parce qu’elles s’habituent à leur malheur; mais peut-être bien aussi
en partie, parce que 1 organe de la vue s’affaiblissant déplus en plus,
les idees qui sont de son ressort s affoiblissent dans la même proportion.
Lorsqu enfin 1 organe est entièrement détruit, les impressions qui en
dépendent sont également anéanties, et le souvenir même de ces impressions
devient impossible *.
1 M. Sômmerring avoit déjà émis cette opinion en 1784, dans le onzième
cahier des Hessische Beytræge zur Gelehrsamkeit und Kunst. Et il l’a reproduite
(en 1806), dans son ouvrage intitulé : Hirn-und Nervenlehre. § 5i5.