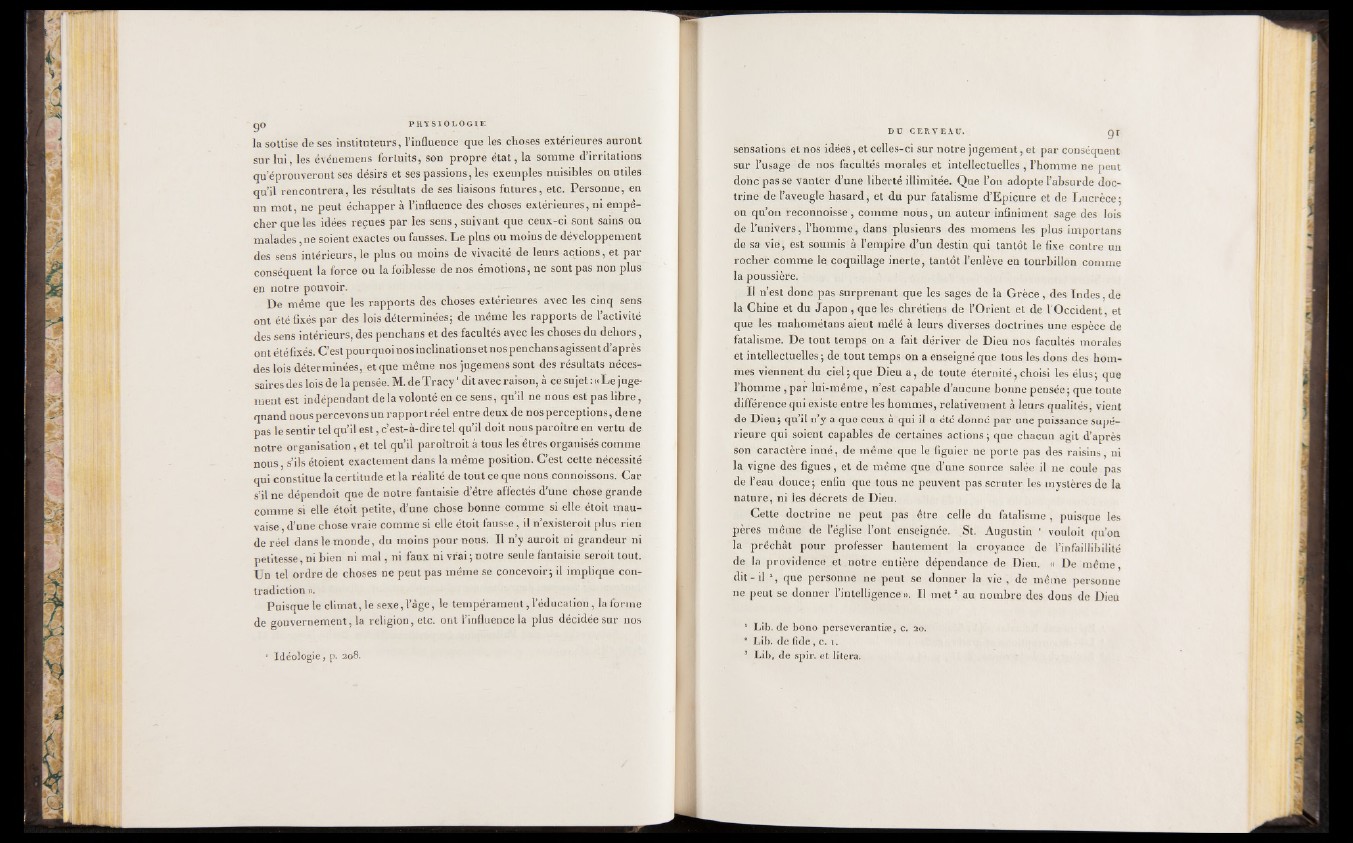
la sottise de ses instituteurs, l’influence que les choses extérieures auront
sur lui, les événemens fortuits, son propre état, la somme d’irritations
qu’éprouveront ses désirs et ses passions, les exemples nuisibles ou utiles
qu’il rencontrera, les résultats de ses liaisons futures, etc. Personne, en
un mot, ne peut échapper à l’influence des choses extérieures, ni empêcher
que les idées reçues par les sens, suivant que ceux-ci sont sains ou
malades, ne soient exactes ou fausses. Le plus ou moins de développement
des sens intérieurs, le plus ou moins de vivacité de leurs actions, et par
conséquent la foi-ce ou lafoiblesse de nos émotions, ne sont pas non plus
en notre pouvoir.
De même que les rapports des choses extérieures avec les cinq sens
ont été fixés par des lois déterminées; de même les rapports de l’activité
des sens intérieurs, des penchans et des facultés avec les choses du dehors,
ont étéfixés. C’est pourquoi nos inclinationsetnospenchans agissent d’après
des lois déterminées, et que même nos jugemens sont des résultats nécessaires
des lois de la pensée. M. de Tracy ' dit avec raison, à ce sujet : « Le jugement
est indépendant de la volonté en ce sens, qu’il ne nous est pas libre,
quand nous percevons un rapport réel entre deux de nos perceptions, de ne
pas le sentir tel qu’il est, c’est-à-dire tel qu’il doit nous paroître en vertu de
notre organisation, et tel qu’il paroîtroit à tous les êtres organisés comme
nous, s’ils étoient exactement dans la même position. C’est cette nécessité
qui constitue la certitude et la réalité de tout ce que nous connoissons. Car
s’il ne dépendoit que de notre fantaisie d’être affectés d’une chose grande
comme si elle étoit petite, d’une chose bonne comme si elle étoit mauvaise
d’une chose vraie comme si elle étoit fausse, il n’existeroit plus rien
de réel dans le monde, du moins pour nous. Il n’y auroit ni grandeur ni
petitesse, ni bien ni mal, ni faux ni vrai ; notre seule fantaisie seroit tout.
Un tel ordre de choses ne peut pas même se concevoir; il implique contradiction
».
Puisque le climat, le sexe, l’âge, le tempérament, l’éducalion, la forme
de gouvernement, la religion, etc. ont l’influence la plus décidée sur nos
* Idéologie, p. 208.
sensations et nos idées, et celles-ci sur notre jugement, et par conséquent
sur l’usage de nos facultés morales et intellectuelles , l’homme ne peut
donc passe vanter d’une liberté illimitée. Que l’on adopte l’absurde doctrine
de l’aveugle hasard, et du pur fatalisme d’Epicure et de Lucrèce ;
ou qu’on reconnoisse, comme nous, un auteur infiniment sage des lois
de l’univers, l’homme, dans plusieurs des momens les plus importans
de sa vie, est soumis à l’empire d’un destin qui tantôt le fixe contre un
rocher comme le coquillage inerte, tantôt l’enlève en tourbillon comme
la poussière.
Il n’est donc pas surprenant que les sages de la Grèce , des Indes, de
la Chine et du Japon, que les chrétiens de l’Orient et de 1 Occident, et
que les mahométans aient mêlé à leurs diverses doctrines une espèce de
fatalisme. De tout temps on a fait dériver de Dieu nos facultés morales
et intellectuelles ; de tout temps on a enseigné que tous les dons des hommes
viennent du ciel; que Dieu a , de toute éternité, choisi les élus; que
l’homme , par lui-même, n’est capable d’aucune bonne pensée; que toute
différence qui existe entre les hommes, relativement à leurs qualités, vient
de Dieu; qu’il n’y a que ceux à qui il a été donné par une puissance supérieure
qui soient capables de certaines actions ; que chacun agit d’après
son caractère inné, de même que le figuier ne porte pas des raisins, ni
la vigne des figues, et de même que d’une source salée il ne coule pas
de l’eau douce; enfin que tous ne peuvent pas scruter les mystères de la
nature, ni les décrets de Dieu.
Cette doctrine ne peut pas être celle du fatalisme , puisque les
pères même de l’église l’ont enseignée. St. Augustin 1 vouloit qu’on
la prêchât pour professer hautement la croyance de l’infaillibilité
de la providence et notre entière dépendance de Dieu. « De même
dit-il *, que personne ne peut se donner la vie , de même personne
ne peut se donner l’intelligence ». Il met1 au nombre des dons de Dieu
1 Lib. de bono perseverantiæ, c. 20.
* Lib. de fide , c. 1.
3 Lib, de spir. et litera*