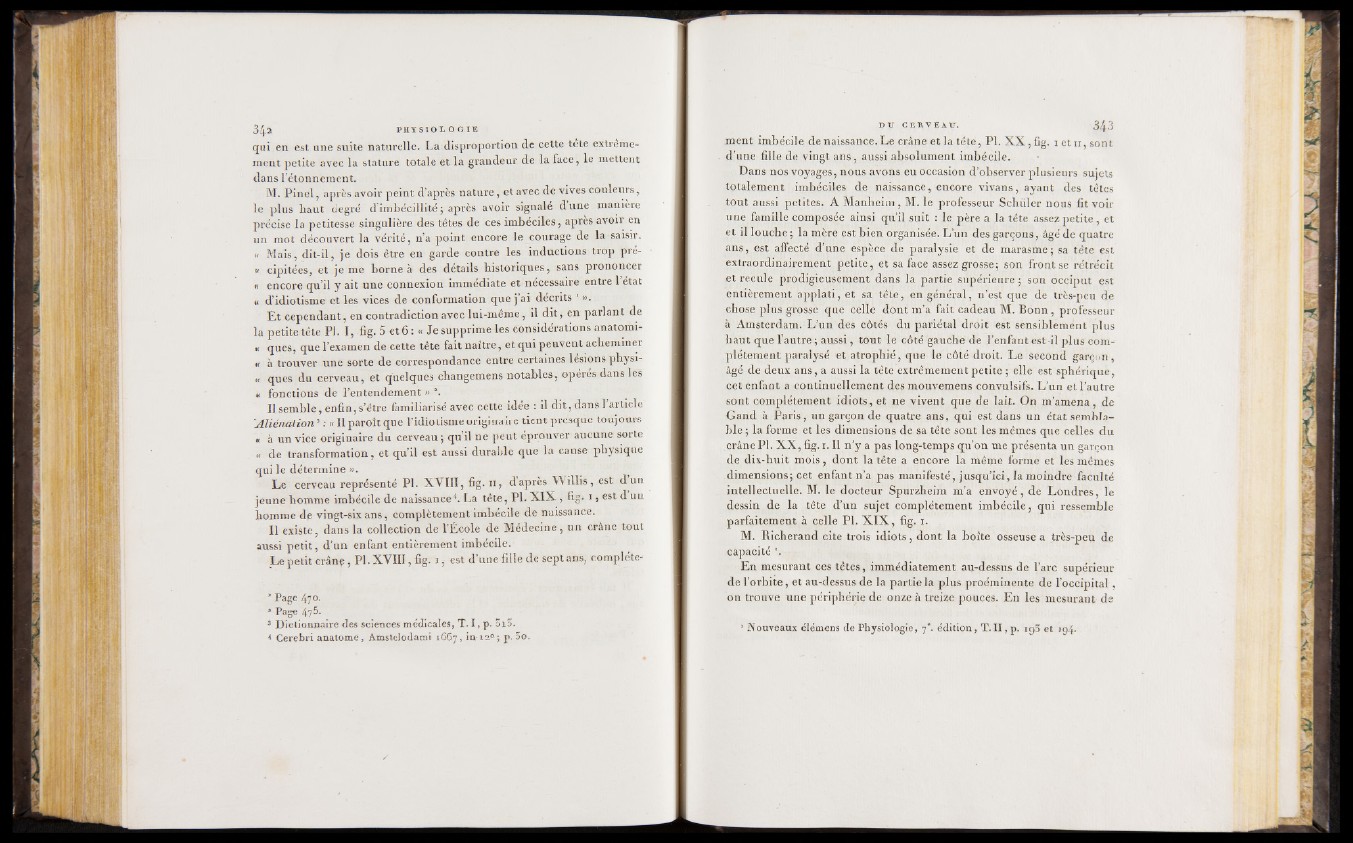
342 PHYSIOLOGIE
qui en est une suite naturelle. La disproportion de cette tete extrêmement
petite avec la stature totale et la grandeur de la face, le mettent
dans l’étonnement.
M. Pinel, après avoir peint d’après nature, et avec de vives couleurs,
le plus haut degré d imbécillité ; après avoir signalé dune maniéré
précise la petitesse singulière des têtes de ces imbéciles, après avoir en
un mot découvert la vérité, n’a point encore le courage de la saisir.
« Mais, dit-il, je dois être en garde contre les inductions trop pré-
« cipitées, et je me borne à des détails historiques, sans prononcer
« encore qu’il y ait une connexion immédiate et necessaire entre létat
« d’idiotisme et les vices de conformation que j’ai décrits ' ».
Et cependant, en contradiction avee lui-même, il dit, en parlant de
la petite tête PI. I, fig. 5 et6: « Jesupprime les considérations anatomi-
« ques, que l’examen de cette tête fait naître, et qui peuvent acheminer
« à trouver une sorte de correspondance entre certaines lésions physi-
« ques du cerveau, et quelques cbangemens notables, opérés dans les
k fonctions de l’entendement » \
Il semble, enfin, s’être familiarisé avee cette idée : il dit, dans 1 article
'Aliénation3 : « Il paroît que l’idiotisme originaire tient presque toujours
k à un vice originaire du cerveau ; qu’il ne peut éprouver aucune sorte
« de transformation, et qu’il est aussi durable que la cause physique
qui le détermine».
Le cerveau représenté PI. XVIII, fig. n , d après W illis, est dun
jeune homme imbécile de naissance4. La tête, PI. X IX , fig. i , est d un
homme de vingt-six ans, complètement imbécile de naissance.
11 existe, dans la collection de l’École de Médecine, un crâne tout
aussi petit, d’un enfant entièrement imbécile.
Le petit crâne, PI- XVIII, fig. i , est d’une fille de sept ans, eompléte-
* Page 47 o.
* Page 475- _
3 Dictionnaire des sciences médicales, T. I , p. 5i3.
i Cerebri anatome, Àmstclodami 1667, i n 12° ; p. 3o.
ment imbécile de naissance. Le crâne et la tête, PI. X X , fig. 1 et n , sont
d’une fille de vingt ans, aussi absolument imbécile.
Dans nos voyages, nous avons eu occasion d’observer plusieurs sujets
totalement imbéciles de naissance, encore vivans, ayant des têtes
tout aussi petites. A Manheim, M. le professeur Schüler nous fit voir
une famille composée ainsi qu’il suit : le père a la tête assez petite, et
et il louche ; la mère est bien organisée. L ’un des garçons, âgé de quatre
ans, est affecté d’une espèce de paralysie et de marasme ; sa tête est
extraordinairement petite, et sa face assez grosse; son front se rétrécit
et recule prodigieusement dans la partie supérieure ; son occiput est
entièrement applati, et sa tête, en général, n’est que de très-peu de
chose plus grosse que celle dont m’a fait cadeau M. Bonn , professeur
à Amsterdam. L’un des côtés du pariétal droit est sensiblement plus
haut que l’autre ; aussi, tout le côté gauche de l ’enfant est il plus complètement
paralysé et atrophié, que le côté droit. Le second garçon,
âgé de deux ans, a aussi la tête extrêmement petite ; elle est sphérique,
cet enfant a continuellement des mouvemens convulsifs. L ’un et l ’autre
sont complètement idiots, et ne vivent que de lait. On m’amena, de
Gand à Paris, un garçon de quatre ans, qui est dans un état semblable
; la forme et les dimensions de sa tête sont les mêmes que celles du
crâne PI. XX, fig. i. Il n’y a pas long-temps qu’on me présenta un garçon
de dix-huit mois, dont la tête a encore la même forme et les mêmes
dimensions; cet enfant n’a pas manifesté, jusqu’ici, la moindre faculté
intellectuelle. M. le docteur Spurzheim m’a envoyé, de Londres, le
dessin de la tête d’un sujet complètement imbécile, qui ressemble
parfaitement à celle PI. X IX , fig. i.
M. Richerand cite trois idiots, dont la boîte osseuse a très-peu de
capacité '. . ;
En mesurant ces têtes, immédiatement au-dessus de l’arc supérieur
de l’orbite, et au-dessus de la partie la plus proéminente de l’occipital ,
on trouve une périphérie de onze à treize pouces. En les mesurant de
1 Nouveaux élémens de Physiologie, 7”. édition, T.II, p. iq3 et 194.