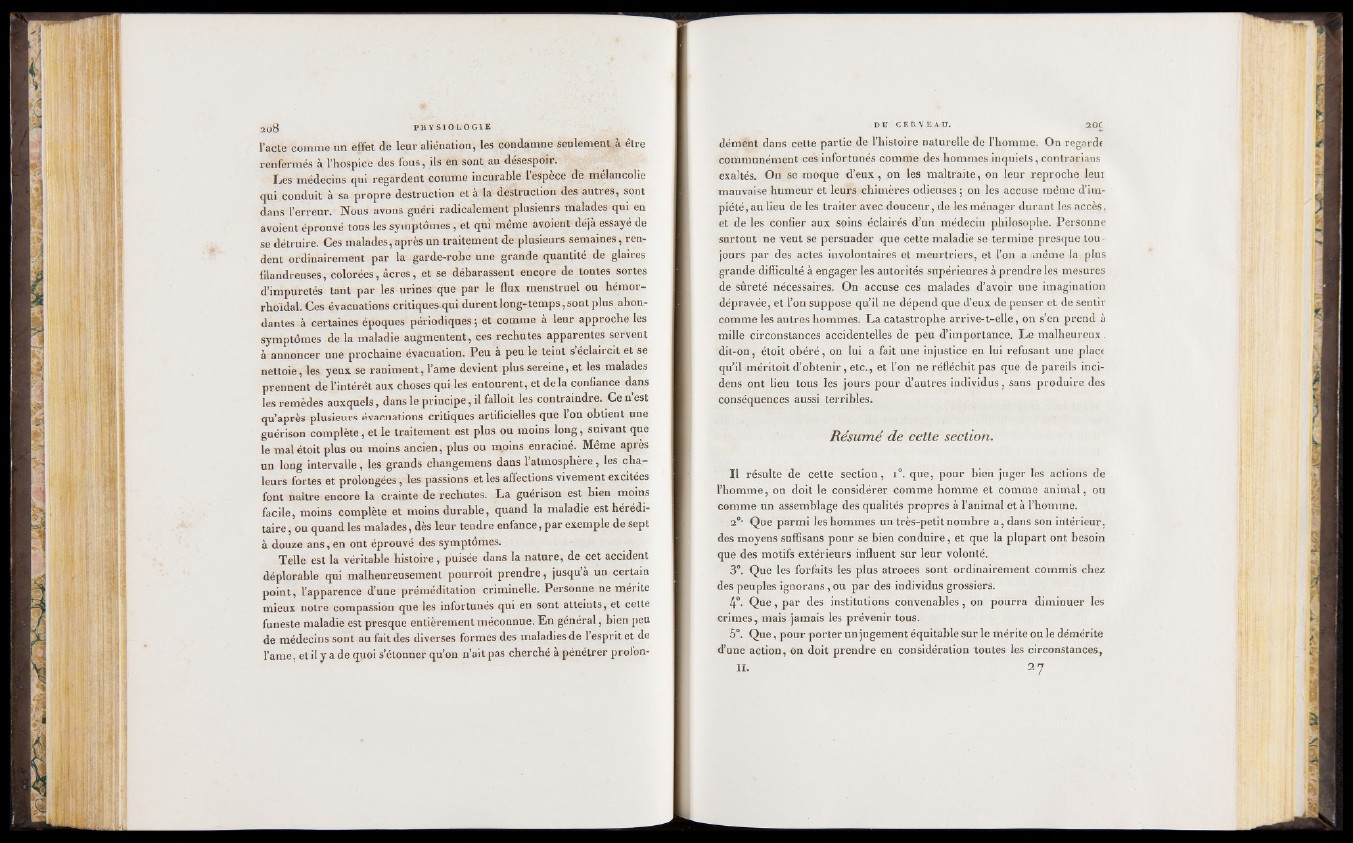
l’acle comme un effet de leur aliénation, les condamne seulement.a etre
renfermés à l’hospice des fous, ils en sont au désespoir.
Les médecins qui regardent comme incurable 1 espece de mélancolie
qui conduit à sa propre destruction et a la destruction des autres, sont
dans l’erreur. Nous avons guéri radicalement plusieurs malades qui en
avoient éprouvé tous les symptômes, et qui même avoient déjà essayé de
se détruire. Ces malades, après un traitement de plusieurs semaines, rendent
ordinairement par la garde-robe une grande quantité de glaires
filandreuses, colorées, âcres, et se débarassent encore de toutes sortes
d’impuretés tant par les urines que par le flux menstruel ou hémor-
rboidal. Ces évacuations critiques-qui durent long-temps, sont plus abondantes
à certaines époques périodiques; et comme à leur approche les
symptômes de la maladie augmentent, ces rechutes apparentes servent
à annoncer une prochaine évacuation. Peu a peu le teint séclaircit et se
nettoie, les yeux se raniment, l’ame devient plus sereine, et les malades
prennent de l’intérêt aux choses qui les entourent, et de la confiance dans
les remèdes auxquels, dans le principe, il falloit les contraindre. Ce n est
qu’après plusieurs évacuations critiques artificielles que Ion obtient une
guérison complète , et le traitement est plus ou moins long, suivant que
le mal étoit plus ou moins ancien, plus ou moins enraciné. Meme après
un long intervalle, les grands changemens dans l’atmosphère, les chaleurs
fortes et prolongées, les passions et les affections vivement excitées
font naître encore la crainte de rechutes. La guérison est bien moins
facile, moins complète et moins durable, quand la maladie est héréditaire
, ou quand les malades, dès leur tendre enfance, par exemple de sept
à douze ans, en ont éprouvé des symptômes.
Telle est la véritable histoire, puisée dans la nature, de cet accident
déplorable qui malheureusement pourroit prendre, jusqu a un certain
point, l’apparence d’une préméditation criminelle. Personne.ne mérite
mieux notre compassion que les infortunés qui en sont atteints, et celte
funeste maladie est presque entièrement méconnue. En général, bien peu
de médecins sont au fait des diverses formes des maladies de 1 esprit et de
l’ame, et il y a de quoi s’étonner qu’on n’ait pas cherché a pénétrer profondément
dans cette partie de l’hisloire naturelle de l’homme. On regarde
communément ces infortunés comme des hommes inquiets, contrarians
exaltés. On se moque d’eux , on les maltraite, on leur reproche leur
mauvaise humeur et leurs chimères odieuses ; on les accuse même d’impiété,
au lieu de les traiter avec douceur, de les ménager durant les accès,
et de les confier aux soins éclairés d’un médecin philosophe. Personne
surtout ne veut se persuader que celte maladie se termine presque toujours
par des actes involontaires et meurtriers, et l’on a même la plus
grande difficulté à engager les autorités supérieures à prendre les mesures
de sûreté nécessaires. On accuse ces malades d’avoir une imagination
dépravée, et l’on suppose qu’il ne dépend que d’eux de penser et de sentir
comme les autres hommes. La catastrophe arrive-t-elle, on s’en prend à
mille circonstances accidentelles de peu d’importance. Le malheureux.
dit-on, étoit obéré, on lui a fait une injustice en lui refusant une place
qu’il méritoit d’obtenir, etc., et l’on ne réfléchit pas que de pareils inci-
dens ont lieu tous les jours pour d’autres individus, sans produire des
conséquences aussi terribles.
Résumé de cette section.
Il résulte de cette section, t°. que, pour bien juger les actions de
l’homme, on doit le considérer comme homme et comme animal, ou
comme un assemblage des qualités propres à l’animal et à l’homme.
a“- Que parmi les hommes un très-petit nombre a, dans son intérieur,
des moyens suffisans pour se bien conduire, et que la plupart ont besoin
que des motifs extérieurs influent sur leur volonté.
3°. Que les forfaits les plus atroces sont ordinairement commis chez
des peuples ignorans, ou par des individus grossiers.
4°. Que, par des institutions convenables, on pourra diminuer les
crimes, mais jamais les prévenir tous.
5°. Que, pour porter un jugement équitable sur le mérite ou le démérite
d’une action, on doit prendre en considération toutes les circonstances,
XI. 2 7