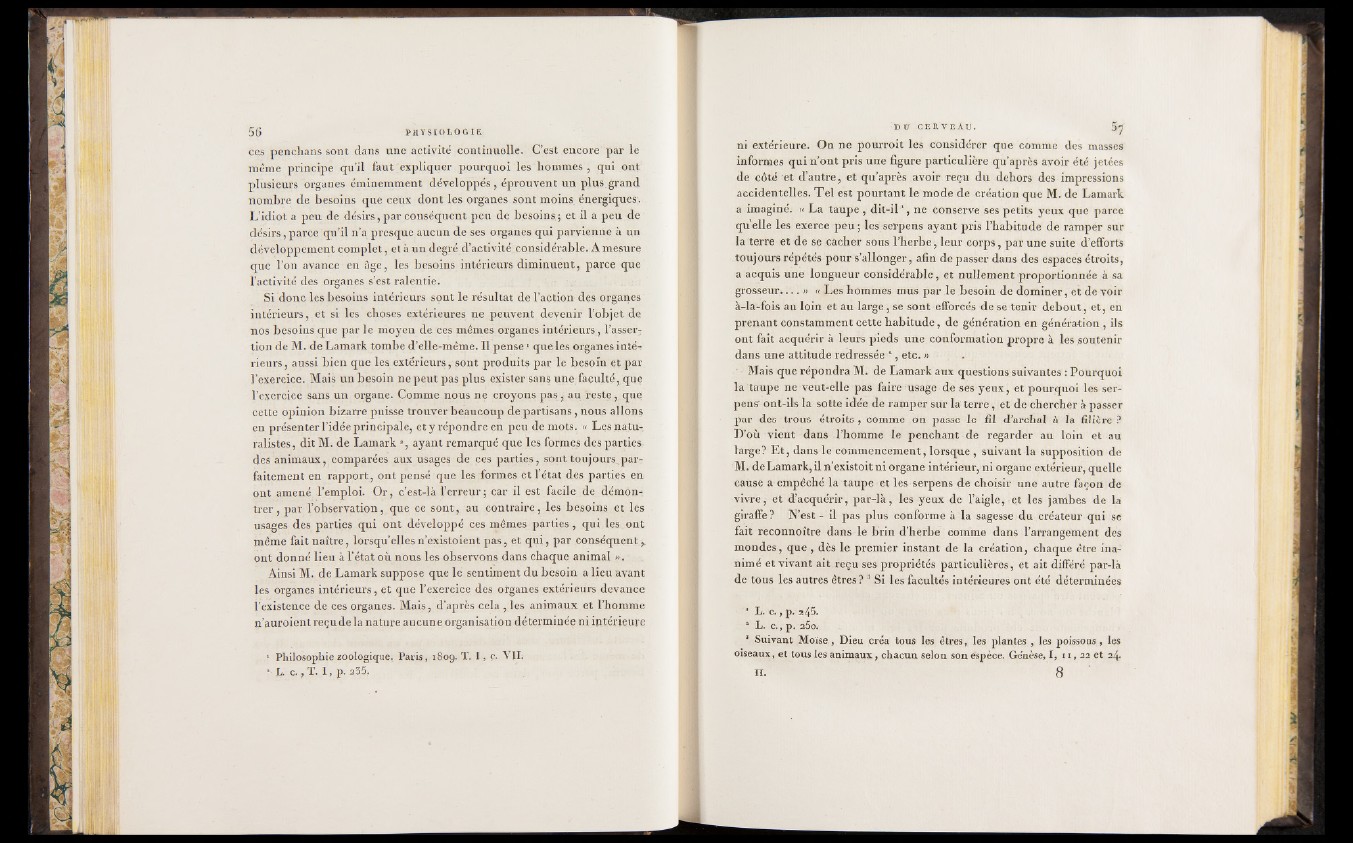
ces penchans sont dans une activité continuelle. C’est encore par le
même principe qu’il faut expliquer pourquoi les hommes , qui ont
plusieurs organes éminemment développés, éprouvent un plus grand
nombre de besoins que ceux dont les organes sont moins énergiques.
L’idiot a peu de désirs, par conséquent peu de besoins,; et il a peu de
désirs, parce qu’il n’a presque aucun de ses organes qui parvienne à un
développement complet, et à un degré d’activité considérable. A mesure
que l’on avance en âge, les besoins intérieurs diminuent, parce que
l’activité des organes s’est ralentie.
Si donc les besoins intérieurs sçnt le résultat de l’action des organes
intérieurs, et si les choses extérieures ne peuvent devenir l’objet de
nos besoins que par le moyen de ces mêmes organes intérieurs,, l’asser^
tion de M. deLamark tombe d’elle-même. Il pense ' que les organes inté-:
rieurs, aussi bien que les extérieurs^ sont produits par le besoin et par
l’exercice. Mais un besoin nepeut pas plus exister sans une faculté,que
l ’exercice sans un organe. Comme nous ne croyons pas , au reste , que
cette opinion bizarre puisse trouver beaucoup de partisans, nous allons
en présenter l ’idée principale, et y répondre en peu de mots. « Les naturalistes,
dit M. de Lamark a, ayant remarqué que les formes des parties
deS animaux, comparées aux usages de ces parties, sont toujours^par-
faitement en rapport, ont pensé que les formes et l’état des parties en
ont amené l’emploi. Or, c’est-là l’erreur; car il est facile de démontrer,
par l’observation, que ce sont, au contraire, les besoins et les
usages des parties qui ont développé ces mêmes parties, qui les ont
même fait naître, lorsqu’elles n’existoient pas, et qui, par conséquent,,
ont donné lieu à l’état où nous les observons dans chaque animal »,
Ainsi M. de Lamark suppose que le sentiment du besoin a lieu avant
les organes intérieurs, et que l’exercice des organes extérieurs devance
l’existence de ces organes. Mais, d’après cela , les animaux et l’homme
n’auroient reçu de la nature aucune organisation déterminée ni intérieure
1 Philosophie zoologique, Paris, 180g, T. I , p, VII,
l/. c ., T. I , p. 235,
ni extérieure. On ne pourroit les considérer que comme des masses
informes qui n’ont pris une figure particulière qu’après avoir été jetées
de côté et d’autre, et qu’après avoir reçu du dehors des impressions
accidentelles. Tel est pourtant le mode de création que M. de Lamark
a imaginé; « La taupe , dit-il1, ne conserve ses petits yeux que parce
qu’elle les exerce peu ; les serpens ayant pris l’habitude de ramper sur
la terre et de se cacher sous l ’herbe-, leur corps, par une suite d’efforts
toujours répétés pour s’allonger, afin de passer dans des espaces étroits,
a acquis une longueur considérable, et nullement proportionnée à sa
grosseur,. . . » « Les hommes mus par le besoin de dominer, et de voir
à-la-fois au loin et au large , se sont efforcés de se tenir debout, et, en
prenant constamment cette habitude, de génération en génération , ils
ont fait acquérir à leurs pieds une conformation propre à les soutenir
dans une attitude redressée “, etc. » .
Mais que répondra M. de Lamark aux questions suivantes : Pourquoi
la taupe ne veut-elle pas faire-usage de ses yeux, et pourquoi les serpens
ont-ils la sotte idée de ramper sur la terre, et de chercher à passer
par des trous étroits , comme on passe le fil d’archal à la filière ?
D’où vient dans l ’homme lé penchant de regarder au loin et au
large? Et, dans le commencement, lorsque , suivant la supposition de
M. deLamark,iln’existoitni organe intérieur, ni organe extérieur, quelle
cause a-empêché la taupe et les serpens de choisir une autre façon de
vivre, et d’acquérir, par-là, les yeux de l’aigle, et les jambes de la
giràffe? N’est - il pas plus conforme à la sagesse du créateur qui se
fait reconnoître dans le brin d’herbe comme dans l’arrangement des
mondes, que , dès le premier instant de la création, chaque être inanimé
et vivant ait reçu ses propriétés particulières, et ait différé par-là
de tous les autres êtres ? 3 Si les facultés intérieures ont été déterminées
L. c., p. 245-
* L. c., p. 25o.
* Suivant Moïse, Dieu créa tous les êtres, les plantes , les poissons , les
oiseaux, et tous les animaux, chacun selon son espèce. Genèse, I, 11,22 et 24.
xi. 8