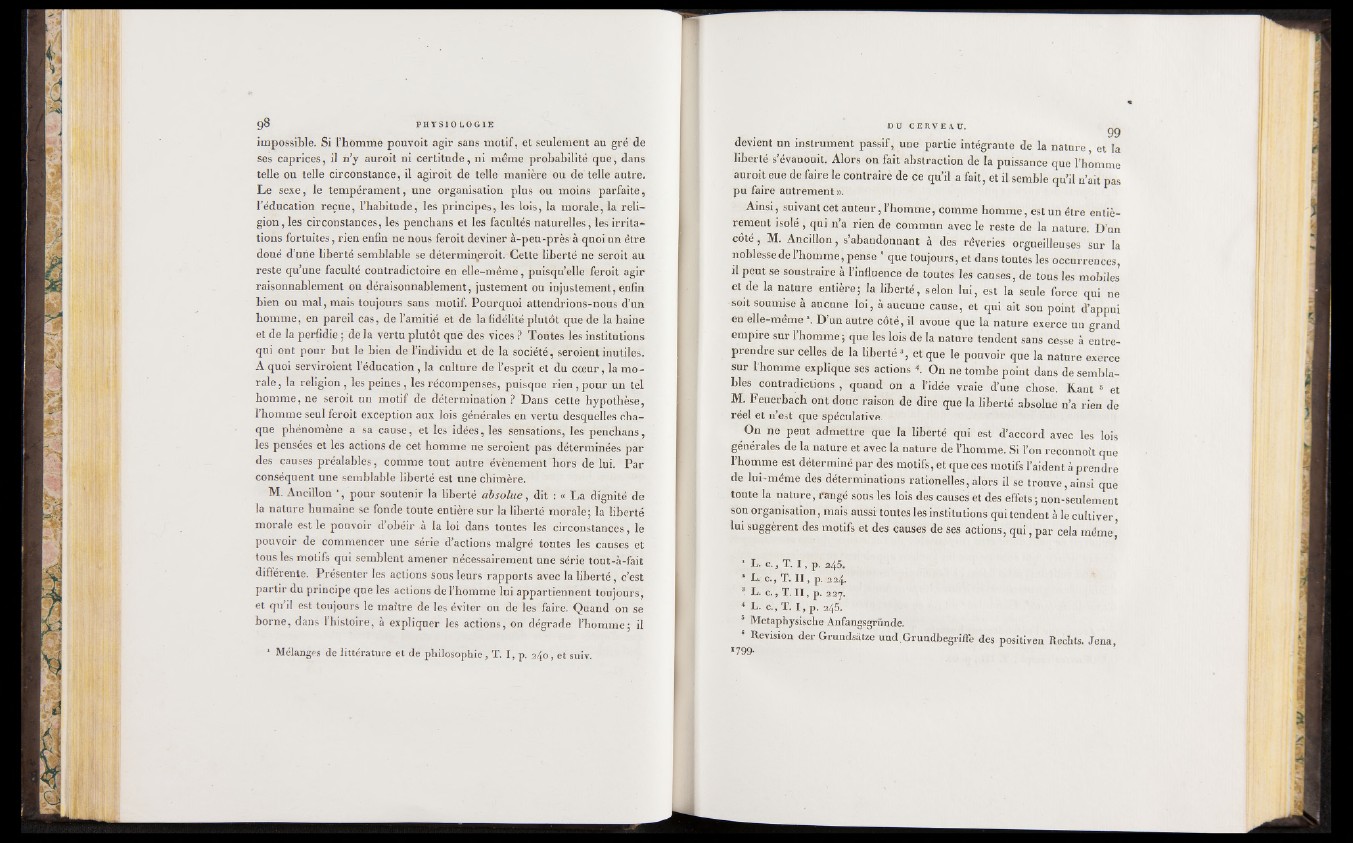
impossible. Si l’homme pouvoit agir sans motif, et seulement au gré de
ses caprices, il n’y auroit ni certitude, ni même probabilité que, dans
telle ou telle circonstance, il agiroit de telle manière ou de telle autre.
Le sexe, le tempérament, une organisation plus ou moins parfaite,
l’éducation reçue, l’habitude, les principes, les lois, la morale, la religion,
les circonstances, les pencbans et les facultés naturelles, les irritations
fortuites, rien enfin ne nous feroit deviner à-peu-prèsà quoi un être
doué d’une liberté semblable se détermineroit. Cette liberté ne seroit au
reste qu’une faculté contradictoire en elle-même, puisqu’elle feroit agir
raisonnablement ou déraisonnablement, justement ou injustement, enfin
bien ou mal, mais toujours sans motif. Pourquoi attendrions-nous d’un
homme, en pareil cas, de l’amitié et de la fidélité plutôt que de la haine
et de la perfidie ; de la vertu plutôt que des vices ? Toutes les institutions
qui ont pour but le bien de l’individu et de la société, seroient inutiles.
A quoi serviroient l’éducation , la culture de l’esprit et du coeur, la morale,
la religion , les peines , les récompenses, puisque rien , pour un tel
homme, ne seroit un motif de détermination ? Dans cette hypothèse,
l’homme seul feroit exception aux lois générales en vertu desquelles chaque
phénomène a sa cause, et les idées, les sensations, les penchans,
les pensées et les actions de cét homme ne seroient pas déterminées par
des causes préalables, comme tout autre évènement hors de lui. Par
conséquent une semblable liberté est une chimère.
M. Ancillon ‘ , pour soutenir la liberté absolue, dit : « La dignité de
la nature humaine se fonde toute entière sur la liberté morale; la liberté
morale est le pouvoir d’obéir à la loi dans toutes les circonstances, le
pouvoir de commencer une série d’actions malgré toutes les causes et
tous les motifs qui semblent amener nécessairement une série tout-à-fait
différente. Présenter les actions sous leurs rapports avec la liberté, c’est
partir du principe que les actions de l’homme lui appartiennent toujours,
et qu’il est toujours le maître de les éviter ou de les faire. Quand on se
borne, dans l’histoire, à expliquer les actions, on dégrade l’homme; il
* Mélanges de littérature et de philosophie, T. I, p. 240, et suiv.
. . . 99
devient un instrument passif, une partie intégrante de la nature et la
liberté s’évanouit. Alors on fait abstraction de la puissance que l’homme
auroit eue de faire le contraire de ce qu’il a fait, et il semble qu’il n’ait pas
pu faire autrement!).
Ainsi, suivant cet auteur, l’homme, comme homme, est un être entièrement
isolé, qui n’a rien de commun avec le reste de la nature. D’un
côté, M. Ancillon, s’abandonnant à des rêveries orgueilleuses sur la
noblesse de l’homme, pense ' que toujours, et dans toutes les occurrences,
il peut se soustraire à l’influence de toutes les causes , de tous les mobiles
et de la nature entière; la liberté, selon lui, est la seule force qui ne
soit soumise à aucune loi, à aucune cause, et qui ait son point d’appui
en elle-même \ D’un autre côté, il avoue que la nature exerce un grand
empire sur l’homme; que les lois de la nature tendent sans cesse à entreprendre
sur celles de la liberté 3, et que le pouvoir que la nature exerce
sur l'homme explique ses actions *. On ne tombe point dans de semblables
contradictions , quand on a l’idée vraie d’une chose. Kant 5 et
M. Feuerbach ont donc raison de dire que la liberté absolue n’a rien de
réel et n’est que spéculative.
On ne peut admettre que la liberté qui est d’accord avec les lois
générales de la nature et avec la nature de l’homme. Si l’on reconnoit que
l’homme est déterminé par des motifs, et que ces motifs l’aident à prendre
de lui-même des déterminations rationelles, alors il se trouve,ainsi que
toute la nature, rangé sous les lois des causes et des effets ; non-seulement
son organisation, mais aussi toutes les institutions qui tendent à le cultiver
lui suggèrent des motifs et des causes de ses actions, qui, par cela même'
1 L. C. y T. I , p. 245.
* L. c., T. I I , p. 224.
• L* c., T. I I , p. 227.
4 L. c., T. I , p. 245.
5 Metaphysische Anfangsgründe.
' Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven Rechts. Jena,
»799-