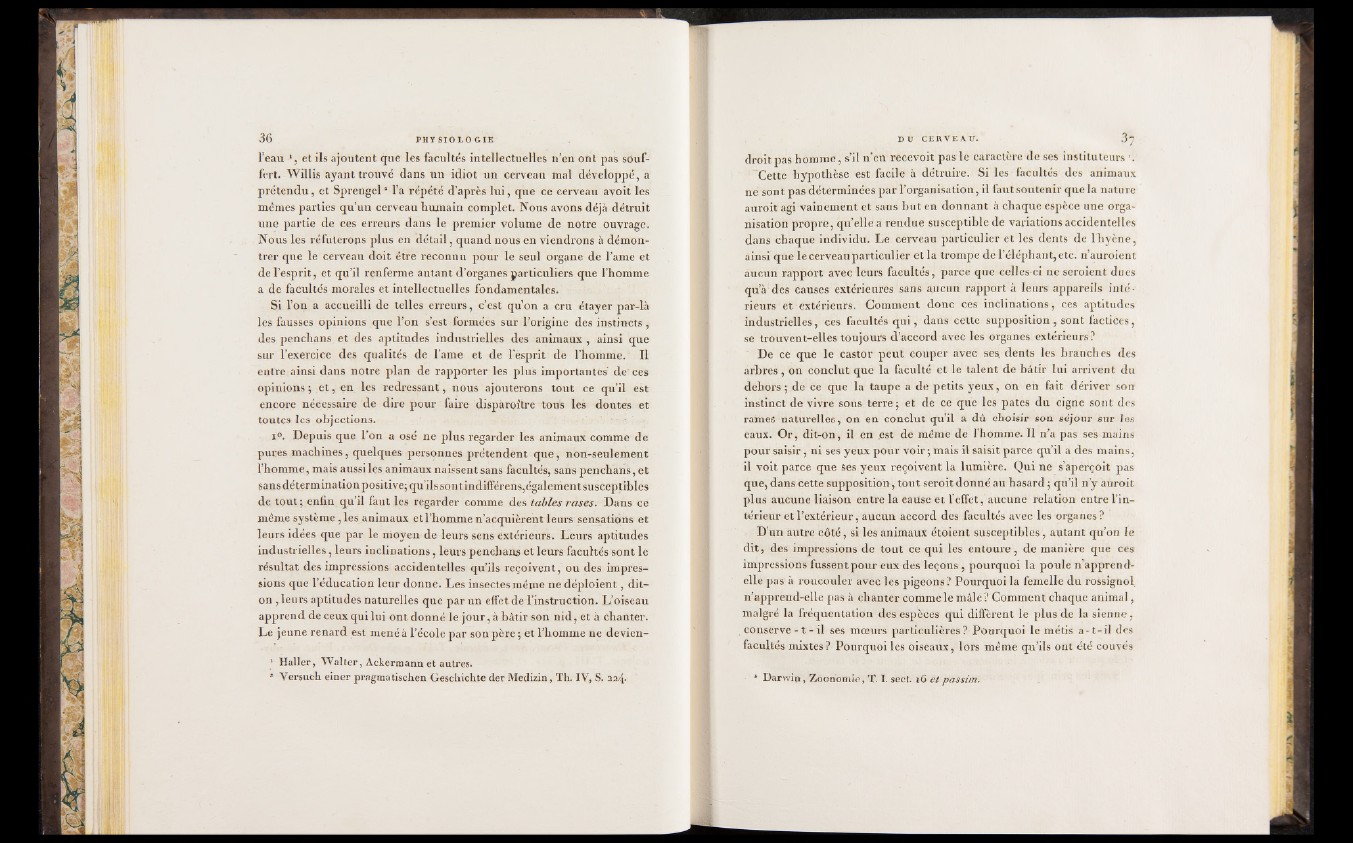
l’eau 1, et ils ajoutent que les facultés intellectuelles n’en ont pas souffert.
Willis ayant trouvé dans un idiot un cerveau mal développé, a
prétendu, et Sprengel * l’a répété d’après lui, que ce cerveau avoit les
mêmes parties qu’un cerveau humain complet. Nous avons déjà détruit
une partie de ces erreurs dans le premier volume de notre ouyrage.
Nous les réfuterons plus en détail, quand nous en viendrons à démontrer
que le cerveau doit être reconnu pour le seul organe de l ’ame et
de l’esprit, et qu’il renferme autant d’organes particuliers que l’homme
a de facultés morales et intellectuelles fondamentales.
Si l’on a accueilli de telles erreurs, c’est qu’on a cru étayer par-là
les fausses opinions que l’on s’est formées sur l ’origine des instincts,
des penclians et des aptitudes industrielles des animaux , ainsi que
sur l ’exercice des qualités de l’ame et de l’esprit de l’homme. Il
entre ainsi dans notre plan de rapporter les plus importantes' de ces
opinions; et, en les redressant, nous ajouterons tout ce qu’il est
encore nécessaire de dire pour faire disparaître tous les doutes et
toutes les objections.
i°. Depuis que l’on a osé ne plus regarder les animaux comme de
pures machines, quelques personnes prétendent que, non-seulement
l’homme, mais aussi les animaux naissent sans facultés, sans penchans,et
sans détermination positive; qu’ils sont indifférens,également susceptibles
de tout; enfin qu’il faut les regarder comme des tables rases. Dans ce
même système , les animaux et l’homme n’acquièrent leurs sensations et
leurs idées que par le moyen de leurs sens extérieurs. Leurs aptitudes
industrielles, leurs inclinations, leurs penchans et leurs facultés sont le
résultat des impressions accidentelles qu’ils reçoivent, ou des impressions
que l’éducation leur donne. Les insectes même ne déploient, dit-
on , leurs aptitudes naturelles que par un effet de l’instruction. L’oiseau
apprend de ceux qui lui ont donné le jour, à bâtir son nid, et à chanter.
Le jeune renard est mené à l’école par son père ; et l ’homme ne devien-
1 Haller, Walter, Ackermannet autres.
3 Yersueh einer pragmatischen Geschichte der Medizin, Th. IV, S. 234.
droit pas homme, s’il n’erl recevoit pas le caractère de ses instituteurs tf
Cette hypothèse est facile à détruire. Si les facultés des animaux
ne sont pas déterminées par l’organisation, il faut soutenir que la nature
auroit agi vainement et sans but en donnant à chaque espèce une organisation
propre, qu’elle à rendue susceptible de variations accidente]les
dans chaque individu. Le cerveau particulier et les dents de 1 hyène,
ainsi que le cerveau particulier et la trompe de l ’éléphant, etc. n’auroient
aucun rapport avec leurs facultés, parce que celles-ci ne seraient dues
qu’à des causes extérieures sans aucun rapporta leurs appareils intérieurs
et extérieurs. Comment donc ces inclinations, ces aptitudes
industrielles, ces facultés qui, dans cette supposition , sont factices,
se trouvent-elles toujours d’accord avec les organes extérieurs ?
De ce que le castor peut couper avec ses. dents les branches des
arbres, on conclut que la faculté et le talent de bâtir lui arrivent du
dehors ; de ce que la taupe a de petits yeux, on en fait dériver son
instinct de vivre sous terre; et de ce que les pâtes du cigne sont des
rames naturelles, on en conclut qu’il a du choisir son séjour sur les
eaux. Or, dit-on, il en est de même de l’homme. II n’a pas ses mains
pour saisir, ni ses yeux pour voir ; mais il saisit parce qu’il a des mains ,
il voit parce que ses yeux reçoivent la lumière. Qui ne s’aperçoit pas
que, dans cette supposition, tout seroit donné au hasard ; qu’il n’y auroit
plus aucune liaison entre la eaüse et l’effet, aucune relation entre l’intérieur
et l ’extérieur, aucun accord des facultés avec les organes ?
D’un autre côté, si les animaux étoient susceptibles, autant qu’on le
dit , des impressions de tout ce qui les entoure , de manière que ces
impressions fussent pour eux des leçons, pourquoi la poule n’apprend-
elle pas à roucouler avec les pigeons? Pourquoi la femelle du rossignol
n’apprend-elle pas à chanter comme le mâle? Gomment chaque animal,
malgré la fréquentation des espèces qui diffèrent le plus de la sienne,
conserve - 1 - il ses moeurs particulières? Pourquoi le métis a -t- il des
facultés mixtes ? Pourquoi les oiseaux, lors même qu’ils ont été couvés
* Darwiu, Zoonomie, T. I. sect. 16 et passim.