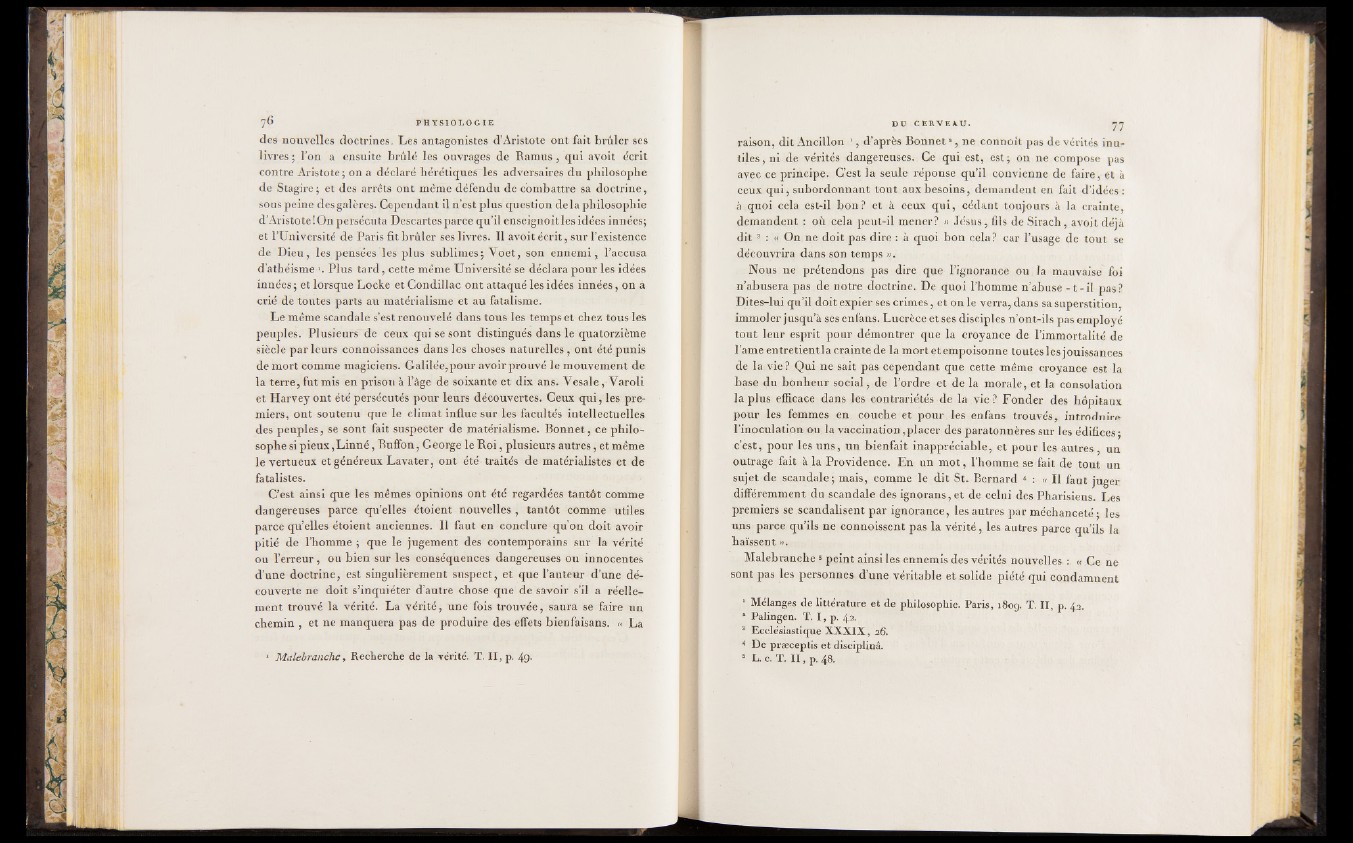
des nouvelles doctrines. Les antagonistes d’Aristote ont fait brûler ses
livres ; l’on a ensuite brûlé les ouvrages de Ramus , qui avoit écrit
contre Aristote ; on a déclaré hérétiques les adversaires du philosophe
de Stagire; et des arrêts ont même défendu de combattre sa doctrine,
sous peine des galères. Cependant il n’est plus question de la philosophie
d’Aristote!On persécuta Descartes parce qu’il enseignoitles idées innées;
et l’Université de Paris fit hrûler ses livres. Il avoit écrit, sur l’existence
de Dieu, les pensées les plus sublimes; Yoet, son ennemi, l’accusa
d’athéisme '. Plus tard, cette même Université se déclara pour les idées
innées ; et lorsque Locke et Condillac ont attaqué les idées innées, on a
crié de toutes parts au matérialisme et au fatalisme.
Le même scandale s’est renouvelé dans tous les temps et chez tous leë
peuples. Plusieurs de ceux qui se sont distingués dans le quatorzième
siècle par leurs connoissances dans les choses naturelles, ont été punis
de mort comme magiciens. Galilée,pour avoir prouvé le mouvement de
la terre, fut mis en prison à l’âge de soixante et dix ans. Vesale, Varoli
et Harvey ont été persécutés pour leurs découvertes. Ceux qui, les premiers,
ont soutenu que le climat influe sur les facultés intellectuelles
des peuples, se sont fait suspecter de matérialisme. Bonnet, ce philosophe
si pieux, Linné, Buffon, George le Roi, plusieurs autres, et même
le vertueux et généreux Lavater, ont été traités de matérialistes et de
fatalistes.
C’est ainsi que les mêmes opinions ont été regardées tantôt comme
dangereuses parce qu’elles étoient nouvelles , tantôt comme utiles
parce quelles étoient anciennes. Il faut en conclure qu’on doit avoir
pitié de l’homme ; que le jugement des contemporains sur la vérité
ou l’erreur, on bien sur les conséquences dangereuses ou innocentes
d’une doctrine, est singulièrement suspect, et que l’auteur d’une découverte
ne doit s’inquiéter d’autre chose que de savoir s’il a réellement
trouvé la vérité. La vérité, une fois trouvée, saura se faire un
chemin , et ne manquera pas de produire des effets bienfaisans. « La
■ Malebranche, Recherche de la vérité. T. I I , p. 49-
raison, dit Ancillon ‘ , d’après Bonnet*, ne connolt pas de vérités inutiles,
ni de vérités dangereuses. Ce qui est, est; on ne compose pas
avec ce principe. C’est la seule réponse qu’il convienne de faire, et à
ceux qui, subordonnant tout aux besoins, demandent en fait d’idées :
à quoi cela est-il bon? et à ceux qui, cédant toujours à la crainte,
demandent : où cela peut-il mener? » Jésus, fils de Sirach, avoit déjà
dit 3 : « On ne doit pas dire : à quoi bon cela? car l’usage de tout se
découvrira dans son temps ».
Nous ne prétendons pas dire que l’ignorance ou la mauvaise foi
n’abusera pas de notre doctrine. De quoi l’homme n’abuse - t - il pas?
Dites-lui qu’il doit expier ses crimes, et on le verra, dans sa superstition,
immoler jusqu’à ses enfans. Lucrèce et ses disciples n’ont-ils pas employé
tout leur esprit pour démontrer que la croyance de l ’immortalité de
lame entretientla crainte de la mort etempoisonne toutes les jouissances
de la vie ? Qui ne sait pas cependant que cette même croyance est la
base du bonheur social, de l’ordre et de la morale, et la consolation
la plus efficace dans les contrariétés de la vie? Fonder des hôpitaux
pour les femmes en couche et pour les enfans trouvés, introduire
l’inoculation ou la vaccination,placer des paratonnères sur les édifices;
c’est, pour les uns, un bienfait inappréciable, et pour les autres, un
outrage fait à la Providence. En un mot, l’homme se fait de tout un
sujet de scandale; mais, comme le dit St. Bernard * : « Il faut juger
différemment du scandale des ignorans,et de celui des Pharisiens. Les
premiers se scandalisent par ignorance, les autres par méchanceté; les
uns parce qu’ils ne connoissent pas la vérité, les autres parce qu’ils la
haïssent ».
Malebranche 3 peint ainsi les ennemis des vérités nouvelles : « Ce ne
sont pas les personnes d’une véritable et solide piété qui condamnent
* Mélanges de littérature et de philosophie. Paris, 1809. T. I I , p. 42.
* Palingen. T. I , p. 42.
3 Ecclésiastique XXXIX, 26.
4 De præceptis et disciplina.
5 L. c. T. I I , p. 48.