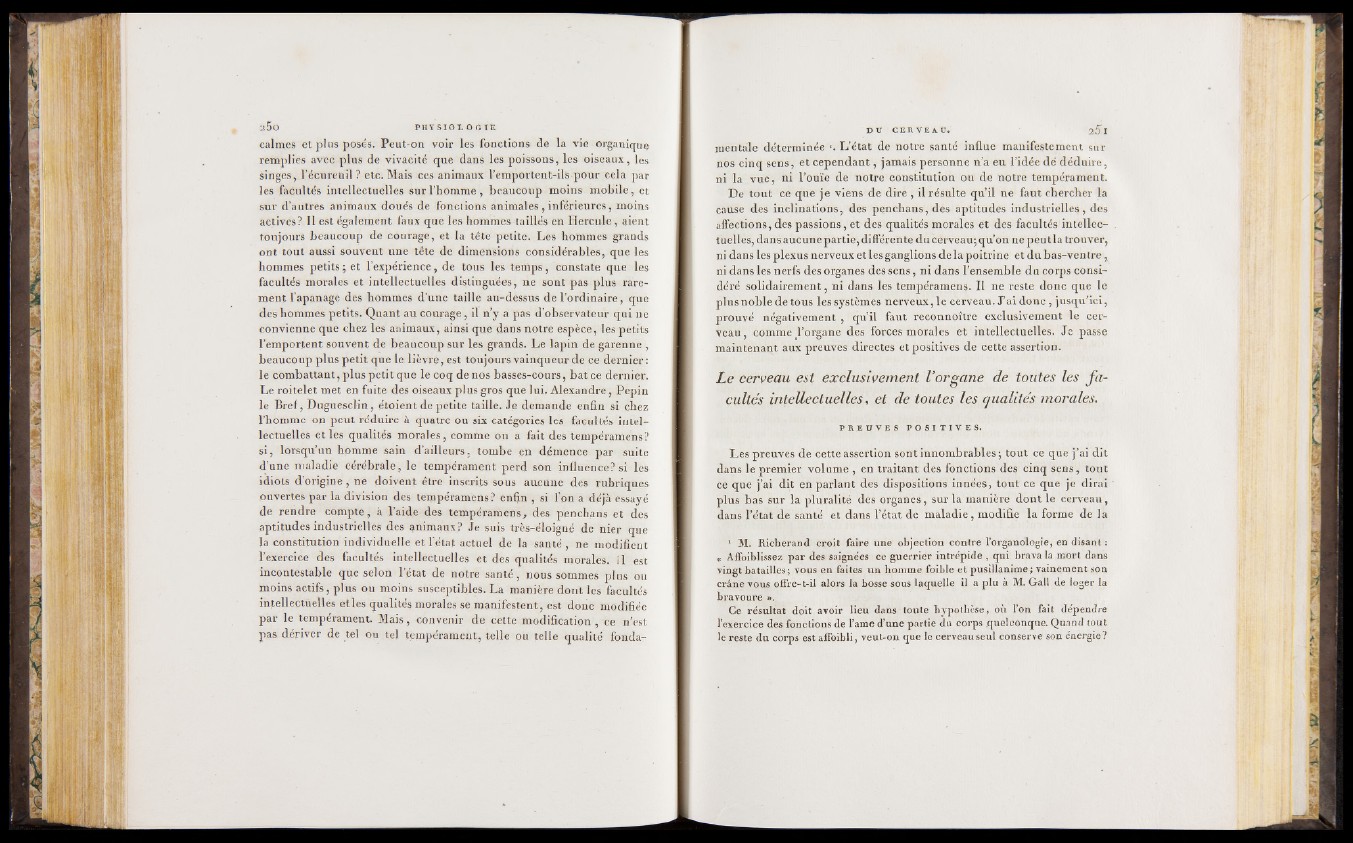
calmes et plus posés. Peut-on voir les fonctions de la vie organique
remplies avec plus de vivacité que dans les poissons, les oiseaux, les
singes, l ’écureuil ? etc. Mais ces animaux l’emportent-ils pour cela par
les facultés intellectuelles sur l’homme, beaucoup moins mobile, et
sur d’autres animaux doués de fonctions animales , inférieures, moins
actives? Il est également faux que les hommes taillés en Hercule, aient
toujours beaucoup de courage, et la tête petite. Les hommes grands
ont tout aussi souvent une tête de dimensions considérables, que les
hommes petits; et l’expérience, de tous les temps, constate que les
facultés morales et intellectuelles distinguées, ne sont pas plus rarement
fapanage des hommes d’une taille au-dessus de l’ordinaire, que
des hommes petits. Quant au courage, il n’y a pas d’observateur qui ne
convienne que chez les animaux, ainsi que dans notre espèce, les petits
l’emportent souvent de beaucoup sur les grands. Le lapin de garenne ,
beaucoup plus petit que le lièvre, est toujours vainqueur de ce dernier :
le combattant, plus petit que le coq de nos basses-cours, bat ce dernier.
Le roitelet met en fuite des oiseaux plus gros que lui, Alexandre, Pépin
le Bref, Duguesclin, étoient de petite taille. Je demande enfin si chez
l’homme on peut réduire à quatre ou six catégories les facultés intellectuelles
et les qualités morales , comme on a fait des tempéramens?
si, lorsqu’un homme sain d’ailleurs, tombe en démence par suite
d’une maladie cérébrale, le tempérament perd son influence? si les
idiots d’origine, ne doivent être inscrits sous aucune des rubriques
ouvertes par la division des tempéramens? enfin , si l’on a déjà essayé
de rendre compte, à l’aide des tempéramens, des penchans et des
aptitudes industrielles des animaux? Je suis très-éloigné de nier que
la constitution individuelle et l’état actuel de la santé , ne modifient
l ’exercice des facultés intellectuelles et des qualités morales, il est
incontestable que selon l’état de notre santé, nous sommes plus ou
moins actifs, plus ou moins susceptibles. La manière dont les facultés
intellectuelles et les qualités morales se manifestent, est donc modifiée
par le tempérament. Mais, convenir de cette modification , ce n’est
pas dériver de tel ou tel tempérament, telle ou telle qualité fondamentale
déterminée L’état de notre santé influe manifestement sur
nos cinq sens, et cependant, jamais personne n’a eu l ’idée dé déduire,
ni la vue, ni l’ouïe de notre constitution ou de notre tempérament.
De tout ce que je viens de dire, il résulte qu’il ne faut chercher la
cause des inclinations, des penchans, des aptitudes industrielles, des
affections, des passions, et des qualités morales et des facultés intellectuelles,
dans aucune partie, différente du cerveau; qu’on ne peut la trouver,
ni dans les plexus nerveux et les ganglions de la poitrine et du bas-ventre,
ni dans les nerfs des organes des sens, ni dans l’ensemble du corps considéré
solidairement, ni dans les tempéramens. Il ne reste donc que le
plus noble de tous les systèmes nerveux, le cerveau. J’ai donc , jusqu’ici,
prouvé négativement , qu’il faut reconnoître exclusivement le cerveau,
comme l’organe des forces morales et intellectuelles. Je passe
maintenant aux preuves directes et positives de cette assertion.
Le cerveau est exclusivement l’organe de toutes les fa cultés
intellectuelles, et de toutes les qualités morales.
P R E U V E S P O S I T I V E S .
Les preuves de cette assertion sont innombrables ; tout ce que j’ai dit
dans le premier volume , en traitant des fonctions des cinq sens, tout
ce que j’ai dit en parlant des dispositions innées, tout ce que je dirai
plus bas sur la pluralité des organes, sur la manière dont le cerveau,
dans l’état de santé et dans l’état de maladie, modifie la forme de la
1 M. Richerand croit faire une objection contre l’organologie, en disant :
« Affaiblissez par des saignées ce guerrier intrépide , qui brava la mort dans
vingt batailles; vous en faites un homme foible et pusillanime; vainement son
crâne vous offre-t-il alors la bosse sous laquelle il a plu à M. Gall de loger la
bravoure ».
Ce résultat doit avoir lieu dans toute hypothèse, où l’on fait dépendre
l’exercice des fonctions de l’ame d’une partie du corps quelconque. Quand tout
le reste du corps est affoibli, veut-on que le cerveau seul conserve son énergie?