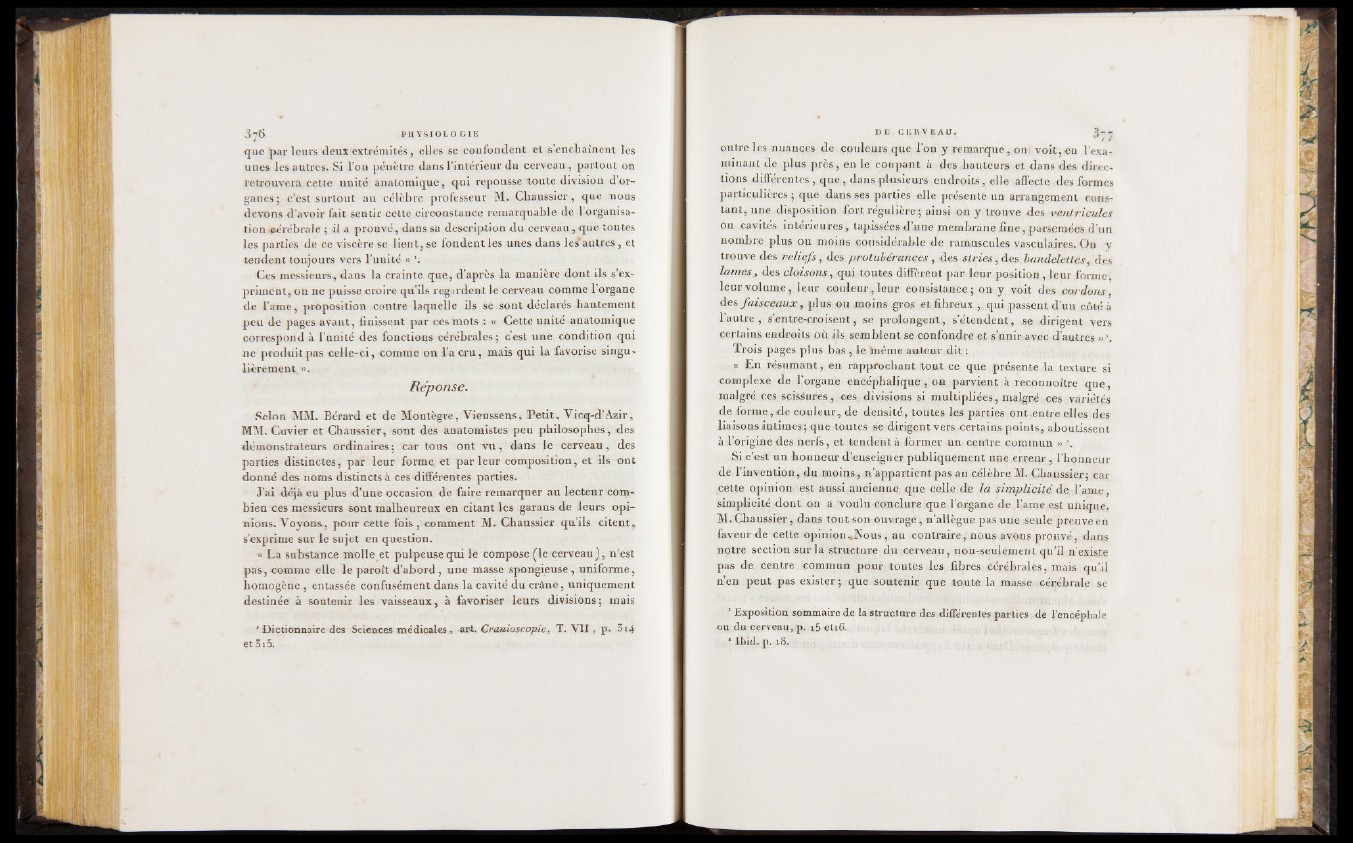
que parleurs deux extrémités, elles se confondent et s’enchaînent les
unes les autres. Si l’on pénètre dans l’intérieur du cerveau , partout on
retrouvera cette unité anatomique, qui repousse toute division d’organes;
c’est surtout au célèbre professeur M. Chaussier , que nous
devons d’avoir fait sentir cette circonstance remarquable de 1 organisation
«érébrale ; il a prouvé, dans sa description du cerveau, que toutes
les parties de ce viscère se lient, se fondent les unes dans les*autres, et
tendent toujours vers l’unité »
Ces messieurs, dans la crainte que, d’après la manière dont ils s’expriment,
on ne puisse croire qu’ils regardent le cerveau comme l ’organe
de lame, proposition contre laquelle ils se sont déclarés hautement
peu de pages avant, finissent par ces mots : « Cette unité anatomique
correspond à l’unité des fonctions cérébrales; c’est une condition qui
ne produit pas celle-ci, comme on l ’a cru, mais qui la favorise singulièrement,
».
Réponse.
Selon MM. Bérard et de Montègre, Vieusseus, Petit, Vicq-d’Azir,
MM. Cuvier et Chaussier , sont des anatomistes peu philosophes, des
démonstrateurs ordinaires; car tous ont vu , dans le cerveau, des
parties distinctes, par leur forme, et par leur composition, et ils ont
donné des noms distincts à ces différentes parties.
J’ai déjà eu plus d’une occasion de faire remarquer au lecteur combien
ces messieurs sont malheureux eu citant les garans de leurs opinions.
Voyons, pour cette fois , comment M. Chaussier qu’ils citent,
s’exprime sur le sujet en question.
« La substance molle et pulpeuse qui le compose (le cerveau J , n’est
pas, comme elle le paroît d’abord, une masse spongieuse, uniforme,
homogène , entassée confusément dans la cavité du crâne, uniquement
destinée à soutenir les vaisseaux, à favoriser leurs divisions; mais 1
1 Dictionnaire des Sciences médicales, art. Cranioscopie, T. VII , p. 3i4
et 315.
outre les nuances de couleurs que l ’on y remarque, on voit,eu l'examinant
de plus près, en le coupant à des hauteurs -et dans des directions
différentes, que, dans plusieurs endroits, elle affecte des formes
particulières;; que dans ses parties elle présente un arrangement constant,
une disposition fort régulière ; ainsi on y trouve des ventricules
ou cavités intérieures, tapissées d’une membrane fine, parsemées d’un
nombre plus ou moins considérable de ramuscul.es vasculaires. On v
trouve des reliefs, des protubérances , des stries, des bandelettes, des
lames, des cloisons, qui toutes diffèrent par leur position, leur forme,
leur volume, leur couleur, leur consistance; on y voit des cordons,
des faisceaux, plus ou moins gros et fibreux , qui passent d’uu côté à
l’autre, s’entre-croisent, se prolongent, s’étendent, se dirigent vers
certains endroits où ils semblent se confondre-et s’unir a vec d’autres » ".
Trois pages plus bas , le même auteur dit :
V« En résumant, en rapprochant stout ce que présente la texture si
complexe de l’organe encéphalique on parvient à reconnoître que,
malgré ces scissures, ces divisions si multipliées , malgré ces variétés
de forme, de couleur, de densité, toutes les parties ont entre elles des
liaisons intimes; que toutes se dirigent vers .certains points, aboutissent
à l’origine des nerfs, et tendent à former un centre commun ».\
Si c’est un honneur d’enseigner publiquement une erreur , l’honneur
de l’invention, du moins, n’appartient pas au célèbre M. Chaussier; car
cette opinion est aussi ancienne que celle de la simplicité de l’ame,
simplicité dont on a voulu conclure que l’organe de l’ame est unique.
M. Chaussier, dans tout son ouvrage, n’allègue pas une seule preuve en
faveur de cette opinion^Nous, au contraire , nous avons prouvé, dans
notre section sur la structure du oerveau, non-seulement qu’il n’existe
pas de centre commun pour toutes les fibres cérébrales, mais qu’il
n’en peut pas exister ; que soutenir que toute la masse cérébrale se
| Exposition sommaire de la structure des différentes parties de l’encéphale
ou du cerveau, p. i,5 eti6.
* Ibid. p. 18.
m
i
m
S?
iÿjj
H
hx]