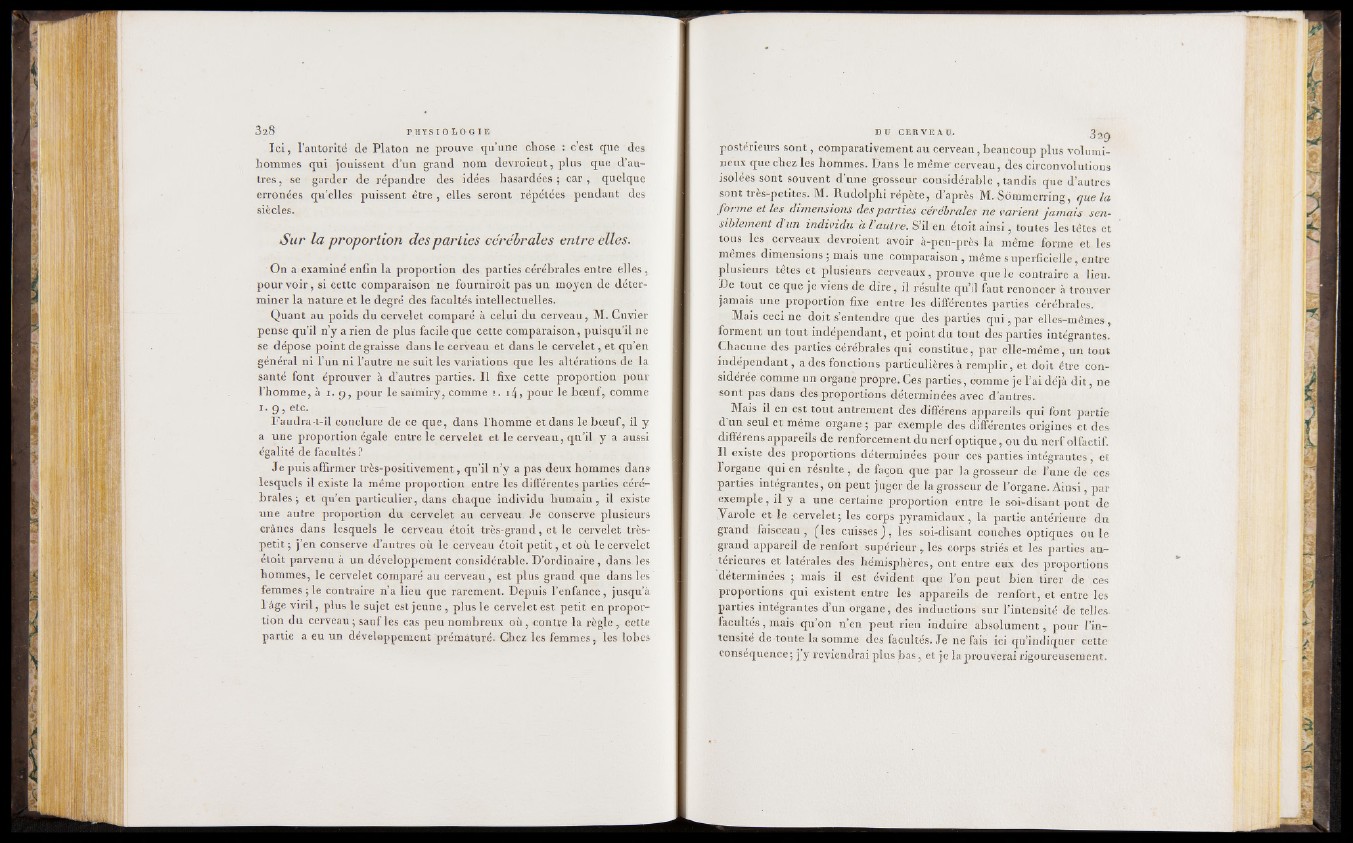
Ic i, l’autorité de Platon ne prouve qu’une chose : c'est que des
hommes qui jouissent d’un grand nom devroient, plus que d’autres,
se garder de répandre des idées hasardées ; car , quelque
erronées qu’elles puissent être, elles seront répétées pendant des
siècles.
Sur la proportion des parties cérébrales entre elles.
On a examiné enfin la proportion des parties cérébrales entre elles,
pourvoir, si cette comparaison ne fourniroit pas un moyen de déterminer
la nature et le degré des facultés intellectuelles.
Quant au poids du cervelet comparé à celui du cerveau, M. Cuvier
pense qu’il n’y a rien de plus facile que cette comparaison, puisqu’il ne
se dépose point de graisse dans le cerveau et dans le cervelet, et qu’en
général ni l’un ni l’autre ne suit les variations que les altérations de la
santé font éprouver à d’autres parties. Il fixe cette proportion pour
l ’homme, à i. 9, pour le saïmiry, comme 1. i4, pour le boeuf, comme
1. 9 , etc.
Faudra-t-il conclure de ce que, dans l ’homme et dans le boeuf, il y
a une proportion égale entre le cervelet et le cerveau, qu’il y a aussi
égalité de facultés ?
Je puis affirmer très-positivement, qu’il n’y a pas deux hommes dans
lesquels il existe la même proportion entre les différentes parties cérébrales
; et qu’en particulier, dans chaque individu humain, il existe
une autre proportion du cervelet au cerveau. Je conserve plusieurs
crânes dans lesquels le cerveau étoit très-grand, et le cervelet très-
petit ; j’en conserve d’autres où le cerveau étoit petit, et où le cervelet
étoit parvenu à un développement considérable. D’ordinaire, dans les
hommes, le cervelet comparé au cerveau, est plus grand que dans les
femmes ; le contraire n’a lieu que rarement. Depuis l’enfance, jusqu’à
l'âge viril, plus le sujet est jeune, plus le cervelet est petit en proportion
du cerveau ; sauf les cas peu nombreux où, contre la règle , cette
partie a eu un développement prématuré. Chez les femmes, les lobes
postérieurs sont, comparativement au cerveau, beaucoup plus volumineux
que chez les hommes. Dans le même’ cerveau, des circonvolutions
isolées sont souvent d’une grosseur considérable , tandis que d’autres
sont tres-petites. M. Rudolphi repète, d’après M. Sommerring, que la
forme et les dimensions des parties cérébrales ne varient jamais sensiblement
d un individu à Vautre. S’il en étoit ainsi, toutes les têtes et
tous les cerveaux devroient avoir à-peu-près la même forme et les
mêmes dimensions ; mais une comparaison , même superficielle, entre
plusieurs têtes et plusieurs cerveaux, prouve que le contraire a lieu.
De tout ce que je viens de dire, il résulte qu’il faut renoncer à trouver
jamais une proportion fixe entre les différentes parties cérébrales.
Mais ceci ne doit s’entendre que des parties q u i, par elles-mêmes,
foiment un tout indépendant, et point du tout des parties intégrantes.
Chacune des parties cerebral.es qui constitue, par elle-même, un tout
indépendant, a des fonctions particulières à remplir, et doit être considérée
comme un organe propre. Ces parties, comme je l’ai déjà dit, ne
sont pas dans des proportions déterminées avec d’autres.
Mais il en est tout autrement des différens appareils qui font partie
d un seul et meme organe ; par exemple des différentes origines et des
differens appareils de renforcement du nerf optique, ou du nerf olfactif.
Il existe des proportions déterminées pour ces parties intégrantes, et
l’organe qui en résulte, de façon que par la grosseur de l’une de ces
parties intégrantes, on peut juger de la grosseur de l’organe. A insi, par
exemple, il y a une certaine proportion entre le soi-disant pont de
iVarole et le cervelet; les corps pyramidaux, là partie antérieure du
grand faisceau, (les cuisses J, les soi-disant couches optiques ouïe
grand appareil de renfort supérieur, les corps striés et les parties antérieures
et latérales des hémisphères, ont entre eux des proportions
déterminées ; mais il est évident que l’on peut bien tirer de ces
proportions qui existent entre les appareils de renfort, et entre les
parties intégrantes d’un organe, des inductions sur l’intensité de telles
facultés, mais qu’on n’en peut rien induire absolument, pour l’intensité
de toute la somme des facultés. Je ne fais ici qu’indiquer cette
conséquence ; j y reviendrai plus bas, et je la prouverai rigoureusement.