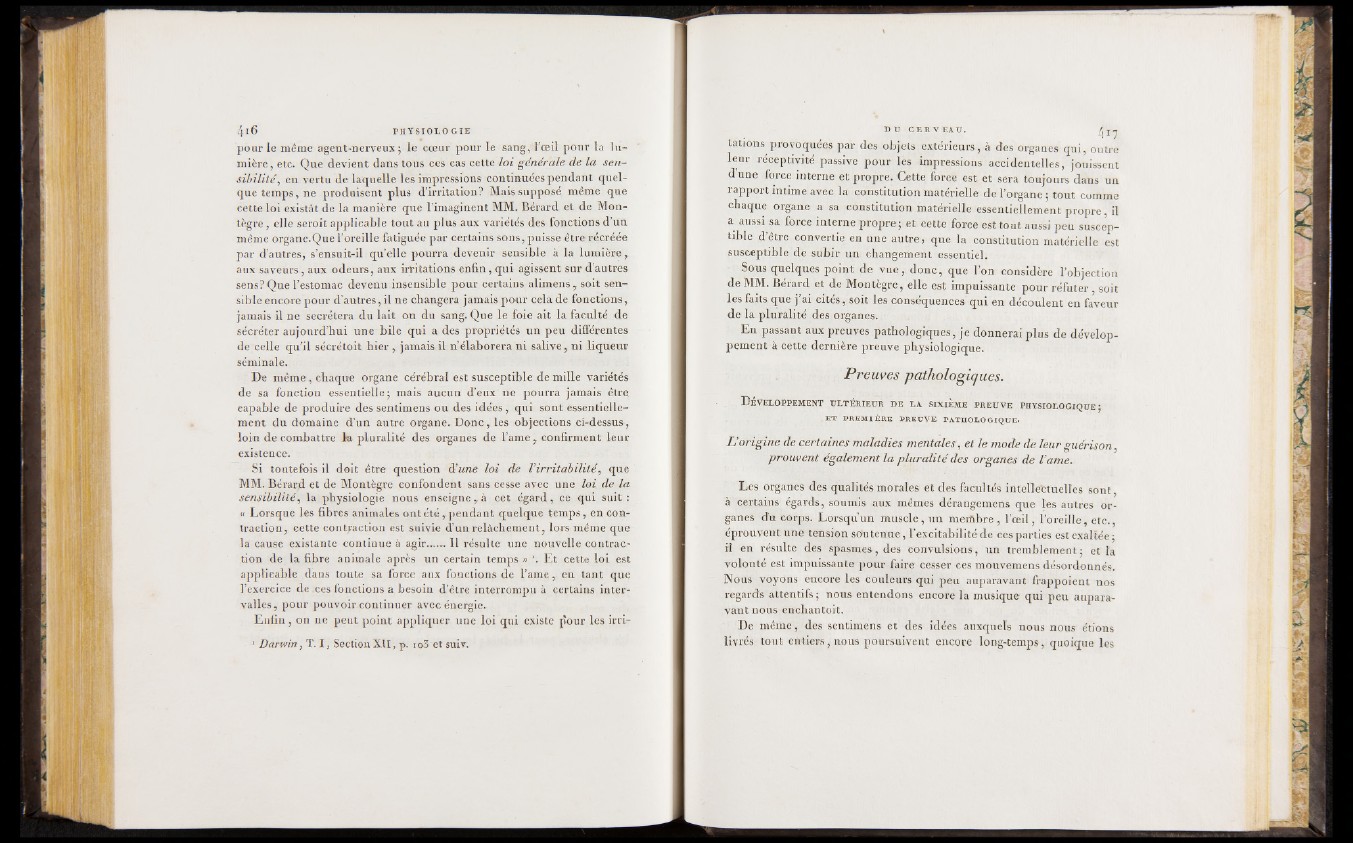
pour le même agent-nerveux; le coeur pour le sang, l’oeil pour la lumière,
etc. Que devient dans tous ces cas cette loi générale de la sensibilité',
en vertu de laquelle les impressions continuées pendant quelque
temps, ne produisent plus d’irritation? Mais supposé même que
eette loi existât de la manière que l’imaginent MM. Bérard et de Mon-
tègre, elle seroit applicable tout au plus aux variétés des fonctions d’un
même organe.Que l’oreille fatiguée par certains sons, puisse être récréée
par d’autres, s’ensuit-il qu’elle pourra devenir sensible à la lumière,
aux saveurs, aux odeurs, aux irritations enfin, qui agissent sur d’autres
sens? Que l’estomac devenu insensible pour certains alimens, soit sensible
encore pour d'autres, il ne changera jamais pour cela de fonctions,
jamais il ne secrétera du lait on du sang. Que le foie ait la faculté de
sécréter aujourd’hui une bile qui a des propriétés un peu différentes
de celle qu’il sécrétoit hier , jamais il n’élaborera ni salive, ni liqueur
séminale.
I>e même, chaque organe cérébral est susceptible de mille variétés
de sa fonction essentielle; mais aucun d’eux ne pourra jamais être:
eapable de produire des sentimens ou des idées, qui sont essentiellement
du domaine d’un autre organe. Donc , les objections ci-dessus ,
loin de combattre la pluralité des organes de l’ame , confirment leur
existence.
Si toutefois il doit être question d’une loi de l’irritabilité, que
MM. Bérard et de Montègre confondent sans cesse avec une loi de la
sensibilité, la physiologie nous enseigne,, à cet égard, ce qui suit :
« Lorsque les fibres animales ont été r pendant quelque temps, en contraction,
cette contraction est suivie d’un relâchement, lors même que
la cause existante continue à agir...™ 11 résulte une nouvelle contraction
de la fibre animale après un certain temps » ’. Et cette loi est
applicable dans toute sa force aux fonctions de l’ame, en tant que
l’exercice de xes fonctions a besoin d’être interrompu à certains intervalles,
pour pouvoir continuer avec énergie.
Enfin, on ne peut point appliquer une loi qui existe pour les irri-
1 Darwin, T. I , Section XII, p. i o3 et suiv.
DU CERVEAU. |
tâtions provoquées par des objets extérieurs, à des organes qui, outre
leur réceptivité passive pour les impressions accidentelles, jouissent
d une force interne et propre. Cette force est et sera toujours dans un
rapport intime avec la constitution matérielle de l’organe ; tout comme
chaque organe a sa constitution matérielle essentiellement propre, il
a aussi sa force interne propre ; et cette force est tout aussi peu susceptible
d’être convertie en une autre, que la constitution matérielle est
susceptible de subir un changement essentiel.
Sous quelques point de vue, donc, que l’on considère l’objection
de MM. Bérard et de Montègre, elle est impuissante pour réfuter , soit
les faits que j ai cites, soit les conséquences qui en découlent en faveur
de la pluralité des organes.
En passant aux preuves pathologiques, je donnerai plus de développement
à cette dernière preuve physiologique.
Preuves pathologiques.
Développement ultérieur de la. sixième preuve physiologique;
ET PREMIÈRE PREUVE PATHOLOGIQUE.
L ’origine de certaines maladies mentales, et le mode de leur guérison,
prouvent également la pluralité des organes de l ’ame.
Les organes des qualités morales et des facultés intellettuelles sont,
à certains égards, soumis aux mêmes dérangemens que les autres organes
du corps. Lorsqu’un muscle, un membre , l’oeil, l’oreille, etc.,
éprouvent une tension soutenue, l ’excitabilité de ces parties est exaltée ;
il en résulte des spasmes, des convulsions, un tremblement; et la
volonté est impuissante pour faire cesser ces mouvemens désordonnés.
Nous voyons encore les couleurs qui peu auparavant frappoienl nos
regards attentifs; nous entendons encore la musique qui peu auparavant
nous enchantoit.
De même, des sentimens et des idées auxquels nous nous étions
livrés tout entiers, nous poursuivent encore long-temps, quoique les
m
t-T-l
<J\
km
■