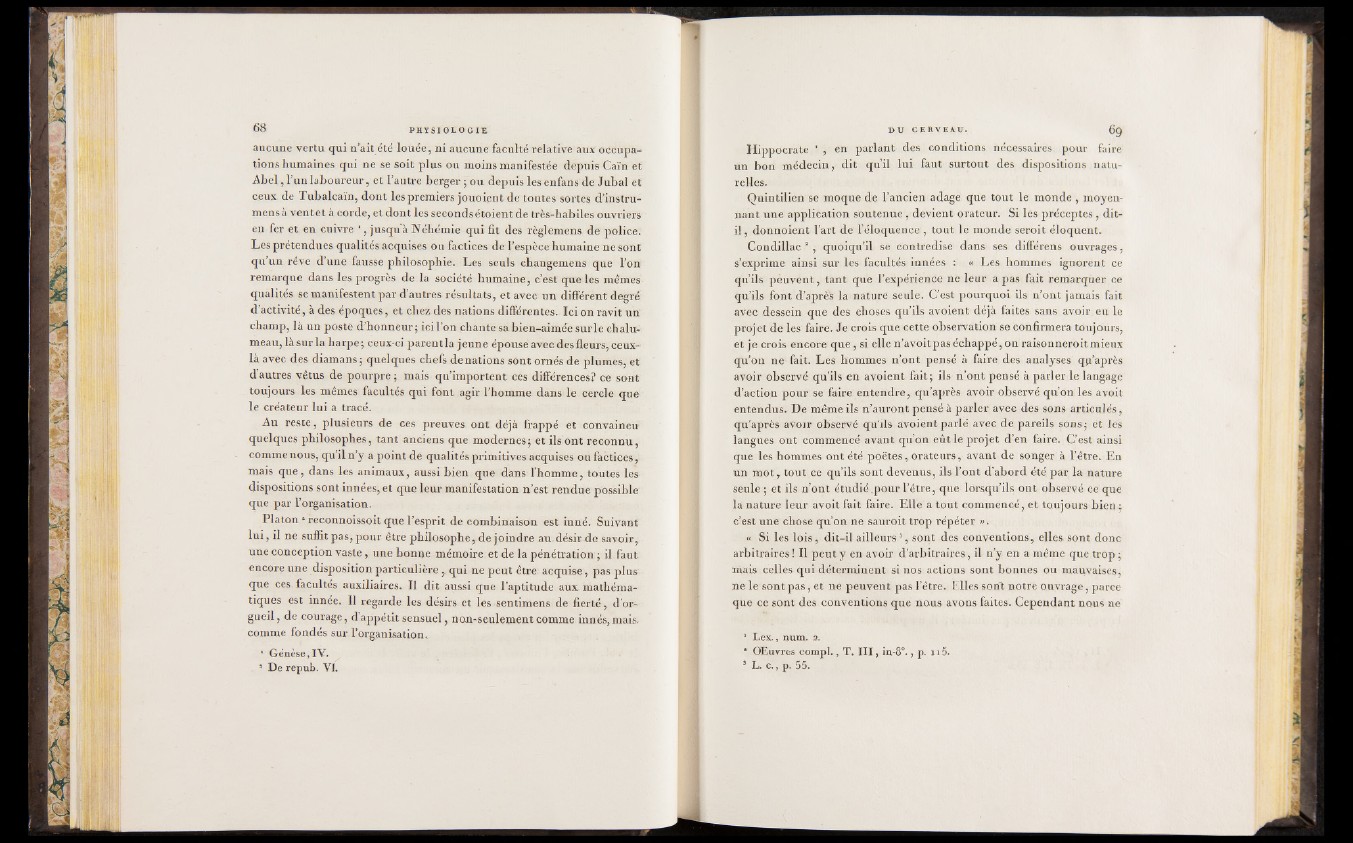
aucune vertu qui n’ait été louée, ni aucune faculté relative aux occupations
humaines qui ne se soit plus ou moins manifestée depuis Caïn et
Abel, l’un laboureur, et l’autre berger ; ou depuis lesenfans de Jubal et
ceux de Tubalcaïn, dont les premiers jouoient de toutes sortes d’instru-
mens à vent et à corde, et dont les seconds étoient de très-habiles ouvriers
en fer et en cuivre ', jusqua Néhémie qui fit des règlemens de police.
Les prétendues qualités acquises ou factices de l’espèce humaine ne sont
qu’un rêve d’une fausse philosophie. Les seuls changemens que l’oh
remarque dans les progrès de la société humaine, c’est que les mêmes
qualités se manifestent par d’autres résultats, et avec un différent degré
d’activité, à des époques, et chez des nations différentes. Ici on ravit un
champ, là un posté d’honneur; ici l’on phante sa bien-aiméesurle chalumeau,
là sur la harpe ; ceux-ci parentla jeune épouse avec des fleurs, ceux-
là avec des diamans; quelques chefs denations sont ornés de plumes, et
d autres vêtus de pourpre ; mais qu’importent ces différences? ce sont
toujours les mêmes facultés qui font agir l’homme dans le cercle que
le créateur lui a tracé.
Au reste, plusieurs de ces preuves ont déjà frappé et convaincu
quelques philosophes, tant anciens que modernes; et ils ont reconnu,
comme nous, qu’il n’y a point de qualités primitives acquises ou factices,
mais que, dans les animaux, aussi bien que dans l’homme, toutes les
dispositions sont innées, et que leur manifestation n’est rendue possible
que par l’organisation.
Platon1 reconnoissoit que l’esprit de combinaison est inné. Suivant
lui, il ne suffit pas, pour être philosophe, de joindre au.désir de savoir,
une conception vaste, une bonne mémoire et de la pénétration ; il faut
encore une disposition particulière , qui ne peut être acquise, pas plus
que ces facultés auxiliaires. Il dit aussi que l’aptitude aux mathématiques
est innée. 11 regarde les désirs et les sentimens de fierté, d’orgueil,
de courage, d appétit sensuel, non-seulement comme innés,mais,
comme fondés sur l’organisation.
* Genèse, IV.
. * De repub. VI.
Hippocrate ' , en parlant des conditions nécessaires pour faire
un bon médecin, dit qu’il lui faut surtout des dispositions naturelles.
Quintilien se moque de l’ancien adage que tout le monde , moyennant
une application soutenue , devient orateur. Si les préceptes , dit-
il, donnoient l’art de l’éloquence:, tout le monde seroit éloquent.
Condillac •* , quoiqu’il se contredise dans ses différens ouvrages,
s’exprime ainsi sur les facultés innées : « Les hommes ignorent ce
qu’ils peuvent, tant que l’expérience ne leur a pas fait remarquer ce
qu’ils font d’après la nature seule. C’est pourquoi ils n’ont jamais fait
avec dessein que des choses qu’ils avoient déjà faites sans avoir eu le
projet de les faire. Je crois que eette observation se confirmera toujours,
et je crois encore que, si elle n’avoitpaséchappé, on raisonneroit mieux
qu’on ne-fait. Les hommes n’ont pensé à faire des analyses qp’après
avoir observé qu’ils en avoient fait; ils n’ont pensé à parler le langage
d’action pour se faire entendre, qu’après avoir observé qu’on les avoit
entendus. De même ils n’auront pensé à parler avec des sons articulés,
qu’après avoir observé qu’ils avoient parlé avec de pareils sons; et les
langues ont commencé avant qu’on eût le projet d’en faire. C’est ainsi
que les hommes ont été poètes, orateurs, avant de songer à l’être. En
un mot, tout ce qu’ils sont devenus, ils l’ont d’abord été par la nature
seule ; et ils n’ont étudié.pour l’être, que lorsqu’ils ont ohservé ce que
la nature leur avoit fait faire. Elle a tout commencé, et toujours bien;
c’est une chose qu’on ne sauroit trop répéter ».
« Si les lois , dit-il ailleurs 3, sont des conventions, elles, sont donc
arbitraires ! Il peut y en avoir d’arbitraires, il n’y en a même que trop ;
mais celles qui déterminent si nos actions sont bonnes ou mauvaises,
ne le sont pas, et ne peuvent pas l’être. Elles sont notre ouvrage, parce
que ce sont des conventions que nous avons faites. Cependant nous ne
' Lex., num. a.
I OEuvres compl., T. III, in-8°., p. 115.
5 L. c ., p. 55.