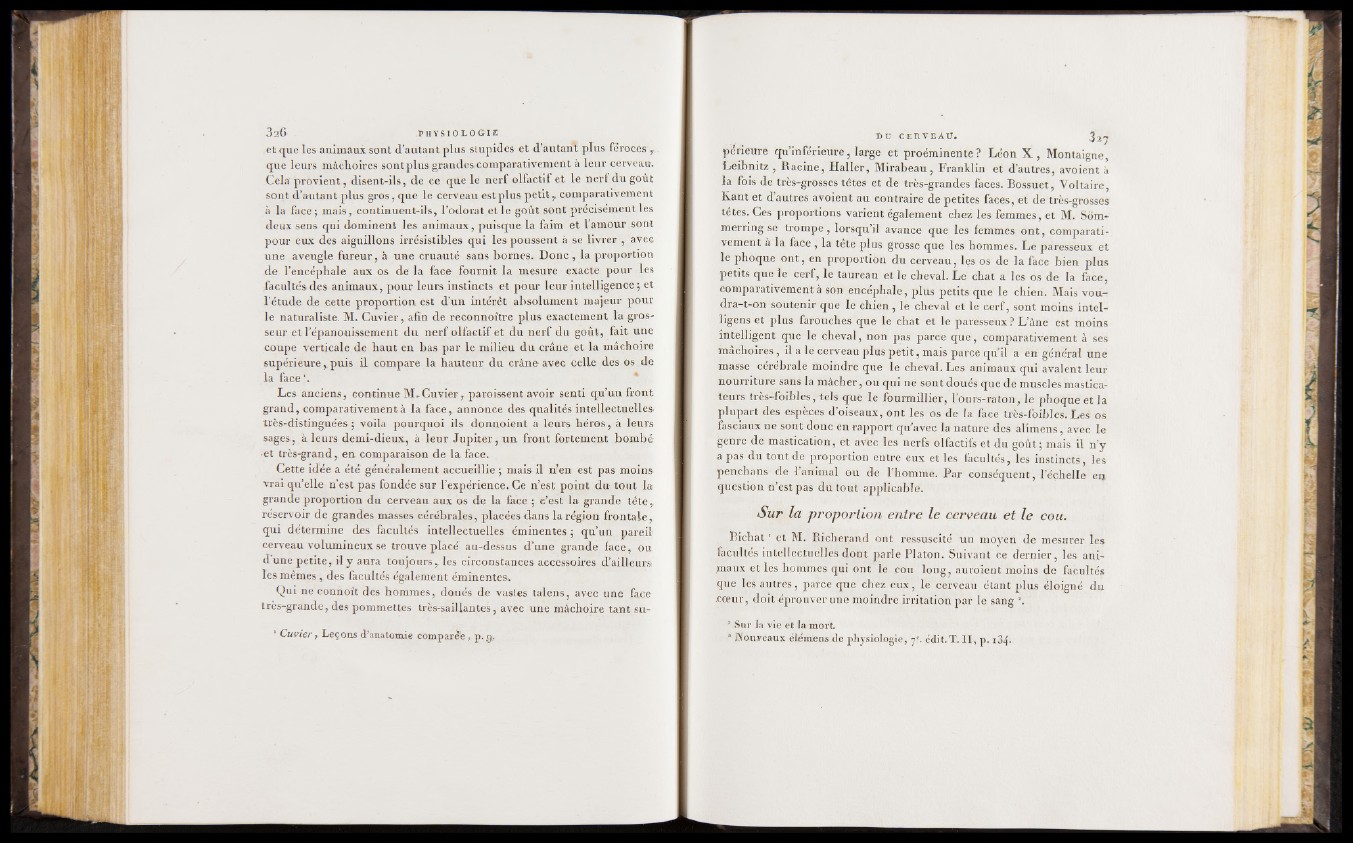
et que les animaux sont d’autant plus stupides et d’autant plus féroces ,,
que leurs mâchoires sontplus grandesuomparativement à leur cerveau.
Cela' provient, disent-ils, de ce que le nerf olfactif et le nerf du goût
sont d’autant plus gros, que le cerveau est plus petitr comparativement
à la face; mais, continuent-ils, l ’odorat et le goût sont précisément les
deux sens qui dominent les animaux, puisque la faim et L’amour sont
pour eux des aiguillons irrésistibles qui les poussent à se livrer , avec
une aveugle fureur, à une cruauté sans bornes. Donc, la proportion
de l’encéphale aux os de la face fournit la mesure exacte pour les
facultés des animaux, pour leurs instincts et pour leur intelligence ; et
l’étude de cette proportion est d’un intérêt absolument majeur pour
le naturaliste. M. Cuvier, afin de reconnoitre plus exactement la grosseur
et l’épanouissement du nerf olfactif et du nerf du goût, fait une
coupe verticale de haut en bas par le milieu du crâne et la mâchoire
supérieure,. puis il compare la hauteur du crâne avec celle des os de
la face
Les anciens, continue M.Cuvier, paroissent avoir senti qu’un front
grand, comparativement à la face, annonce des qualités intellectuelles
très-distinguées; voilà pourquoi ils donnoient à leurs héros, à leurs
sages, à leurs demi-dieux, à leur Jupiter, un front fortement bombé
■ et très-grand, en comparaison de la face.
Cette idée a été généralement accueillie ; mais il n’en est pas moins
vrai qu’elle n’est pas fondée sur l’expérience. Ce n’est point du tout la
grande proportion du cerveau aux os de la face ; c’est la grande tête,
réservoir de grandes masses cérébrales, placées dans la région frontale,
qui détermine des facultés intellectuelles éminentes ; qu’un pareil
cerveau volumineux se trouve placé au-dessus d’une grande face, ou
dune petite, il y aura toujours, les circonstances accessoires d’ailleurs
les mêmes, des facultés également éminentes.
Qui ne eonnoit des hommes, doués de vastes talens, avec une face
très-grande, des pommettes très-saillantes, avec une mâchoire tant su-
1 Cuvier y Leçons d’anatomie comparée , p. <).
përieure qu’inférieure, large et proéminente? Léon X , Montaigne,
Leibnitz , Racine, Haller, Mirabeau, Franklin et d’autres, avoient à
la fois de très-grosses têtes et de très-grandes faces. Bossuet, Voltaire,
Rant et d’autres avoient au contraire de petites faces, et de très-grosses
têtes. Ces proportions varient également chez les femmes, et M. Sôm-
merring se trompe, lorsqu’il avance que les femmes ont, comparativement
à la face, la tête plus grosse que les hommes. Le paresseux et
le phoque ont, en proportion du cerveau, lçs os de la face bien plus
petits que le cerf, le taureau et le cheval. Le chat a les os de la face,
comparativement à son encéphale, plus petits que le chien. Mais voudra
t-on soutenir que le chien, le cheval et le eerf, sont moins intel-
ligens et plus farouches que le chat et le paresseux? L’âne est moins
intelligent que le cheval, non pas parce que, comparativement à ses
mâchoires, il a le cerveau plus petit, mais parce qu’il a en général une
masse cerebrale moindre que le cheval. Les animaux qui avalent leur
nourriture sans la mâcher, ou qui né sont doués que de muscles masticateurs
très-foibles, tels què le fourmillier, l’ours-raton, le phoque et la
plupart des espèces d’oiseaux, ont les os de la face très-foibles. Les os
fasciaux ne sont donc en rapport qu'avec la nature des alimens, avec le
genre de mastication, et avec les nerfs olfactifs et du goût; mais il n’y
a pas du tout de proportion entre eux et les facultés, les instincts, les
penchans de 1 animal ou de l’homme. Par conséquent, l ’échelle eq
question n’est pas du tout applicable.
Sur la proportion entre le cerveau et le cou.
Richat 1 et M. Richerand ont ressuscité un moyen de mesurer les
facultés intellectuelles dont parle Platon. Suivant ce dernier, les ani-
qiaux et les hommes qui ont le cou long, auraient moins de facultés
que les autres, parce que chez eux, le cerveau étant plus éloigné du
cceur, doit éprouver une moindre irritation par le sang ’.
1 Sur la vie et la mort.
“ JNouyeaux élémens de physiologie, 7*. édit. T. I I , p. i 3/f