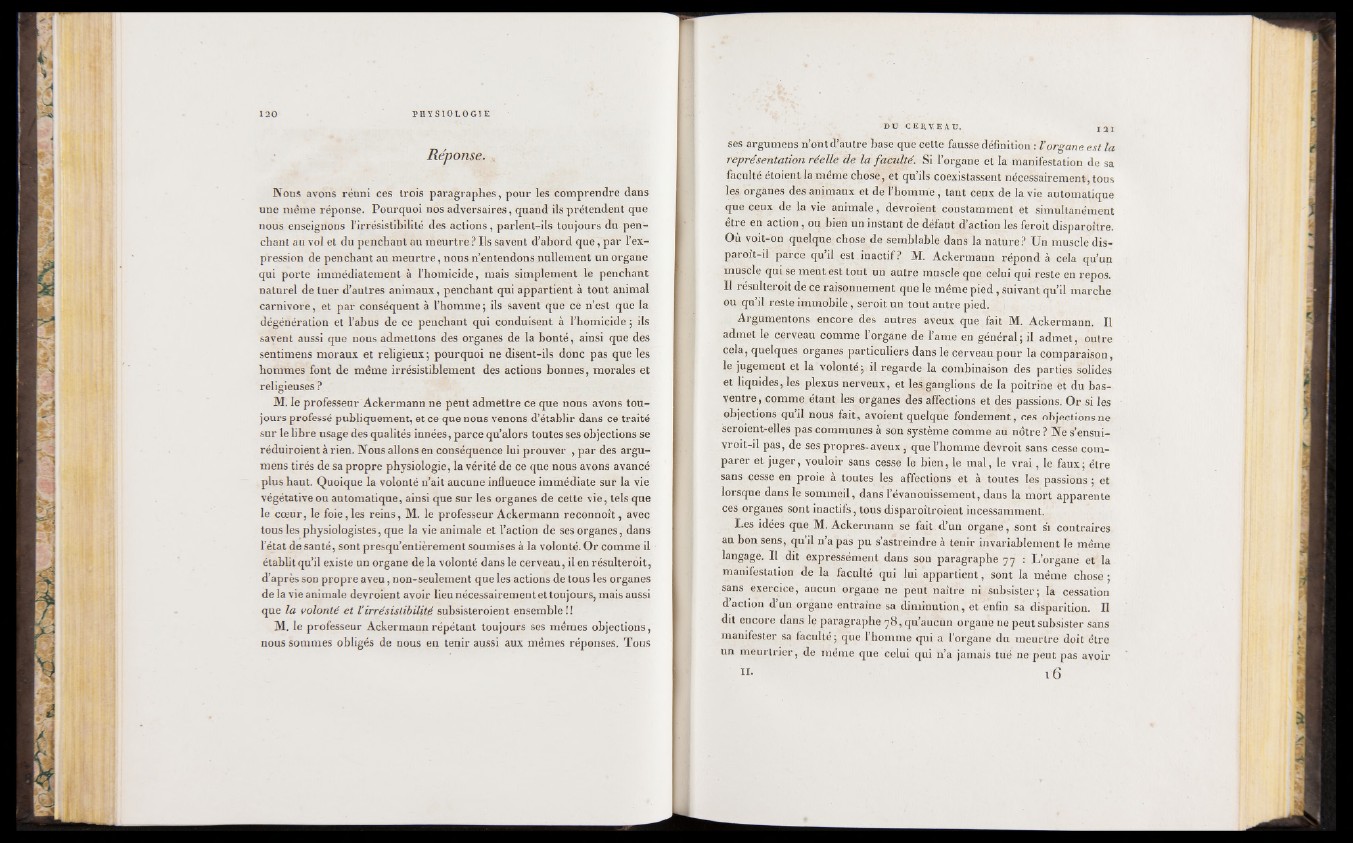
Réponse. ,
Nous avons réuni ces trois paragraphes, pour les comprendre dans
une même réponse. Pourquoi nos adversaires, quand ils prétendent que
nous enseignons l’irrésistibilité des actions, parlent-ils toujours du penchant
au vol et du penchant au meurtre Plis savent d’abord que, par l’expression
de penchant au meurtre, nous n’entendons nullement un organe
qui porte immédiatement à l’homicide, mais simplement le penchant
naturel de tuer d’autres animaux, penchant qui appartient à tout animal
carnivore, et par conséquent à l’homme; ils savent que ce n’est que la
dégénération et l’abus de ce penchant qui conduisent à l’homicide ; ils
savent aussi que nous admettons des organes de la bonté, ainsi que des
sentimens moraux et religieux ; pourquoi ne disent-ils donc pas que les
hommes font de même irrésistiblement des actions bonnes, morales et
religieuses ?
M. le professeur Ackermann ne peut admettre ce que nous avons toujours
professé publiquement, et ce que nous venons d’établir dans ce traité
sur le libre usage des qualités innées, parce qu’alors toutes ses objections se
réduiroient à rien. Nous allons en conséquence lui prouver , par des argu-
mens tirés de sa propre physiologie, la vérité de ce que nous avons avancé
plus haut. Quoique la volonté n’ait aucune influence immédiate sur la vie
végétative ou automatique, ainsi que sur les organes de cette vie, tels que
le coeur, le foie, les reins, M. le professeur Ackermann reconnoît, avec
tous les physiologistes, que la vie animale et l’action de ses organes, dans
l’état de santé, sont presqu’entièrement soumises à la volonté. Or comme il
établit qu’il existe un organe de la volonté dans le cerveau, il en résultèrent,
d’après son propre aveu, non-seulement que les actions de tous les organes
de la vie animale deyroient avoir lieu nécessairement et toujours, mais aussi
que la volonté et l’irrésistibilité subsisteroient ensemble ! !
M. le professeur Ackermann répétant toujours ses mêmes objections,
nous sommes obligés de nous en tenir aussi aux mêmes réponses. Tous
ses argumens n’ont d’autre base que cette fausse définition : l’organe est la
représentation réelle de la faculté. Si l’organe et la manifestation de sa
faculté étoient la même chose, et qu’ils coexistassent nécessairement, tous
les organes des animaux et de l’homme, tant ceux de la vie automatique
que ceux de la vie animale, devroient constamment et simultanément
être en action, ou bien un instant de défaut d’action les feroit disparoître.
Ou voit-on quelque chose de semblable dans la nature? Un muscle dis-
paroît-il parce qu’il est inactif? M. Ackermann répond à cela qu’un
muscle qui se meut est tout un autre muscle que celui qui reste en repos.
Il résulteroit de ce raisonnement que le même pied, suivant qu’il marche
ou qu’il reste immobile, seroit un tout autre pied.
Argumentons encore des autres aveux que fait M. Ackermann. Il
admet le cerveau comme l’organe de l’ame en général ; il admet, oulre
cela, quelques organes particuliers dans le cerveau pour la comparaison,
le jugement et la volonté ; il regarde la combinaison des parties solides
et liquides, les plexus nerveux, et les ganglions de la poitrine et du bas-
ventre, comme étant les organes des affections et des passions. Or si les
objections qu’il nous fait, avoient quelque fondement, ces objections ne
seroient-elles pas communes à son système comme au nôtre? Ne s’ensui-
vroit-il pas, de ses propres-aveux, que l’homme devroit sans cesse comparer
et juger, vouloir sans cesse le bien, le mal, le vrai, le faux; être
sans cesse en proie à toutes les affections et à toutes les passions ; et
lorsque dans le sommeil, dans l’évanouissement, dans la mort apparente
ces organes sont inactifs, tous disparoitroient incessamment.
Les idées que M. Ackermann se fait d’un organe, sont st contraires
au bon sens, quil n a pas pu s’astreindre à tenir invariablement le même
langage. Il dit expressément dans son paragraphe 77 : L ’organe et la
manifestation de la faculté qui lui appartient, sont la même chose ;
sans exercice, aucun organe ne peut naître ni subsister; la cessation
daction d’un organe entraîne sa diminution, et enfin sa disparition. II
dit encore dans le paragraphe 78, qu’aucun organe ne peut subsister sans
manifester sa faculté; que 1 homme qui a l’organe du meurtre doit être
un meurtrier, de même que celui qui n’a jamais tué ne peut pas avoir
XI. 16