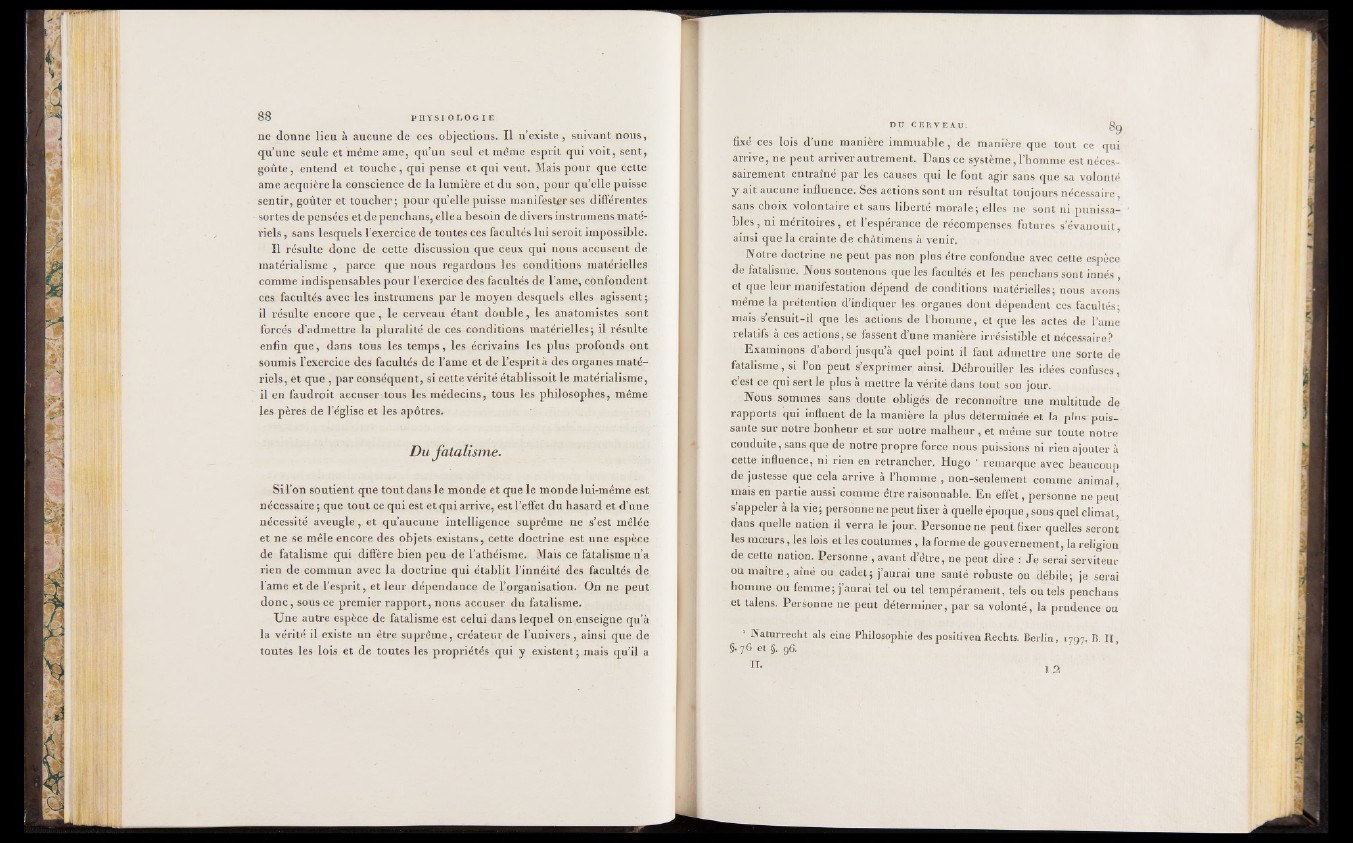
ne donne lieu à aucune de ces objections. Il n’existe , suivant nous,
qu’une seule et même ame, qu’un seul et même esprit qui voit, sent,
goûte, entend et touche , qui pense et qui veut. Mais pour que cette
ame acquière la conscience de la lumière et du son, pour qu’elle puisse
sentir, goûter et toucher; pour quelle puisse manifester ses différentes
sortes de pensées et de penchans, elle a besoin de divers instrumens matériels
, sans lesquels l’exercice de toutes ces facultés lui seroit impossible.
Il résulte donc de cette discussion que Ceux qui nous accusent de
matérialisme , parce que nous regardons les conditions matérielles
comme indispensables pour l’exercice des facultés de l’ame, confondent
ces facultés avec les instrumens parle moyen desquels elles agissent;
il résulte encore que , le cerveau étant double, les anatomistes sont
forcés d’admettre la pluralité de ces conditions matérielles; il résulte
enfin que, dans tous les temps, les écrivains les plus profonds ont
soumis l’exercice des facultés de l’ame et de l’esprit à des organes matériels
, et que , par conséquent, si cette vérité établissoit le matérialisme,
il en faudroit accuser tous les médecins, tous les philosophes, même
les pères de l’église et les apôtres.
Du fata lisme.
Si l’on soutient que tout dans le monde et que le monde lui-même est
nécessaire ; que tout ce qui est et qui arrive, est l’effet du hasard et d’une
nécessité aveugle, et qu’aucune intelligence suprême ne s’est mêlée
et ne se mêle encore des objets existans, cette doctrine est une espèce
de fatalisme qui diffère bien peu de l’athéisme. Mais ce fatalisme n’a
rien de commun avec la doctrine qui établit l’innéité des facultés de
lame et de l’esprit, et leur dépendance de l’organisation. On ne peut
donc, sous ce premier rapport, nous accuser du fatalisme.
Une autre espèce de fatalisme est celui dans lequel on enseigne qu’à
la vérité il existe un être suprême, créateur de l’univers, ainsi que de
toutes les lois et de toutes les propriétés qui y existent; mais qu’il a
du cerveau. 89 fixé ces lois d’une manière immuablede manière que tout ce qui
arrive, ne peut arriver autrement. Dans ce système, l’homme est nécessairement
entraîne par les causes qui le font agir sans que sa volonté
y ait aucune influence. Ses actions sont un résultat toujours nécessaire,
sans choix volontaire et sans liberté morale; elles ne sont ni punissables,
ni méritoires, et l’espérance de récompenses futures s’évanouit,
ainsi que la crainte de châtimens à venir.
Notre doctrine ne peut pas non plus être confondue avec cette espèce
de fatalisme, Nous soutenons que les facultés et les penchans sont innés
et que leur manifestation dépend de conditions matérielles; nous avons
même la prétention d’indiquer les organes dont dépendent ces facultés-
mais s’ensuit-il que les actions de l’homme, et que les actes de l’ame
relatifs à ces actions, se fassent d’une manière irrésistible et nécessaire?
Examinons d’abord jusqu’à quel point il faut admettre une sorte de
fatalisme, si Ion peut s exprimer ainsi. Débrouiller les idées confuses,
c est ce qui sert le plus a mettre la vérité dans tout sou jour.
Nous sommes sans doute obligés de reconnoître une multitude de
rapports qui influent de la manière la plus déterminée et la plus puissante
sur notre bonheur et sur notre malheur , et même sur toute notre
conduite, sans que de notre propre force nous puissions ni rien ajouter à
cette influence, ni rien en retrancher. Hugo ' remarque avec beaucoup
de justesse que cela arrive à l’homme , non-seulement comme animal
mais en partie aussi comme être raisonnable. En effet, personne ne peut
s appeler à la vie; personne ne peut fixer à quelle époque, sous quel climat,
dans quelle nation il verra le jour. Personne ne peut fixer quelles seront
les moeurs, les lois et les coutumes , la forme de gouvernement, la religion
de cette nation. Personne , avant d’être, ne peut dire : Je serai serviteur
ou maître, aîné ou cadet; j’aurai une santé robuste ou débile; je serai
homme ou femme; j’aurai tel ou tel tempérament, tels ou tels penchans
et talens. Personne ne peut déterminer, par sa volonté, la prudence ou
Naturrecht als eine Philosophie des positiven Rechis. Berlin. 1707. B. II
§.76 et §. 96.
ü ia