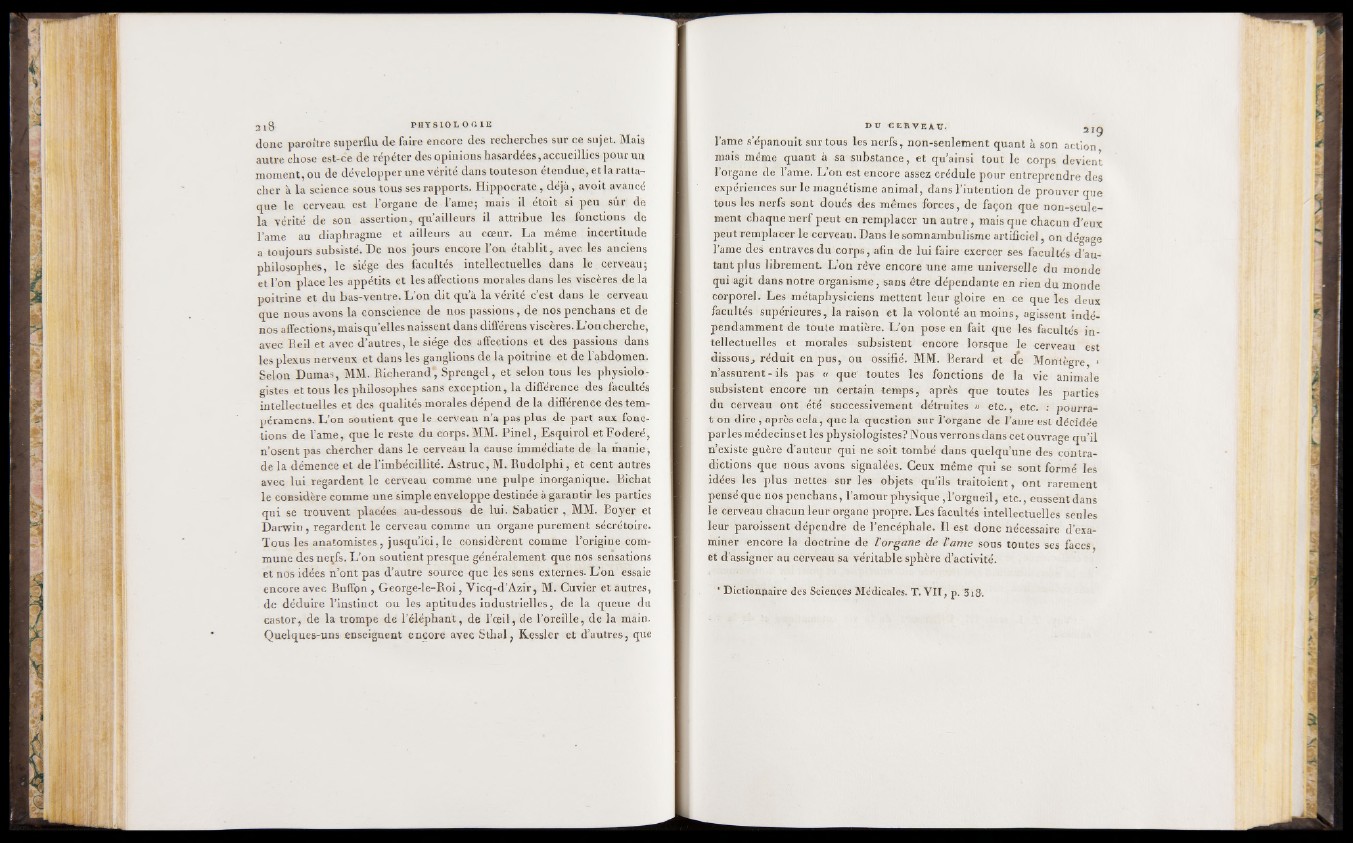
donc paroître superflu de faire encore des recherches sur ce sujet. Mais
autre chose est-ce de répéter des opinions hasardées, accueillies pour un
moment, ou de développer une vérité dans toute son étendue, et la rattacher
à la science sous tous ses rapports. Hippocrate , déjà, avoit avancé
que le cerveau est l’organe de l’ame; mais il étoit si peu sûr de
la vérité de son assertion, qu’ailleurs il attribue les fonctions de
l’ame au diaphragme et ailleurs au coeur. La même incertitude
a toujours subsisté. De nos jours encore l’on établit, avec les anciens
philosophes, le siège des facultés intellectuelles dans le cerveau;
et l’on plaee les appétits et les affections morales dans les viscères de la
poitrine et du bas-ventre. L ’on dit qu’à la vérité c’est dans le cerveau
que nous avons la conscience de nos passions, de nos penchans et de
nos affections, mais qu’elles naissent dans différens viscères. L’on cherche,
avec Reil et avec d’autres, le siège des affections et des passions dans
les plexus nerveux et dans les ganglions de la poitrine et de l’abdomen.
Selon Dumas, MM. Richerand' Sprengel, et selon tous les physiologistes
et tous les philosophes sans exception, la différence des facultés
intellectuelles et des qualités morales dépend de la différence des tem-
péramens. L ’on soutient que le cerveau n’a pas plus de part aux fonctions
de lame, que le reste du corps.MM. Pinel, Esquirol et Foderé,
n’osent pas chercher dans le cerveau la cause immédiate de la manie,
de la démence et de l’imbécillité. Astruc, M. Rudolphi, et cent autres
avec lui regardent le cerveau comme une pulpe inorganique. Bichat
le considère comme une simple enveloppe destinée à garantir les parties
qui se trouvent placées au-dessous de lui. Sabatier , MM. Boyer et
Darwin, regardent le cerveau comme, un organe purement sécrétoire.
Tous les anatomistes, jusqu’ici, le considèrent comme l’origine commune
des neçfs. L ’on soutient presque généralement que nos sensations
et nos idées n’ont pas d’autre source que les sens externes. L’on essaie
encore avec Buffon , George-le-Roi, Yicq-d’Azir, M. Cuvier et autres,
de déduire l ’instinct ou les aptitudes industrielles, de la queue du
castor, de la trompe de l’éléphant, de l’oeil, de l’oreille, de la main.
Quelques-uns enseignent encore avec S thaï, Kessler et d’autres, que
l’ame s’épanouit sur tous les nerfs, non-seulement quant à son action
mais même quant à sa substance, et qu’ainsi tout le corps devient
l ’organe de l’ame. L ’on est encore assez crédule pour entreprendre des
expériences sur le magnétisme animal, dans l’intention de prouver que
tous les nerfs sont doués des mêmes forces, de façon que non-seulement
chaque nerf peut en remplacer un autre, mais que chacun d’eux
peut remplacer le cerveau. Dans le somnambulisme artificiel, on dégage
l’ame des entraves du corps, afin de lui faire exercer ses facultés d’autant
plus librement. L’on rêve encore une ame universelle du monde
qui agit dans notre organisme, sans être dépendante en rien du monde
corporel. Les métaphysiciens mettent leur gloire en ce que les deux
facultés supérieures, la raison et la volonté au moins, agissent indépendamment
de toute matière. L ’on pose en fait que les facultés intellectuelles
et morales subsistent encore lorsque le cerveau est
dissousj réduit en pus, ou ossifié. MM. Berard et d*e Montègre *
n’assurent - ils pas « que' toutes les fonctions de la vie animale
subsistent encore un certain temps, après que toutes les parties
du cerveau ont été successivement détruites » etc., etc. : pourra-
t-on dire, après cela, que la question sur l'organe de l ’ame est décidée
parles médecinset les physiologistes? Nous verrons dans cet ouvrage qu’il
n’existe guère d’auteur qui ne soit tombé dans quelqu’une des contradictions
que nous avons signalées. Ceux même qui se sont formé les
idées les plus nettes sur les objets qu’ils traitoient, ont rarement
pensé que nos penchans, l’amour physique, l’orgueil, etc., eussentdans
le cerveau chacun leur organe propre. Les facultés intellectuelles seules
leur paroissent dépendre de l’encéphale. Il est donc nécessaire d’examiner
encore la doctrine de Vorgane de l'ame sous toutes ses faces,
et d’assigner au cerveau sa véritable sphère d’activité.
* Dictionnaire des Sciences Médicales. T. Y II, p. 5i8-,