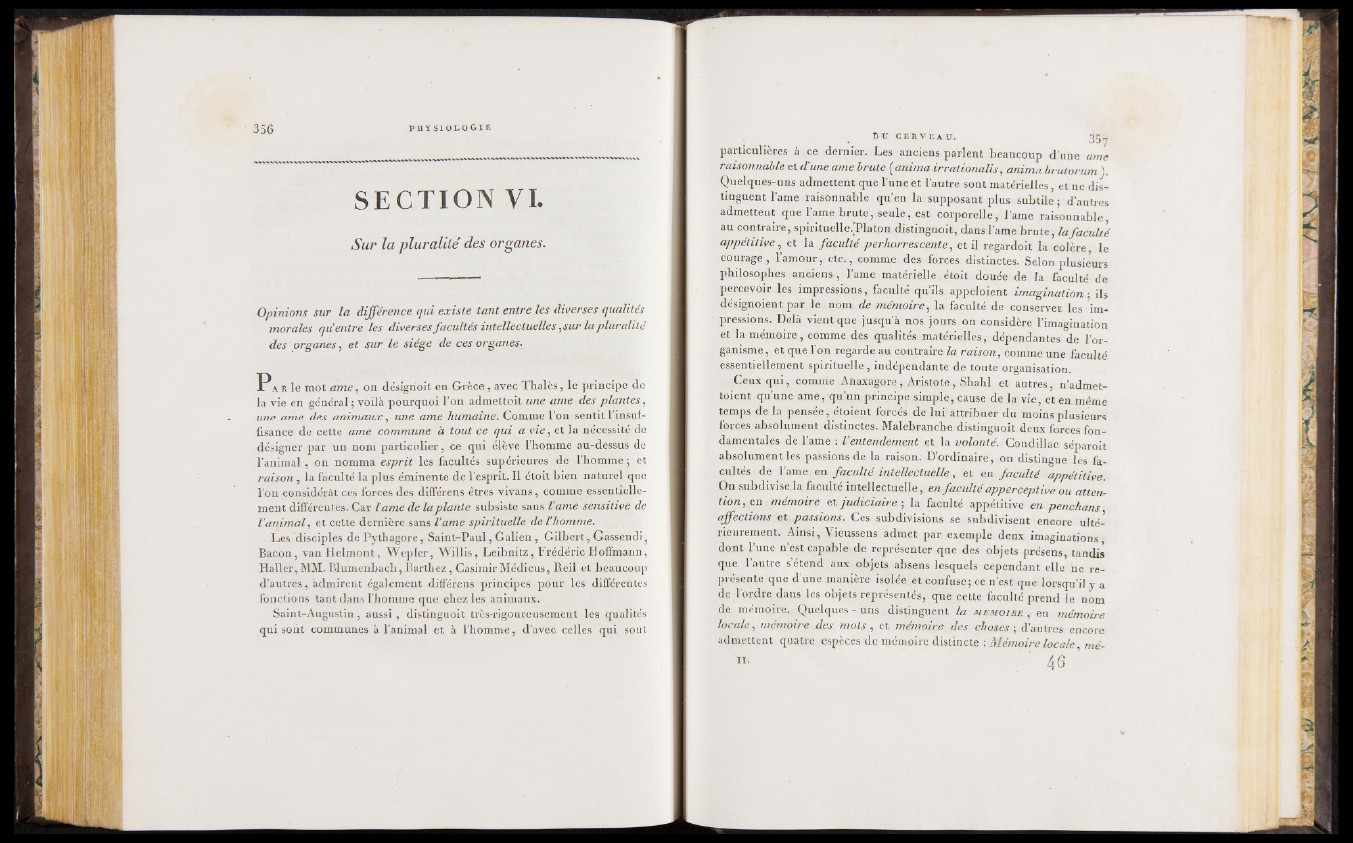
3 5 6 V HY S1OX.0 G! E
S E C T ION VI.
Sur la pluralité des organes.
Opinions sur la différence qui existe tant entre les diverses qualités
morales qu’entre les diverses facultés intellectuelles ,sur la pluralité
des organes, et sur le siège de ces organes.
P a R le mot ame, on désigrioit en Grèce, avec Thalès, le principe de
la vie en général ; voilà pourquoi Ton admettoit une ame des plantes,
une ame des animaux, une ame humaine. Comme l'on sentit l’insuffisance
de cette ame commune à tout ce qui a vie, et la nécessité de
désigner par un nom particulier, ce qui élève l’homme au-dessus de
l’animal , on nomma esprit les facultés supérieures de l’homme ; et
raison, la faculté la plus éminente de l’esprit. Il étoit bien naturel que
l ’on considérât ces forces des différens êtres vivans, comme essentiellement
différentes. Car lame de la plante subsiste sans l’ame sensitive de
l ’animal, et cette dernière sans l’ame spirituelle de l’homme.
Les ’disciples de Pythagore, Saint-Paul, Galien , Gilbert, Gassendi,
Bacon, vanHelmont, Wepfer, Willis, Leibnitz, Frédéric Hoffmann,
Haller, MM. Blumenbach, Barthez, Casimir Médicus, Reil et beaucoup
d’autres, admirent également différens principes pour les différentes
fonctions tant dans l’homme que chez les animaux.
Saint-Augustin, aussi, distinguoit très-rigoureusement les qualités
qui sont communes à l’animal et à l’homme, d’avec celles qui sont
I 357
particulières à ce dernier. Les anciens parlent beaucoup d’une ame
raisonnable et d’une ame brute (anima irrationalis, anima brutorum ).
Quelques-uns admettent que l’une et l’autre sont matérielles, et ne distinguent
lame raisonnable qu’en la supposant plus subtile ; d’autres
admettent que l’ame brute, seule, est corporelle, i’ame raisonnable
au contraire, spirituelle/Platon distinguoit, dansl’ame brute, la faculté
appétitive, et la faculté perhorrescente, et il regardoit la colère le
courage , l’amour, etc., comme des forces distinctes. Selon plusieurs
philosophes anciens , lame matérielle étoit douée de la faculté de
percevoir les impressions, faculté qu’ils appeloient imagination • ils
désignoient par le nom de mémoire, la faculté de conserver les impressions.
Delà vient que jusqu’à nos jours on considère l’imagination
et la mémoire, comme des qualités matérielles, dépendantes de l’organisme,
et que l’on regarde au contraire la raison, comme une faculté
essentiellement spirituelle, indépendante de toute organisation.
Ceux qui, comme Aùaxagore , Aristote, Shahl et autres, n’admet-
toient qu’une ame, qu’un principe simple, cause de la vie, et en même
temps de la pensée, étaient forcés de lui attribuer du moins plusieurs
forces absolument distinctes. Malebranche distinguoit deux forces fondamentales
de l’ame : l’entendement et la volonté. Condillac séparoit
absolument les passions de la raison. D’ordinaire, on distingue les facultés
de lame en faculté intellectuelle, et en faculté appétitive.
On subdivise la faculté intellectuelle, en faculté apperceptive ou attention,
en mémoire et judiciaire ; la faculté appétitive en penchons
affections et passions. Ces subdivisions se subdivisent encore ultérieurement.
Ainsi, Vieussens admet par exemple deux imaginations
dont l’une n’est capable de représenter que des objets présens, tandis
que 1 autre s étend aux objets absens lesquels cependant elle ne représente
que d’une manière isolée et confuse; ce n’est que lorsqu’il y a
de l’ordre dans les objets représentés, que cette faculté prend le nom
de mémoire. Quelques - uns distinguent la mémoire , en mémoire
locale, mémoire des mots , et mémoire des choses-, d’autres encore
admettent quatre espèces de mémoire distincte : Mémoire locale mé-
II, 46 ’