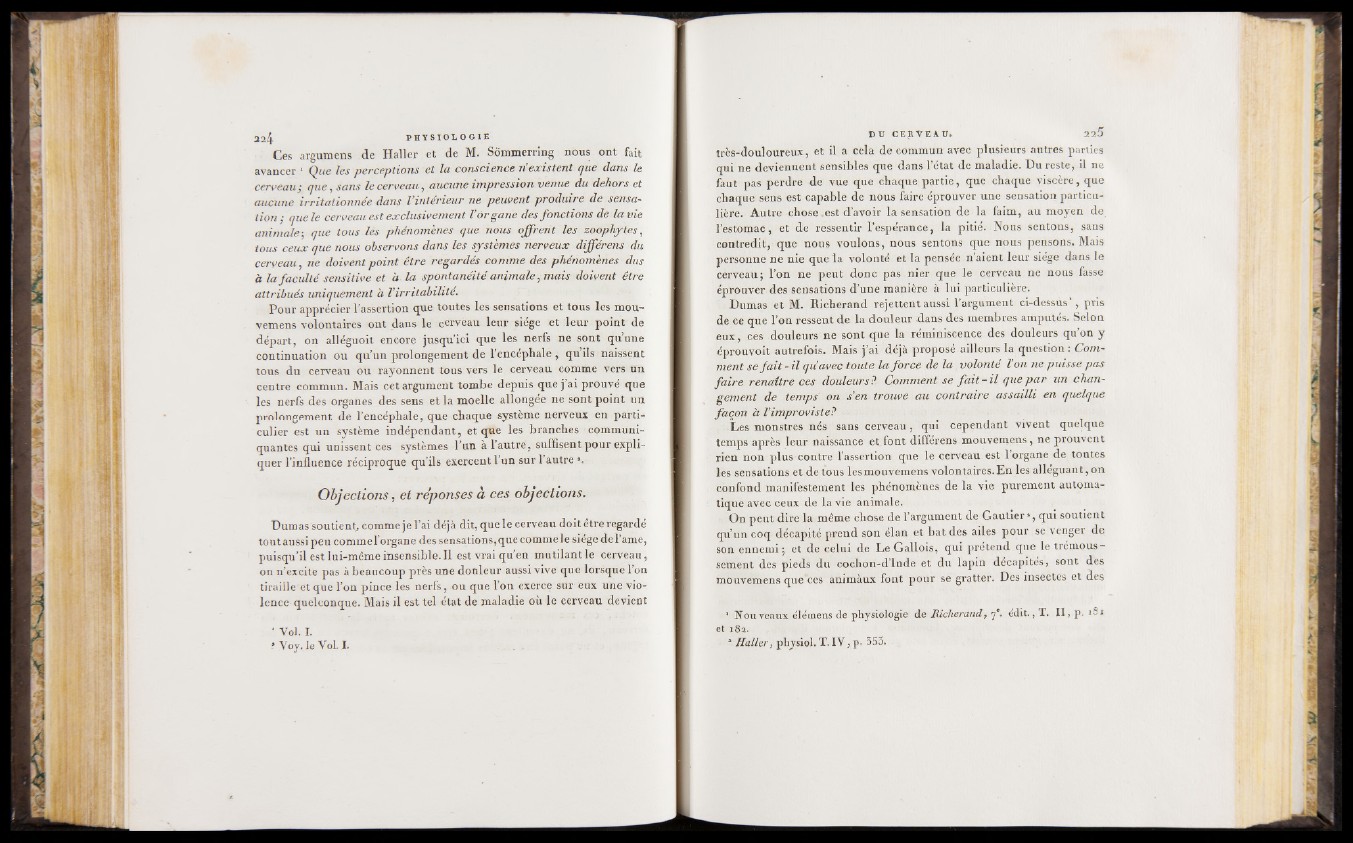
Hg
224 PHYSIOLOGIE
H 3 Ces argumens de Haller et de M. Sômmerring nous ont fait
1 H H avancer 1 Qwe les perceptions et lu conscience n existent (jue duns le cerveau y (jue 7 sans le cerveau ? aucune impression venue du dehors et
aucune irritationnée dans Vintérieur ne peuvent produire de sensa-
tion; que le cerveau est exclusivement l ’organe des fonctions de la vie
animale; que tous lés phénomènes que nous offrent les zoophytes,
tous ceux que nous observons dans les systèmes nerveux différens du
cerveau, ne doivent point être regardés comme des phénomènes dus B à la faculté sensitive et à la spontanéité animale, mais doivent être
H
attribués uniquement à l’irritabilité.
Hy.
Pour apprécier l ’assertion que toutes les sensations et tous les mouvemens
volontaires ont dans le cerveau leur siège et leur point de
H j départ, on alléguoil encore jusqu’ici que les nerfs ne sont qu’une
continuation ou qu’un prolongement de l’encéphale , qu’ils naissent
tous du cerveau ou rayonnent tous vers le cerveau comme vers un
centre commun. Mais cet argument tombe depuis que j’ai prouvé que
I H v i les nerfs des organes des sens et la moelle allongée ne sont point un
H
prolongement de l’encéphale, que chaque système nerveux en particulier
est un système indépendant, et que les branches 'communiquantes
qui unissent ces systèmes l’un à l’autre, suffisent pour expliquer
l’influence réciproque qu’ils exercent l’un sur l’autre *.
O b je c tio n s , et réponses à ces objections.
1P Dumas soutient, comme je l’ai déj à dit, que le cerveau doit être regardé
■ tout aussi peu commel’organe des sensations,que comme le siège de l’ame,
puisqu’il est lui-même insensible. Il est vrai qu’en mutilant le cerveau,
■ on n’excite pas à beaucoup près une douleur aussi vive que lorsque l’on
tiraille et que l’on pince les nerfs, ou que l’on exerce sur eux une violence
quelconque. Mais il est tel état de maladie où le cerveau devient
’ Vol. I.
11 ? V oy. le Vol. I. . .
1 I
1
H Hfl ~~ K g *
très-douloureux, et 11 a cèla de commun avec plusieurs autres parties
qui ne deviennent sensibles que dans l'état de maladie. Du reste, il ne
faut pas perdre de vue que chaque partie, que chaque viscère, que
chaque sens est capable de nous faire éprouver une sensation particulière.
Autre chose .est d’avoir la sensation de la faim, au moyen de
l’estomac, et de ressentir l ’espérance, la pitié. Nous sentons, sans
contredit, que nous voulons, nous sentons que nous pensons. Mais
personne ne nie que la volonté et la pensée n’aient leur siège dans le
cerveau; l’on ne peut donc pas nier que le cerveau ne nous fasse
éprouver des sensations d’une manière à lui particulière.
Dumas et M. Richerand rejettent aussi l’argument ci-dessus1, pris
de ce que l’on ressent de la douleur dans des membres amputes. Selon
eux, ces douleurs ne sont que la réminiscence des douleurs qu’on y
éprouvoit autrefois. Mais j’ai déjà propose ailleurs.la question : Comment
se fait - il qu’avec toute la force de la volonté l’on ne puisse pas
faire renaître ces douleurs?. Comment se fa i t - i l que par un changement
de temps' on s’en trouve au contraire assailli en quelque
façon à l ’improviste?
Les monstres nés sans cerveau, qui cependant vivent quelque
temps après leur naissance et font différens mouvemens, ne prouvent
rien non plus contre l’assertion que le cerveau est 1 organe de toutes
les sensations et de tous les mouvemens volontaires. En les alléguant, on
confond manifestement les phénomènes de la vie purement automatique
avec ceux de la vie animale.
On peut dire la même chose de l’argument de Gautier *, qui soutient
qu’un coq décapité prend son élan et bat des ailes pour se venger de
son ennemi; et de celui de Le Gallois, qui prétend que le trémoussement
des pieds du cochon-d’lnde et du lapin décapités, sont des
mouvemens que'ces animaux font pour se gratter. Des insectes et des
1 Nouveaux éléinens de physiologie de liichcnind, y*, édit., T, I I , p. 1 i
et 182.
Haller, physiol. T. IV , p. 353.