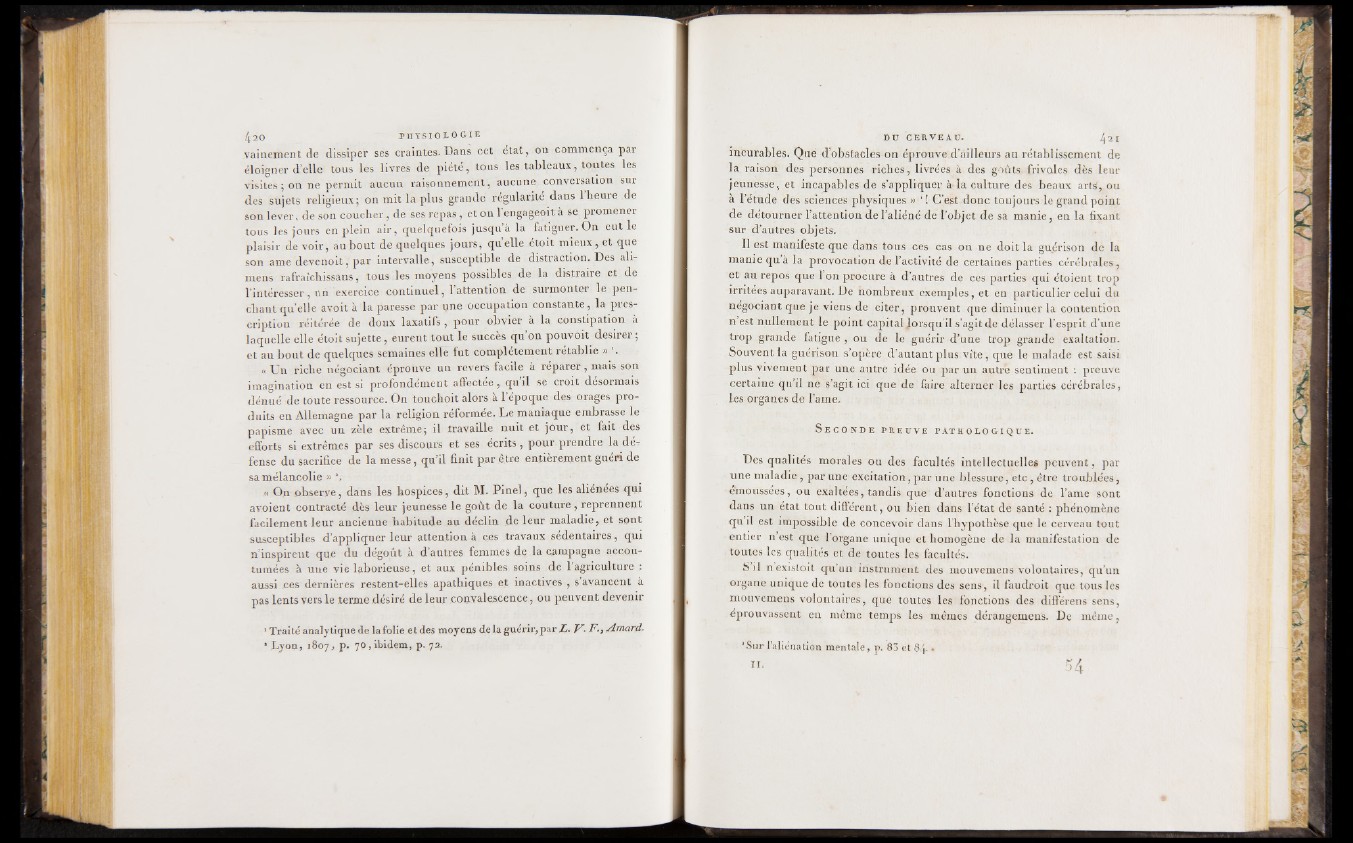
vainement de dissiper ses craintes. Dans cet état, on commença par
éloigner d’elle tous les livres de piété, tous les tableaux, toutes les
visites; on ne permit aucun raisonnement, aucune conversation sur
des sujets religieux; on mit la plus grande régularité dans 1 heure de
son lever, de son coucher, de ses repas, et on l’engageoit à se promener
tous les jours en plein air, quelquefois jusqu’à là fatiguer. On eut le
plaisir devoir, au bout de quelques jours, quelle étoit mieux, et que
son ame devenoit,par intervalle, susceptible de distraction. Des ali—
mens rafraîcliissans, tous les moyens possibles de la distraire et de
l’intéresser, un exercice continuel, l’attention de surmonter le penchant
quelle avoit à la paresse par une occupation constante, la prescription
réitérée de doux laxatifs, pour obvier à la constipation à
laquelle elle étoit sujette|eurent tout le succès qu’on pouvoit desirer ;
et au bout de quelques semaines elle fut complètement rétablie » '.
» Un riche négociant éprouve un revers facile à réparer, mais son
imagination en est si profondément affectée, qu’il se croit désormais
dénué de toute ressource. On touchoit alors à l'époque des orages produits
en Allemagne par la religion réformée. Le maniaque embrasse le
papisme avec un zèle extrême; il travaille nuit et jôur, et fait des
efforts si extrêmes par ses discours et ses écrits , pour prendre la défense
du sacrifice de la messe, qu il finit par être entièrement guéri de
sa mélancolie » %
« On obserye, dans les hospices, dit M. Pinel, que les aliénées qui
avoient contracté dès leur jeunesse le goût de la couture, reprennent
facilement leur ancienne habitude au déclin de leur maladie, et sont
susceptibles d’appliquer leur attention à ces travaux sédentaires, qui
n’inspirent que du dégoût a d autres femmes de la campagne accoutumées
à une yie laborieuse, et aux pénibles soins de 1 agriculture ;
aussi ces dernières restent-elles apathiques et inactives , s avancent à
pas lents vers le terme désiré de leur convalescence, ou peuvent devenir 1
1 Traité analytique de la folie et des moyens de la guérir, par A. V F-> Amard
' Lyon, 1807., p. 70,ibidem, p. 72.
incurables. Que d’obstacles on éprouve d’ailleurs au rétablissement de
la raison des personnes riches, livrées à des goûts frivoles dès leur
jeunesse, et incapables de s’appliquer à la culture des beaux arts, ou
à l’étude des sciences physiques >».;* ! C’est donc toujours le grand point
de détourner l’attention de l’aliéné de l’objet de sa manie, en la fixant
sur d’autres objets.
Il est manifeste que dans tous ces cas on ne doit la guérison de la
manie quà la provocation de l’activité de certaines parties cérébrales,
et au repos que 1 on procure à d’autres de ces parties qui étoient trop
irritées auparavant. De nombreux exemples, et en particulier celui du
négociant que je viens de citer, prouvent que diminuer la contention
n est nullement le point capital .lorsqu'il s’agit de délasser l’esprit d’une
trop grande fatigue , ou de le guérir d’une trop grande exaltation.
Souvent la guérison s’opère d’autant plus vite, que le malade est saisi
plus vivement par une autre idée ou par un autre sentiment : preuve
certaine qu’il ne s’agit ici que de faire alterner les parties cérébrales,
les organes de l’ame.
S e c o n d e p r e u v e p a t h o l o g i q u e .
Des qualités morales ou des facultés intellectuelle* peuvent, par
une maladie, par une excitation, par une blessure, etc, être troublées,
e'moussees, ou exaltées, tandis que d’autres fonctions de l’ame sont
dans un état tout différent, ou bien dans l’état de santé : phénomène
qu il est impossible de concevoir dans l hypothèse que le cerveau tout
entier n est que l’organe unique et homogène de la manifestation de
toutes les qualités et de toutes les facultés.
S il n exisloit qu’un instrument des mouvemens volontaires, qu’un
organe unique de toutes les fonctions des sens, il faudroit que tous les
mouvemens volontaires, que toutes les fonctions des différens sens,
éprouvassent en même temps les mêmes dérangemens. De même,
Sur l’aliénation mentale, p. 83 et 84. •
II. je /
m
osa
RJ
§CTaL