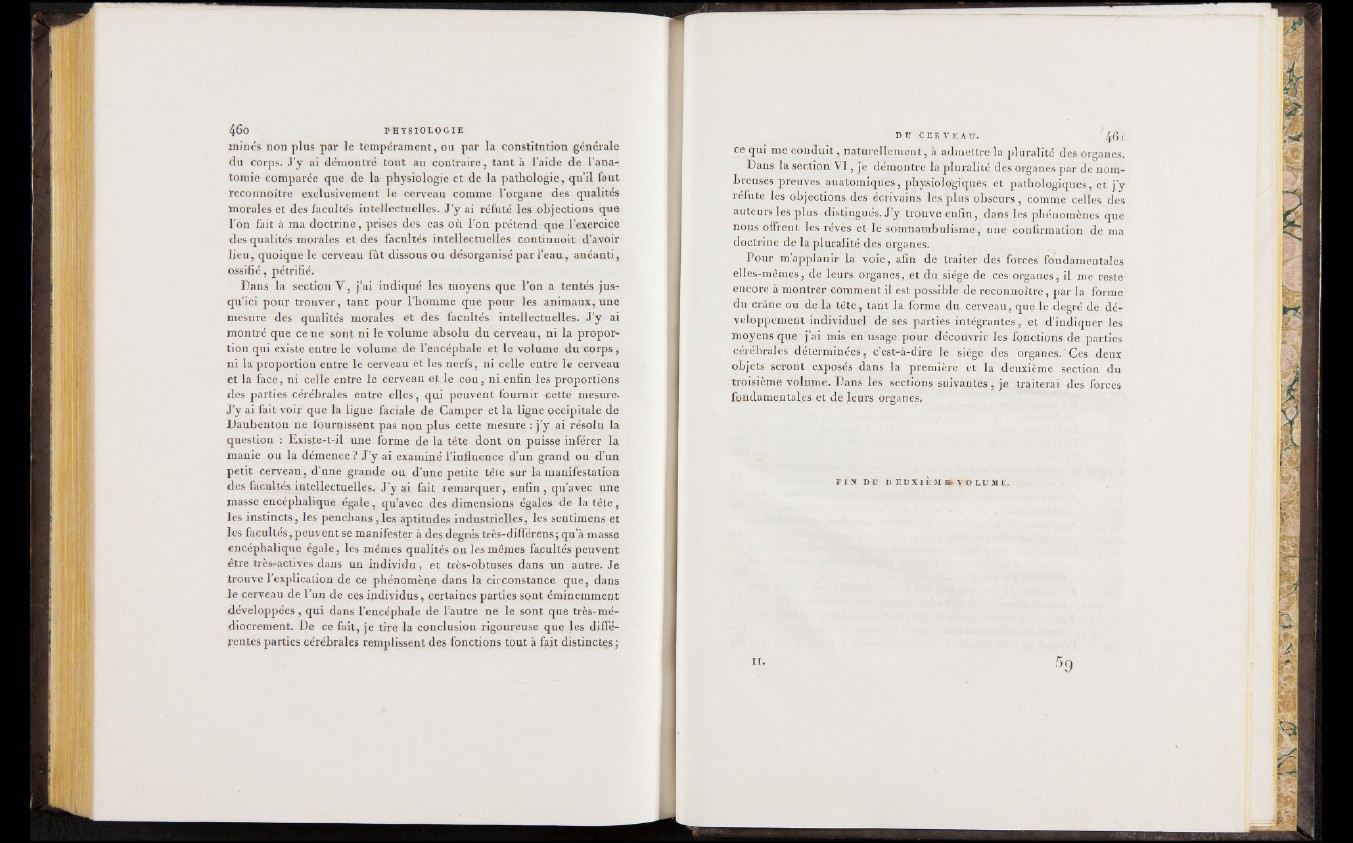
minés non plus par le tempérament, ou par la constitution générale
du corps. J’y ai démontré tout au contraire, tant à l’aide de l’anatomie
comparée que de la physiologie et de la pathologie, qu’il faut
reconnoître exclusivement le cerveau comme l’organe des qualités
morales et des facultés intellectuelles. J’y ai réfuté les objections que
l ’on fait à ma doctrine, prises des cas où l’on prétend que l’exercice
des qualités morales et des facultés intellectuelles continuoit d’avoir
lieu, quoique le cerveau fût dissous ou désorganisé par l’eau, anéanti,
ossifié, pétrifié.
Dans la section V , j’ai indiqué les moyens que l ’on a tentés jusqu’ici
pour trouver, tant pour l’homme que pour les animaux, une
mesure des qualités morales et des facultés intellectuelles. J’y ai
montré que ce ne sont ni le volume absolu du cerveau, ni la proportion
qui existe entre le volume de l’encéphale et le volume du corps,
ni la proportion entre le cerveau et les nerfs, ni celle entre le cerveau
et la face, ni celle e.ntre le cerveau et le cou, ni enfin les proportions
des parties cérébrales entre elles, qui peuvent fournir pette mesure.
J’y ai fait voir que la ligne faciale de Camper et la ligne occipitale de
Daubenton ne fournissent pas non plus cette mesure : j’y ai résolu la
question : Existe-t-il une forme de la tête dont on puisse inférer la
manie ou la démence ? J’y ai examiné l’influence d’un grand ou d’un
petit cerveau, d’une grande ou d’une petite tête sur la manifestation
des facultés intellectuelles. J’y ai fait remarquer, enfin , qu’avec une
masse encéphalique égale, qu’avec des dimensions égales de la tête,
les instincts, les penchans , les aptitudes industrielles, les sentimens et
les facultés, peuvent se manifester à des degrés très-différens; qu’à masse
encéphalique égale, les mêmes qualités ou les mêmes facultés peuvent
être trèsractives dans un individu, et très-obtuses dans un autre. Je
trouve l’explication de ce phénomène dans la circonstance que, dans
le cerveau de l’un de ces individus, certaines parties sont éminemment
développées, qui dans l’encéphale de l’autre ne le sont que très-médiocrement.
De ce fait, je tire la conclusion rigoureuse que les différentes
parties cérébrales remplissent des fonctions tout à fait distinctes ;
ce qui me conduit, naturellement, à admettre la pluralité des organes.
Dans la section V I , je démontre la pluralité des organes par de nombreuses
preuves anatomiques, physiologiques et pathologiques, et j'y
réfute les objections des écrivains les plus obscurs, comme celles des
auteurs les plus distingués. J’y trouve enfin, dans les phénomènes que
nous offrent les rêves et le somnambulisme, une confirmation de ma
doctrine de la pluralité des organes.
Pour m’applanir la voie, afin de traiter des forces fondamentales
elles-mêmes, de leurs organes, et du siège de ces organes, il me reste
encore à montrer comment il est possible de reconnoître, par la forme
du crâne ou de la tête, tant là forme du cerveau, que le degré de développement
individuel de ses parties intégrantes, et d’indiquer les
moyens que j’ai mis en usage pour découvrir les fonctions de parties
cérébrales déterminées, c’est-à-dire le siège des organes.'Ces deux
objets seront exposés dans la première et la deuxième section du
troisième volume. Dans les sections suivantes, je traiterai des forces
fondamentales et de leurs organes,
f l l f D U D E U X I È M 8» V O L U M E ,