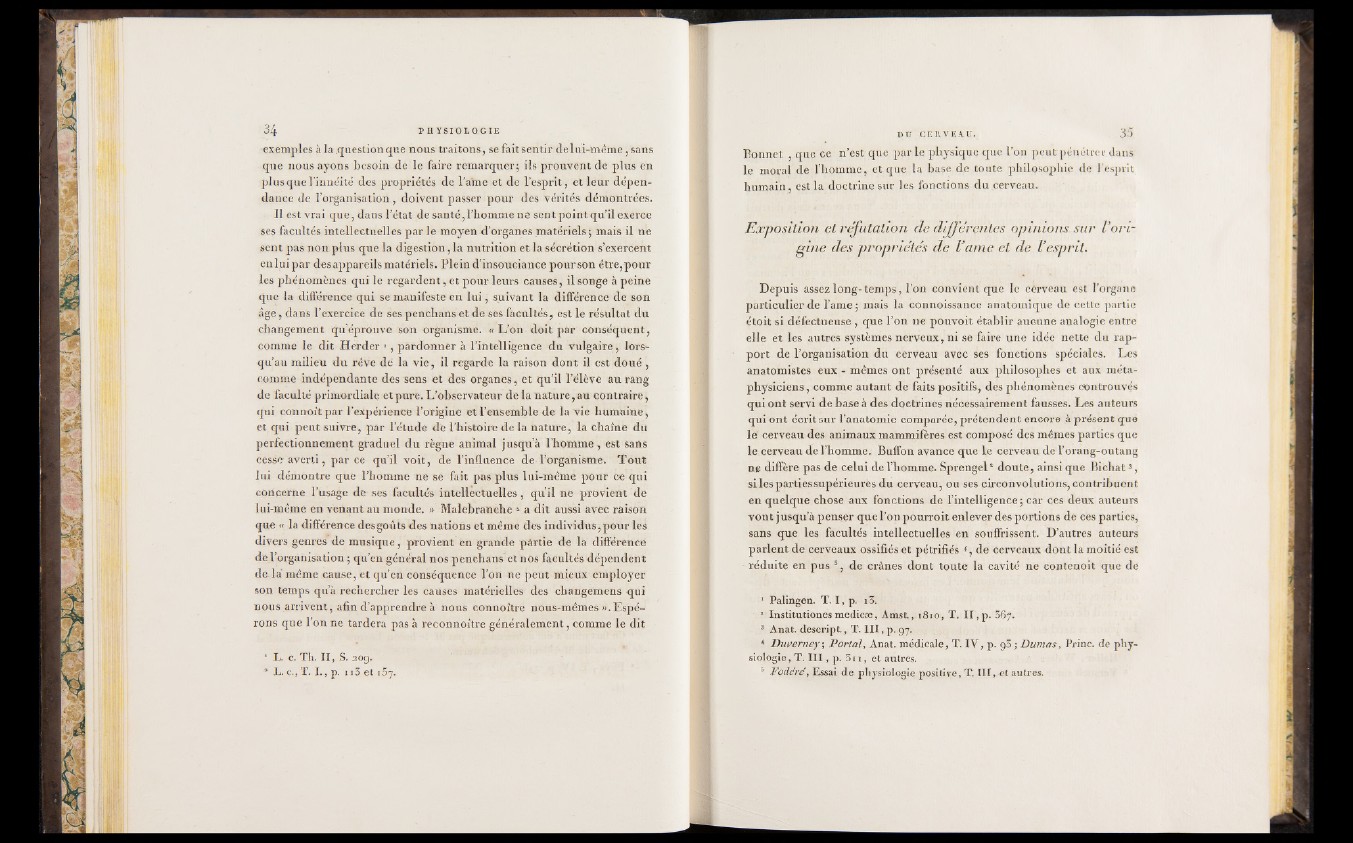
exemples à la question que nous traitons, se fait sentir de lui-même, sans
que nous ayons besoin de le faire remarquer; ils prouvent de plus en
plus que l’innéité des propriétés de l ’atae et de l’esprit, et leur dépendance
de l’organisation, doivent passer pour des vérités démontrées.
Il est vrai que, dans l’état de santé, l’homme ne sent point qu’il exerce
ses facultés intellectuelles par le moyen d’organes matériels; mais il ne
sent pas non plus que la digestion, la nutrition et la sécrétion s’exercent
enlui par desappareils matériels. Plein d’insouciance pour son être,pour
les phénomènes qui le regardent, et pour leurs causes, il songe à peine
que la différence qui se manifeste en lu i, suivant la différence de son
âge, dans l’exercice de ses penchans et de ses facultés, est le résultat du
changement qu’éprouve son organisme. « L ’on doit par conséquent,
comme le dit Herder 1, pardonner à l’intelligence du vulgaire, lorsqu’au
milieu du rêve dé la vie, il regarde la raison dont il est doué,
comme indépendante des sens et des organes, et qu’il l ’élève au rang
de faculté primordiale et pure. L’observateur de la nature, au contraire,
qui connoîtpar l’expérience l ’origine et l’ensemble de la vie humaine,
et qui peut suivre, par l’étude de l ’histoire de la nature, la chaîne du
perfectionnement graduel du règne animal jusqu’à l ’homme, est sans
cesse averti, parce qu’il voit, de l'influence de l’organisme. Tout
lui démontre que l’homme ne se fait pas plus lui-même pour ce qui
concerne l’usage de ses facultés intellectuelles, qu’il ne provient de
lui-même en venant au monde. » Malebraliche ■ a dit aussi avec raison
que « la différence desgoûts des nations et même des individus, pour les
divers genres de musique, provient en grande partie de la différence
de l’organisation ; qu’en général nos penchans et nos facultés dépendent
de là' même cause, et qu’en conséquence l’on ne pent mieux employer
son temps qu’à rechercher les causes matérielles des changemens qui
nous arrivent, afin d’apprendre à nous connoître nous-mêmes ».Espérons
que l’on ne tardera pas à reconnoître généralement, comme le dit
’ I.. c. Th. II, S. 209.
“ L. c., T. I., p. 1i3 et i57.
Bonnet , que ce n’est que parle physique que l’on peut pénétrer dans
le moral de l’homme, et que la base de toute philosophie de l’esprit
humain, est la doctrine sur les fonctions du cerveau.
Exposition et réfutation de différentes opinions sur l’origine
des propriétés de l’ame et de l’esprit.
Depuis assez long-temps, l ’on convient que le cèrveau est l’organe
particulier de l’ame ; mais la connoissance anatomique de cette partie
étoit si défectueuse , que l’on 11e pouvoit établir aucune analogie entre
elle et les autres systèmes nerveux, ni se faire une idée nette du rapport
de l ’organisation du cerveau avec ses fonctions spéciales. Les
anatomistes eux - mêmes ont présenté aux philosophes et aux métaphysiciens,
comme autant de faits positifs, des phénomènes controuvés
qui ont servi de base à des doctrines nécessairement fausses. Les auteurs
qui ont écrit sur l’anatomie comparée, prétendent encore à présent que
le' cerveau des animaux mammifères est composé des mêmes parties que
le cerveau de l’homme. Buffon avance que le cerveau de l’orang-outang
ne diffère pas de celui de l’homme. Sprengel* doute, ainsi que Bichat3,
silespartiessupérieurès du cerveau, ou ses circonvolutions, contribuent
en quelque chose aux fonctions de l’intelligence ; car ces deux auteurs
vont jusqu’à penser que l’on pourroit enlever des portions de ces parties,
sans que les facultés intellectuelles en souffrissent. D’autres auteurs
parlent de cerveaux ossifiés et pétrifiés ■ *, de cerveaux dont la moitié est
réduite en pus 5, de crânes dont toute la cavité ne contenoit que de
* Palingen. T. I , p. 13.
“ Institutiones medicæ, Amst., 1810, T. II,p. 36y.
3 Anat. descript., T. I I I , p. 97.
* Ihii'crncy ; Portai, Anat. médicale, T. IV, p. g3 ; Dumas, Princ. de physiologie
, T. I I I , p. 3 n , et autres.
5 Pode're', Essai de physiologie positive, T. III, et autres.