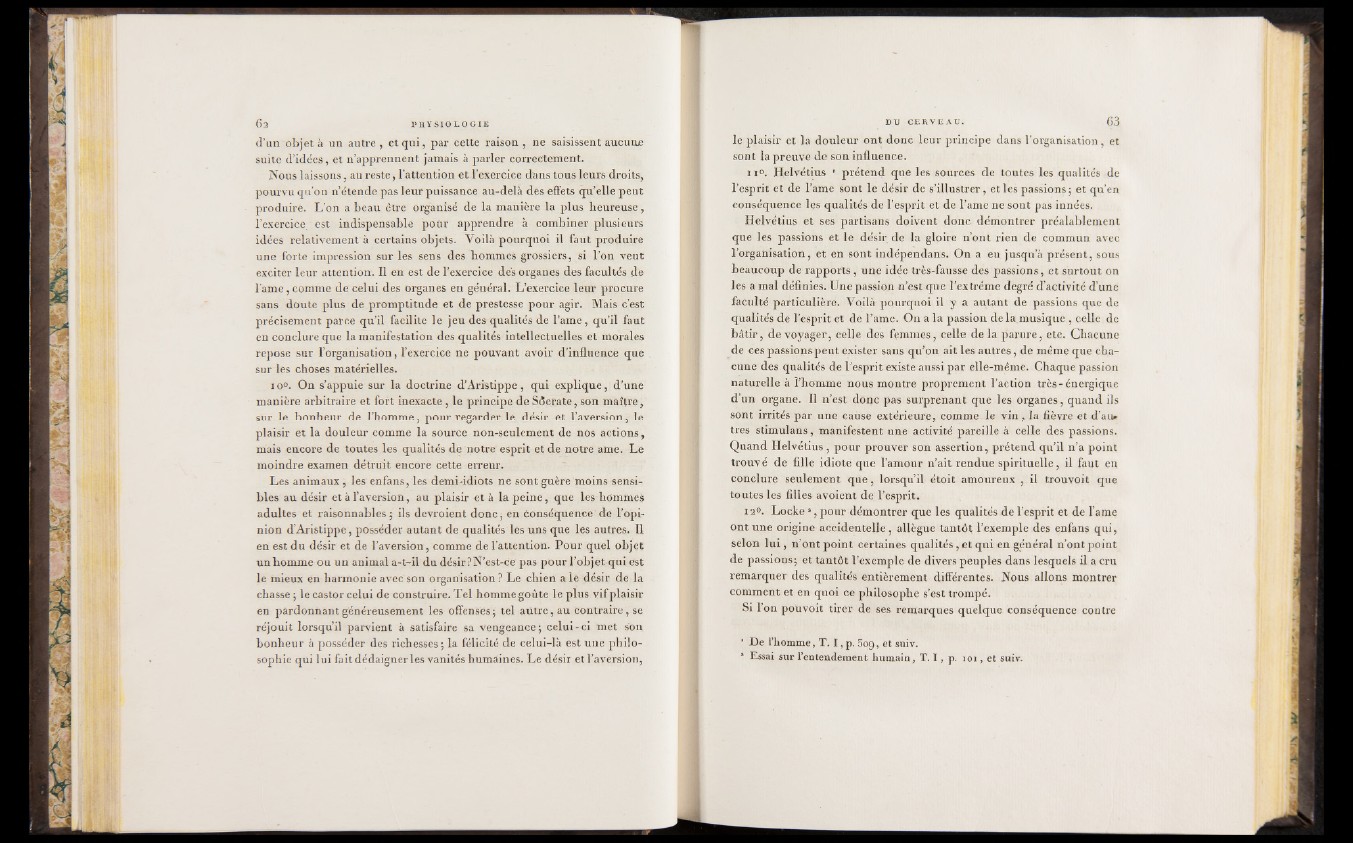
d’un objet à un autre , et qui, par cette raison , ne saisissent aucune
suite d’idées, et n’apprennent jamais à parler correctement.
Nous laissons, au reste, l’attention et l’exercice dans tous leurs droits,
pourvu qu’on n’étende pas leur puissance au-delà des effets qu’elle peut
produire. L ’on a beau être organisé de la manière la plus heureuse,
l ’exercice est indispensable pour apprendre à combiner plusieurs
idées relativement à certains objets. Voilà pourquoi il faut produire
une forte impression sur les sens des hommes grossiers, si l’on veut
exciter leur attention. Il en est de l’exercice dés organes des facultés de
l ame, comme de celui des organes en général. L ’exercice leur procure
sans doute plus de promptitude et de prestesse pour agir. Mais c’est
précisément parce qu’il facilite le jeu des qualités de l’ame, qu’il faut
en conclure que la manifestation des qualités intellectuelles et morales
repose sur l’organisation, l’exercice ne pouvant avoir d'influence que
sur les choses matérielles.
io°. On s’appuie sur la doctrine d’Aristippe, qui explique, d’une
manière arbitraire et fort inexacte , le principe de Sôcrate, son maître,
sur le bonheur de l’homme, pour regarder le désir et l’aversion, le
plaisir et la douleur comme la source non-seulement de nos actions,
mais encore de toutes les qualités de notre esprit et de notre aine. Le
moindre examen détruit encore cette erreur.
Les animaux, les enfans, les demi-idiots ne sont guère moins sensibles
au désir et à l’aversion, au plaisir et à la peine, que les hommes
adultes et raisonnables; ils devroient donc, en Conséquence de l’opinion
d’Aristippe, posséder autant de qualités lés uns que les autres. Il
en est du désir et de l ’aversion, comme de l’attention. Pour quel objet
un homme ou un animal a-t-il du désir? N’est-ce pas pour l’objet qui est
le mieux en harmonie avec son organisation ? Le chien a le désir de la
chasse ; le castor celui de construire. Tel homme goûte le plus vif plaisir
en pardonnant généreusement les offensés ; tel autre, au contraire, se
réjouit lorsqu’il parvient à satisfaire sa vengeance; celui-ci met son
bonheur à posséder des richesses; la félicité de celui-là est une philosophie
qui lui fait dédaigner les vanités humaines. Le désir et l’aversion,
le plaisir et la douleur ont donc leur principe dans l’organisation, et
sont la preuve de son influence.
i i °. Helvétius ■ prétend que les sources de toutes les qualités de
l’esprit et de l ’ame sont le désir de s’illustrer, et les passions; et qu’en
conséquence les qualités de l’esprit et de l’ame ne sont pas innées.
Helvétius et ses partisans doivent donc démontrer préalablement
que les passions et le désir de la gloire n’ont rien de commun avec
l ’organisation, et en sont indépendans. On a eu jusqu’à présent, sous
beaucoup de rapports, une idée très-fausse des passions, et surtout on
les a mal définies. Une passion n’est que l ’extrême degré d’activité d’une
faculté particulière. Voilà pourquoi il y a autant de passions que de
qualités de l'esprit et de l’ame. On a la passion dela.musique , celle de
bâtir, de voyager, celle des femmes, celle delà parure, etc. Chacune
de ces passionspeut exister sans qu’on ait les autres, de même que chacune
des qualités de l'esprit existe aussi par elle-même. Chaque passion
naturelle à l’homme nous montre proprement l’action très-énergique
d’un organe. Il n’est donc pas surprenant que les organes, quand ils
sont irrités par une cause extérieure, comme le v in , la fièvre et d’au»
très stimulans, manifestent une activité pareille à celle des passions.
Quand Helvétius, pour prouver son assertion, prétend qu’il n’a point
trouvé de fille idiote que l’amour n’ait rendue spirituelle, il faut en
conclure seulement que , lorsqu’il étoit amoureux , il trouvoit que
toutes les filles avoient de l’esprit.
12°. Locke a, pour démontrer que les qualités de l’esprit et de l’ame
ont une origine accidentelle , allègue tantôt l’exemple des enfans qui,
selon lu i, n’ont point certaines qualités, et qui en général n’ont point
de passions; et tantôt l’exemple de divers peuples dans lesquels il a cru
remarquer des qualités entièrement différentes. Nous allons montrer
comment et en quoi ce philosophe s’est trompé.
Si l’on pouvoit tirer de ses remarques quelque conséquence contre
’ De l’homme, T. I , p. 309, et suiv.
* Essai sur l’entendement humain, T. I , p. 101, et suiv.