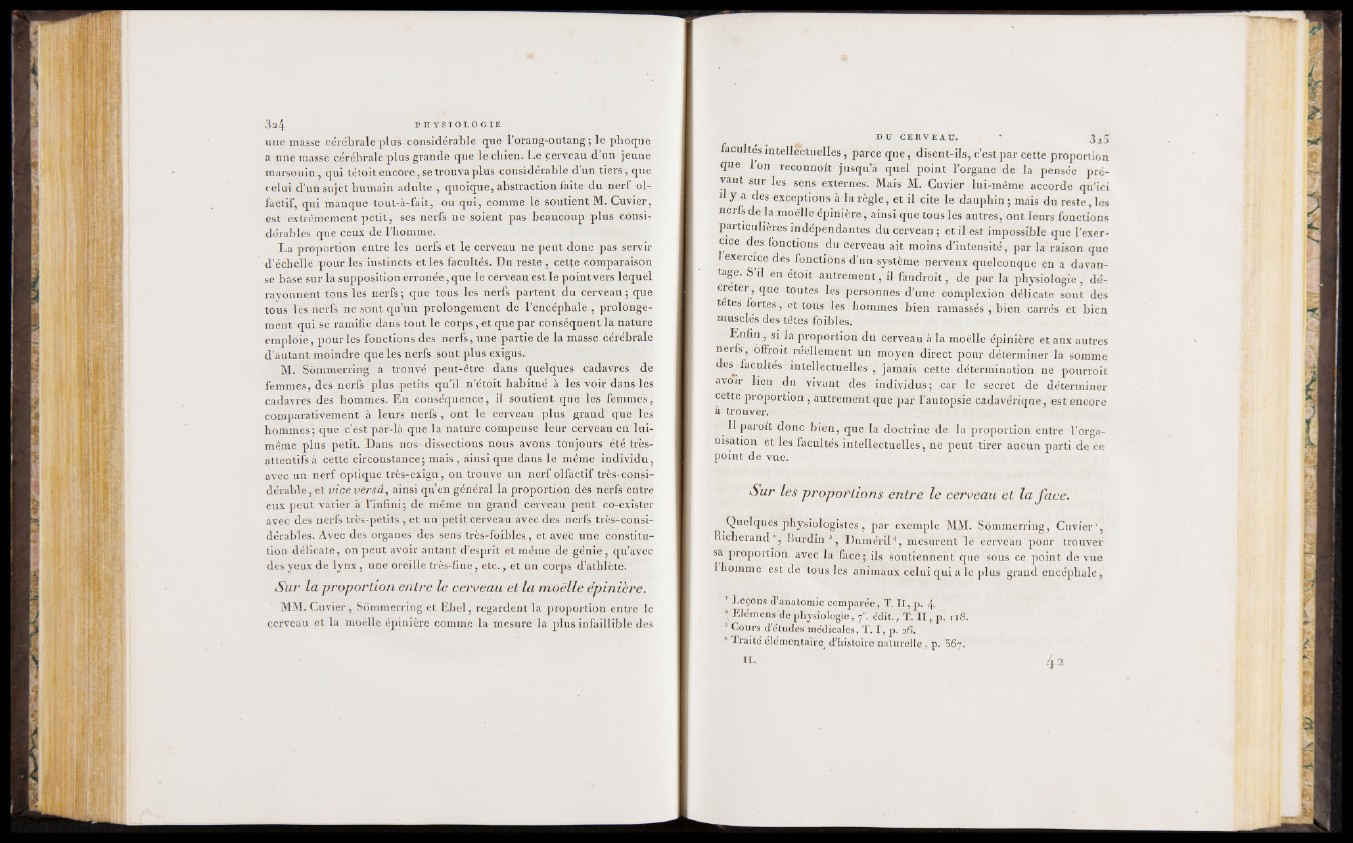
une masse cérébrale plus considérable que l’orang-outang; le phoque
a une masse cérébrale plus grande que le chien. Le cerveau d’un jeune
marsouin, qui tétoit encore, se trouva plus considérable dun tiers, que
celui d’un sujet humain adulte , quoique, abstraction laite du nerf olfactif,
qui manque tout-à-fait, ou qui, comme le soutient M. Cuvier,
est extrêmement petit, ses nerfs ne soient pas beaucoup plus considérables
que ceux de l’homme.
La proportion entre les nerfs et le cerveau ne peut donc pas servir
d’échelle pour les instincts et les facultés. Du reste , cette comparaison
se base sur la supposition erronée, que le cerveau est le point vers lequel
rayonnent tous les nerfs; que tous les nerfs partent du cerveau; que
tous les nerfs ne sont qu’un prolongement de l’encéphale , prolongement
qui se ramifie dans tout le corps, et que par conséquent la nature
emploie, pour les fonctions des nerfs, une partie de la masse cérébrale
d’autant moindre que les nerfs sont plus exigus.
M. Sommerring a trouvé peut-être dans quelques cadavres de
femmes, des nerfs plus petits qu’il n’étoit habitué à les voir dans les
cadavres des hommes. En conséquence, il soutient que les femmes,
comparativement à leurs nerfs , ont le cerveau plus grand que les
hommes; que c’est par-là que la nature compense leur cerveau en lui-
même plus petit. Dans nos dissections nous avons toujours été très-
attentifs à cette circonstance; mais , ainsi que dans le même individu,
avec un nerf optique très-exigu, on trouve un nerf olfactif très-considérable,
et vice versa, ainsi qu’en général la proportion des nerfs entre
eux peut varier à l’infini ; de même un grand cerveau peut co-exister
avec des nerfs très-petits , et un petit cerveau avec des nerfs très-considérables.
Avec des organes des sens très-foibles., et ave'c une constitution
délicate, on peut avoir autant d’esprit et même de génie, qu’avec
des yeux de lynx, une oreille très-fine, etc., et un corps d’athlète.
Sur la proportion entre le cerveau et la moelle e'pinière.
MM. Cuvier , Sommerring et Ebel, regardent la proportion entre le
cerveau et la moelle épinière comme la mesure la plus infaillible des
facultés intellectuelles, parce que, disent-ils, c’est par cette proportion
que Ion reconnoit jusqu’à quel point l’organe de la pensée prévaut
sur les sens externes. Mais M. Cuvier lui-même accorde qu’ici
1 y a des exceptions à la règle, et il cite le dauphin ; mais du reste, les
nerfs de la moelle épinière, ainsi que tous les autres, ont leurs fonctions
particulières indépendantes du cerveau ; et il est impossible que l’exercice
des fonctions du cerveau ait moins d’intensité, par la raison que
1 exercice des fonctions d’un système nerveux quelconque en a davantage.
S’il en étoit autrement, il faudroit, de par la physiologie, dé-
creter, que toutes les personnes d’une complexion délicate sont des
tetes ortes , et tous les hommes bien ramassés , bien carrés et bien
musclés des têtes foibles.
Enfin, si la proportion du cerveau à la moelle épinière et aux autres
nerfs, offrent réellement un moyen direct pour déterminer la somme
es^ facultés intellectuelles , jamais cette détermination ne pourroit
avoir lieu du vivant des individus; car le secret de déterminer
cette proportion , autrement que par l’autopsie cadavérique, est encore
à trouver.
Il paroit donc bien, que la doctrine de la proportion entre l ’organisation
et les facultés intellectuelles, ne peut tirer aucun parti de ce
point de vue.
Sur les proportions entre le cerveau et la face.
Quelques physiologistes, par exemple MM. Sommerring, Cuvier’ ,
Richerand”, Burdin 3, Duméril4, mesurent le cerveau pour trouver
sa proportion avec la face; ils soutiennent que sous ce point de vue
1 homme est de tous les animaux celui qui ale plus grand encéphale,
* Leçons d’anatomie comparée, T. II, p. 4
\ Elémens de physiologie, y”, e'dit., T. I I , p. n8.
3 Cours d’e'tudes médicales, T. I , p. 26.
* Traité élémentaire d’histoire naturelle, p. 367.
H. 4 3