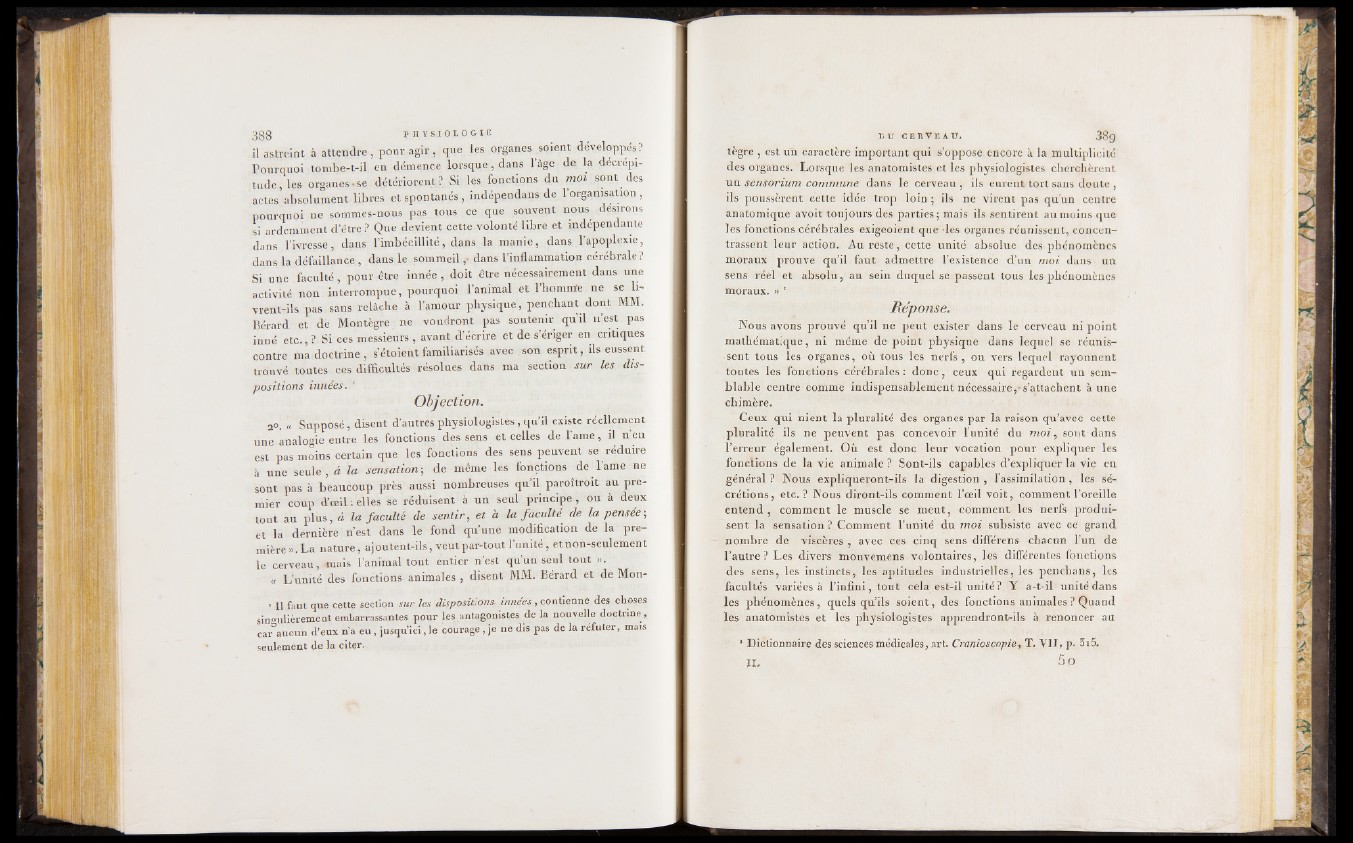
388 PHYSIOLOGIE
il astreint à attendre, pour agir , que les organes soient développés?
Pourquoi tombe-t-il en démence lorsque , dans l’âge de la décrépitude,
les organes*se détériorent? Si les fonctions du moi sont des
actes absolument libres et spontanés, indépendans de l’organisation^
pourquoi ne sommes-nous pas tous ce que souvent nous desuons
si ardemment d’étre ? Que devient cette.volonté libre et indépendante
dans l’ivresse, dans l'imbécillité, dans la manie, dans l’apoplexie,
dans la défaillance , dans le sommeil ,• dans l’inflammation cérébrale ?
Si une faculté, pour être innée , doit être nécessairement dans une
activité non interrompue, pourquoi l ’animal et 1 homnre ne se livrent
ils pas sans relâche à l’amour physique, penchant dont MM.
Bérard et de Montègre ne voudront pas soutenir qu’il n’est pas
inné etc., ? Si ces messieurs , avant d’écrire et de s’ériger en critiques
contre ma doctrine , s étoient familiarisés avec son esprit, ils eussent
trouvé toutes ces difficultés résolues dans ma section sur les dispositions
innées. '
Objection.
2°! « Supposé, disent d’autres physiologistes, qu’il existe réellement
une analogie entre les fonctions des sens et celles de lame, il n’en
est pas moins certain que les fonctions des sens peuvent se réduire
à une seule, fl la sensation; de même les fonctions de lame ne
sont pas à beaucoup près aussi nombreuses qu’il paroîtroit au premier
coup d’oeil : elles se réduisent à un seul principe , ou à deux
tout au plus, fl la faculté de sentir, et à la faculté de la pensée,
et la dernière n’est dans le fond qu’une modification de la première
».La nature, ajoutent-ils, veut par-tout l’unité, et non-seulement
le cerveau, mais l’animal tout entier n’est qu’un seul tout>;v;_ ;
« L’unité des fonctions- animales , disent MM. Bérard et de Mon-
■ Il faut que cette section sur les dispositions innées , contienne des choses
singulièrement embarrassantes pour les antagonistes de la nouvelle doctrine ,
car aucun d’eux n’a e u , jusqu’ic i, le courage, je ne dis pas de la réfuter, mais
seulement de la citer.
nu cerveau, 389
tègre , est un caractère important qui s’oppose encore à la multiplicité
des organes. Lorsque les anatomistes et les physiologistes cherchèrent
un sensorium commune dans le cerveau , ils eurent tort sans doute ,
ils poussèrent cette idée trop loin ; ils ne virent pas qu’un centre
anatomique avoit toujours des parties; mais ils sentirent aumoins que
les fonctions cérébrales exigeoient que les organes réunissent, concentrassent
leur action. Au reste, cette unité absolue des phénomènes
moraux prouve qu’il faut admettre l’existence d’un moi dans un
sens réel et absolu, au sein duquel se passent tous les phénomènes
moraux.
Réponse.
Nous avons prouvé qu’il ne peut exister dans le cerveau ni point
mathématique, ni même de point physique dans lequel se réunissent
tous les organes, où tous les nerfs, ou vers lequel rayonnent
toutes les fonctions cérébrales: donc, ceux qui regardent un semblable
centre comme indispensablement nécessaire,-s’attachent à une
chimère.
Ceux qui nient la pluralité des organes par la raison qu’avec cette
pluralité ils ne peuvent pas concevoir l’unité du moi, sont dans
l ’erreur également. Où est donc leur vocation pour expliquer les
fondions de la vie animale? Sont-ils capables d’expliquer la vie en
général ? Nous expliqueront-ils la digestion , l’assimilation , les sécrétions,
etc. ? Nous diront-ils comment l’oeil voit, comment l’oreille
entend , comment le muscle se meut, comment les nerfs produisent
la sensation? Comment l’unité du moi subsiste avec ce grand
nombre de viscères avec ces cinq sens différens chacun l’un de
l ’autre? Les divers mouvemens volontaires, les différentes fonctions
des sens, les instincts, les aptitudes industrielles, les penehans, les
facultés variées à l’infini, tout cela est-il unité ? Y a-t-il unité dans
les phénomènes, quels qu’ils soient, des fonctions animales ? Quand
les anatomistes et les physiologistes apprendront-ils à renoncer au
1 Dictionnaire des sciences médicales, art. Cranioscopie, T. VIT, p. 3 i 5.
ÏI, i)