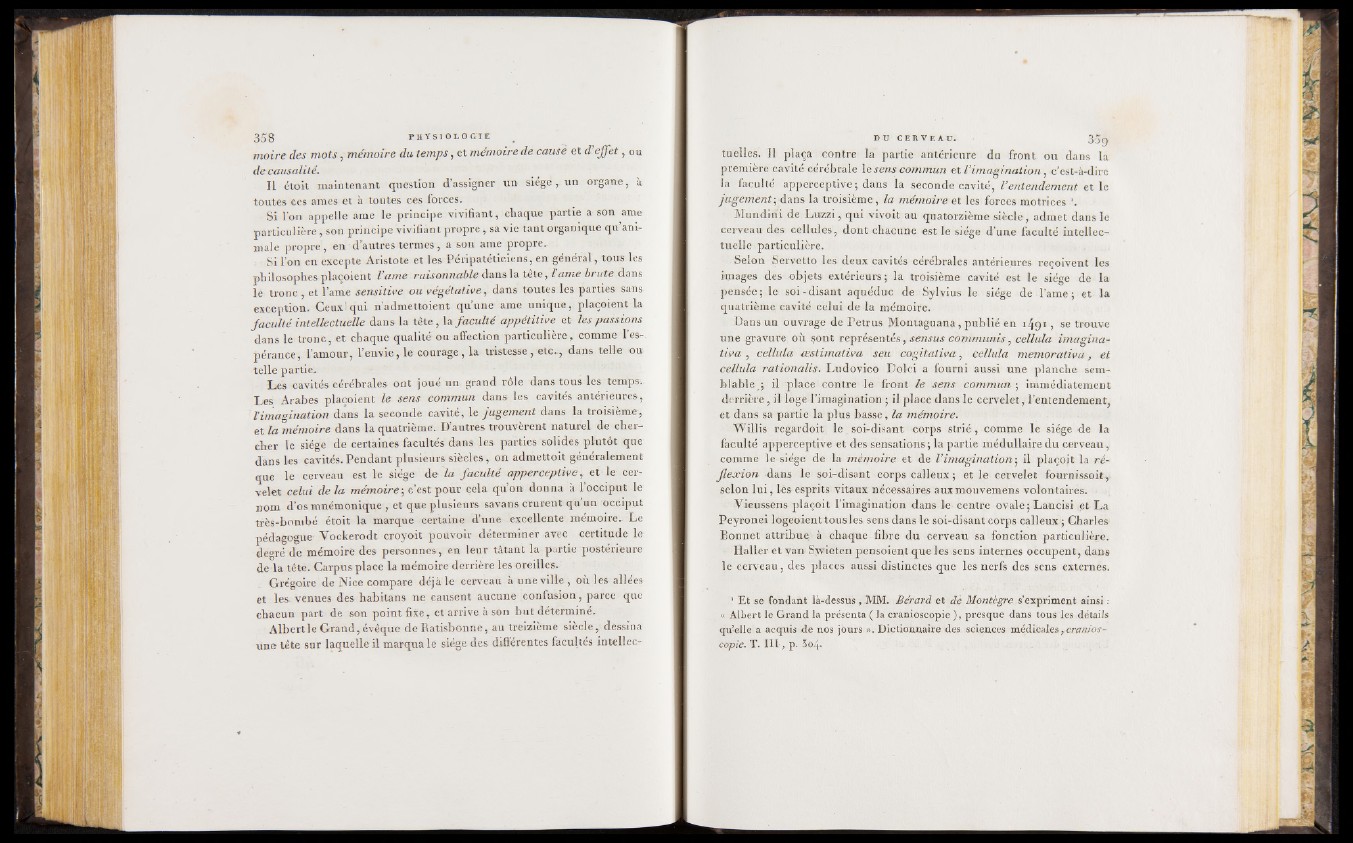
358 ph ys iologie
moire des mots, mémoire du temps, et mémoire de causé et d effet, ou
de causalité.
Il était maintenant question d’assigner un s iè g eu n organe, à
toutes ces âmes et à toutes ces forces.
Si l’on appelle ame le principe vivifiant, chaque partie a son ame
particulière, son principe vivifiant propre, sa vie tant organique qu’animale
propre , en d’autres termes, a son ame propre.
Si l’on en excepté Aristote et les Péripatéticiens, en général, tous les
philosophes plaçoient l ’ame raisonnabledansla tête, lame brute dans
le tronc , et l’ame sensitive ou végétative, dans toutes les parties sans
exception. Ceux'qui n’admettoient qu’une ame unique, plaçoient la
faculté intellectuelle dans la tête, la faculté appétitive et les passions
dans le tronc, et chaque qualité ou affection particulière, comme l’espérance,
l’amour, l’envie, le courage, la tristesse, etc., dans telle ou
telle partie. -
Les cavités cérébrales ont joue un grand rôle dans tous les temps.
Les Arabes plaçoient le sens commun dans les cavités antérieures,
l'imagination dans la seconde cavité, le jugement dans la troisième-,
et la mémoire dans la quatrième. D’autres trouvèrent naturel de chercher
le siège de certaines facultés dans les parties solides plutôt que
dans les cavités. Pendant plusieurs siècles, on admettoit généralement
que le cerveau est le siège de la faculté apperceptive, et le cervelet
celui de la mémoire ; e’est pour cela qu’on donna à l’occiput le
nom d’os mnémonique , et que plusieurs savans crurent qu un occiput
très-bombé étoit la marque certaine d’une excellente mémoire. Le
pédagogue Vockerodt croyoit pouvoir déterminer avec certitude le
degré de mémoire des personnes, en leur tâtant la partie postérieure
de la tête. Carpus place la mémoire derrière les oreilles.
Grégoire de Nice compare déjà le cerveau à une ville , où les allées
et les venues des habitans ne causent aucune confusion, parce que
chacun part de son point fixe, et arrive à son but déterminé.
Albertle Grand, évêque de Ratisbonne, au treizième siècle, dessina
une tête sur laquelle il marqua le siège des différentes facultés intellectuelles.
Il plaça contre la partie antérieure du front ou dans la
première cavité cérébrale lesens commun et l ’imagination, c’est-à-dire
la faculté apperceptive; dans la seconde cavité, l ’entendement et le
jugement-,dans la troisième, la mémoire et les forces motrices ’.
Mundini de Luzzi, qui vivoit au quatorzième siècle, admet dans le
cerveau des cellules, dont chacune est le siège d’une faculté intellectuelle
particulière.
Selon Servetto les deux cavités cérébrales antérieures reçoivent les
images des objets extérieurs; la troisième cavité est le siège de la
pensée; le soi-disant aquéduc de Sylvius le siège de l’ame; et la
quatrième cavité celui de la mémoire.
Dans un ouvrage de Petrus Montaguana, publié en 1491, se trouve
une gravure où sont représentés, sensus commuais, cellula imagina-
tiva , cellula oestimativa seu cogitativa, cellula memorativa, et
cellula rationalis. Ludovico Dolci a fourni aussi une planche semblable
; il place contre le front le sens commun ; immédiatement
derrière, il loge l ’imagination ; il place dans le cervelet, l’entendement,
et dans sa partie la plus basse, la mémoire.
Willis regardoit le soi-disant corps strié , comme le siège de la
faculté apperceptive et des sensations; la partie médullaire du cerveau,
comme le siège de la mémoire et de l ’imagination; il plaçoit la réflexion
dans le soi-disant corps calleux ; et le cervelet fournissoit,
selon lu i, les esprits vitaux nécessaires aux mouvemens volontaires.
Vieussens plaçoit l’imagination dans le centre ovale ; Lancisi et La
Peyronéi logeoienttousles sens dans le soi-disant corps calleux ; Charles
Bonnet attribue, à chaque fibre du cerveau sa fonction particulière.
Haller et van Svvieten pensoient que les sens internes occupent, dans
le cerveau, des places aussi distinctes que les nerfs des sens externes.
1 Et se fondant là-dessus, MM. Bérard et dé Montègre s’expriment ainsi :
« Albert le Grand la présenta ( la cranioscopie ), presque dans tous les détails
qu’elle a acquis de nos jours ». Dictionnaire des sciences médicales, cranioscopie.
T. IIL j p. 3o4-