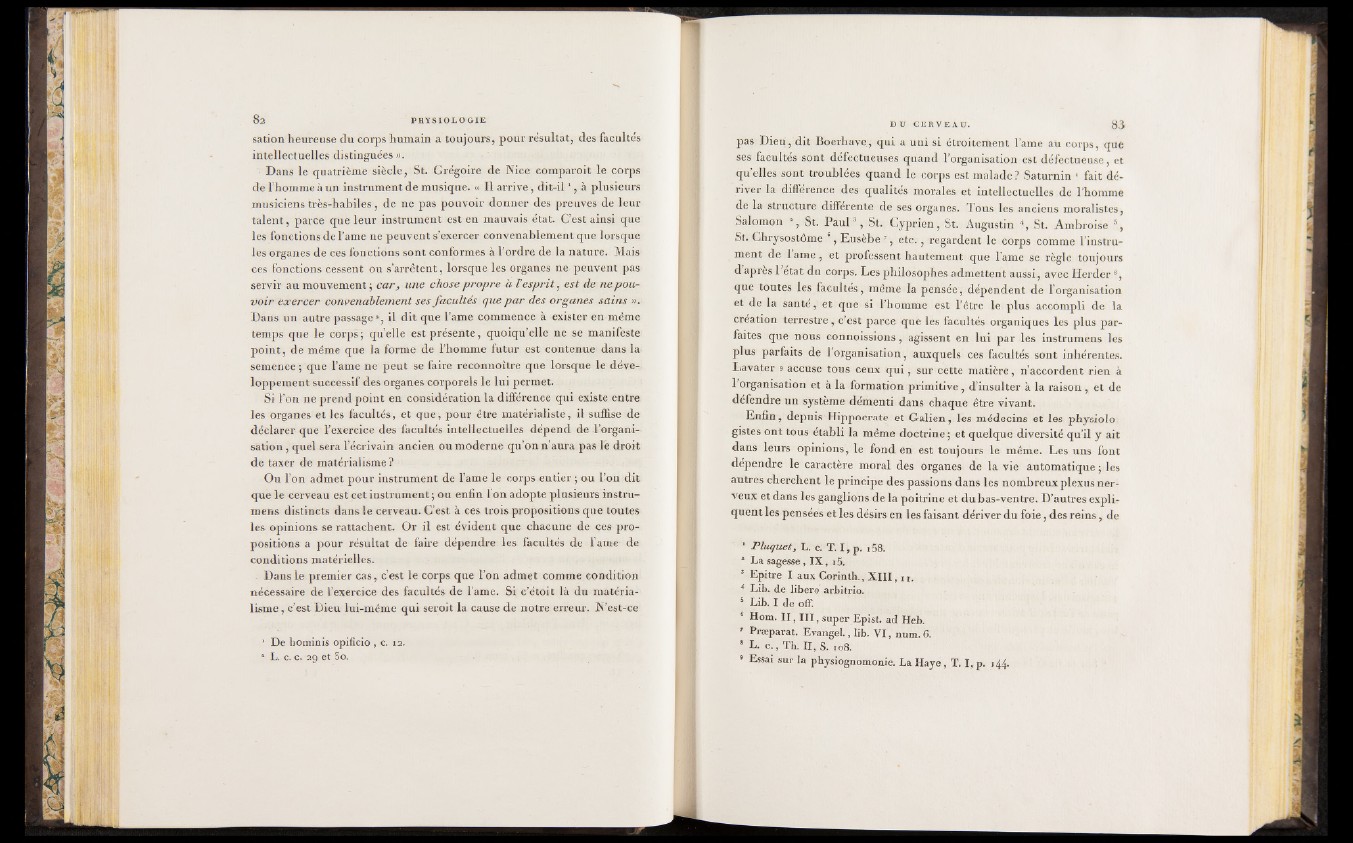
sation heureuse du corps humain a toujours, pour résultat, des facultés
intellectuelles distinguées».
Dans le quatrième siècle, St. Grégoire de Nice comparoit le corps
de l’homme à un instrument de musique. « Il arrive, dit-il à plusieurs
musiciens très-habiles, de ne pas pouvoir donner des preuves de leur
talent, parce que leur instrument est en mauvais état. C’est ainsi que
les fonctions de l’ame ne peuvent s’exercer convenablement que lorsque
les organes de ces fonctions sont conformes à l’ordre de la nature. Mais
ces fonctions cessent ou s’arrêtent, lorsque les organes ne peuvent pas
servir au mouvement; car, une chose propre a l’esprit, est de ne pouvoir
exercer convenablement ses facultés que par des organes sains ».
Dans un autre passage“, il dit que l’ame commence à exister en même
temps que le corps; qu’elle est présente, quoiqu’elle ne se manifeste
point, de même que la forme de l’homme futur est contenue dans la
semence ; que l’ame ne peut se faire reconnoitre que lorsque le développement
successif des organes corporels le lui permet.
Si l’on ne prend point en considération la différence qui existe entre
les organes et les facultés, et que, pour être matérialiste, il suffise de
déclarer que l’exercice des facultés intellectuelles dépend de l’organisation
, quel sera l’écrivain ancien ou moderne qu’on n’aura pas lé droit
de taxer de matérialisme ?
Ou l’on admet pour instrument de Fame le corps entier ; ou l’on dit
que le cerveau est cet instrument; ou enfin 1 on adopte plusieurs instru-
mens distincts dans le cerveau. C’est à ces trois propositions que toutes
les opinions se rattachent. Or il est évident que chacune de ces propositions
a pour résultat de faire dépendre les facultés de Fame de
conditions matérielles.
Dans le premier cas, c’est le corps que l’on admet comme condition
nécessaire de l’exercice des facultés de l’ame. Si c’étoit là du matérialisme
, c’est Dieu lui-même qui seroit la cause de notre erreur. N’est-ce
* De hominis opificio , c. 12.
* L. c. c. 29 et 3o.
pas Dieu, dit Boerhave, qui a uni si étroitement lame au corps, que
ses facultés sont défectueuses quand l’organisation est défectueuse, et
qu’elles sont troublées quand le corps est malade? Saturnin 1 fait dériver
la différence des qualités morales et intellectuelles de l ’homme
de la structure differente de ses organes. Tous les anciens moralistes,
Salomon *, St. Paul3, St. Cyprien, St. Augustin m St. Ambroise 5,
St. Chrysostôme *, Eusèbe 7, etc., regardent le corps comme l’instrument
de lame, et professent hautement que lame se règle toujours
d après 1 état du corps. Les philosophes admettent aussi, avec Herder s,
que toutes les facultés, même la pensée, dépendent de l’organisation
et de la santé, et que si l’homme est l’être le plus accompli de la
création terrestre,. c’est parce que les facultés organiques les plus parfaites
que nous connoissions, agissent en lui par les instrumens les
plus parfaits de l’organisation, auxquels ces facultés sont inhérentes.
Lavater 9 accuse tous ceux qui, sur cette matière, n’accordent rien à
1 organisation et à la formation primitive, d’insulter à la raison , et de
défendre un système démenti dans chaque être vivant.
Enfin, depuis Hippocrate et Galien, les médecins et les physiologistes
ont tous établi la même doctrine ; et quelque diversité qu’il y ait
dans leurs opinions, le fond en est toujours le même. Les uns font
dépendre le caractère moral des organes de la vie automatique ; les
autres cherchent le principe des passions dans les nombreux plexus nerveux
et dans les ganglions de la poitrine et du bas-ventre. D’autres expliquent
les pensées et les désirs en les faisant dériver du foie, des reins, de
' Pluquet, h. c. T. I , p. i 58.
' La sagesse, IX, i 5.
3 Epitre I aux Corinth., XIII, n .
4 Lib. de libero arbitrio.
5 Lib. I de off
6 Hom. II, III, super Epist. ad Heb.
' Præparat. Erangel., lib. VI, num.6.
* L. c ., Th. II, S. 108.
9 EsSai sur la physiognomonie. La Haye, T. I, p. 144.