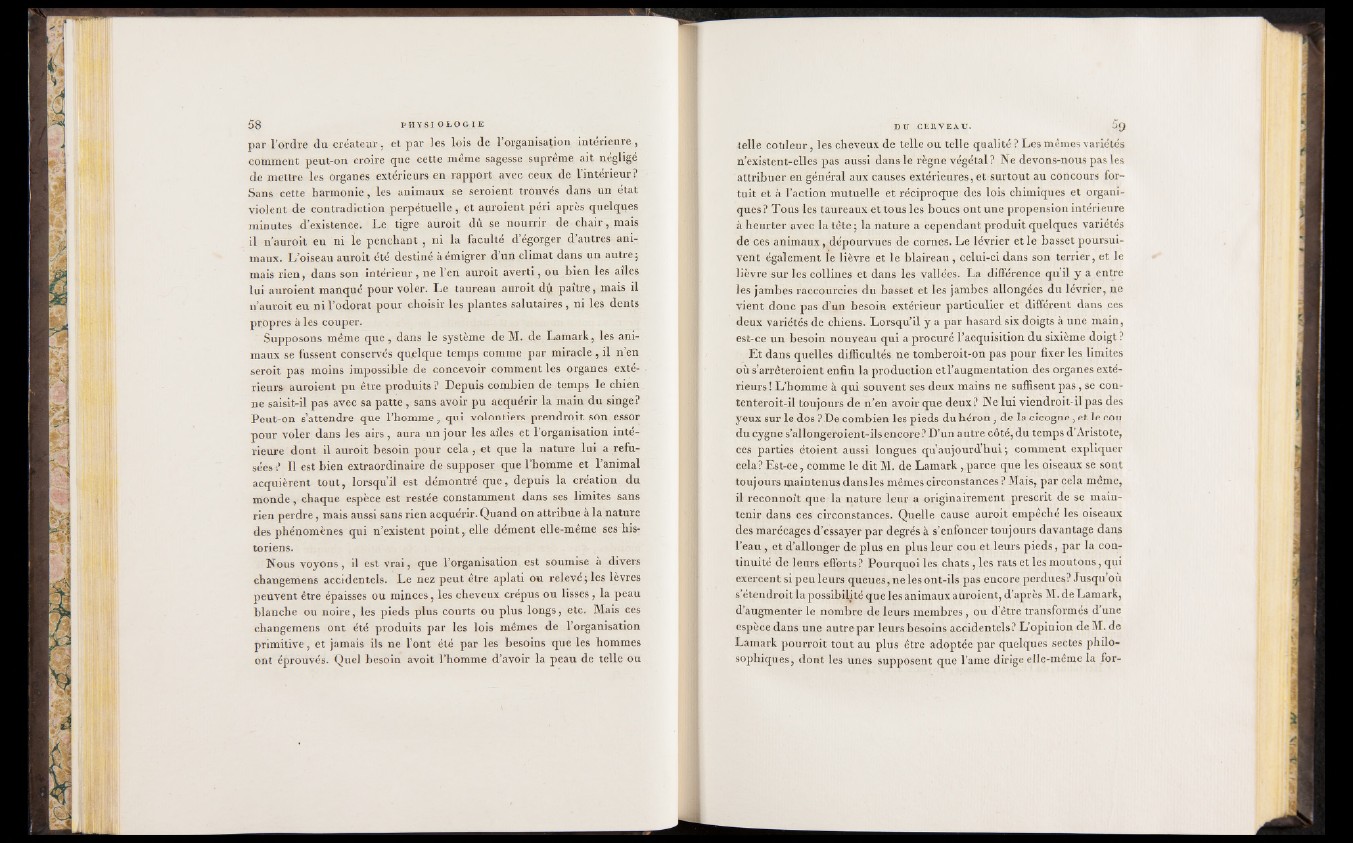
par l’ordre du créateur, et par les lois de l’organisation intérieure,
comment peut-on croire que cette même sagesse suprême ait négligé
de mettre les organes extérieurs en rapport avee ceux de l’intérieur?
Sans cette harmonie, les animaux se seraient trouvés dans un état
violent de contradiction perpétuelle , et auraient péri après quelques
minutes d’existence. Le tigre aurait dû se nourrir de chair, mais
il n’auroit eu ni le penchant , ni la faculté d’égorger d’autres animaux.
L ’oiseau aurait été destiné à émigrer d’un climat dans un autre;
mais rien, dans son intérieur, ne l’en auroit averti, ou bien les ailes
lui auraient manqué pour voler. Le taureau auroit dy paître, mais il
n’auroit eu ni l’odorat pour choisir les plantes salutaires, ni les dents
propres à les couper.
Supposons même que, dans le système de M. de Lamark, les animaux
se fussent conservés quelque temps comme par miracle , il n’en
serait pas moins impossible de concevoir comment les organes extérieurs
auraient pu être produits ? Depuis combien de temps le chien
ne saisit-il pas avec sa patte , sans avoir pu acquérir la main du singe?
Peut-on s’attendre que l’homme, qui volontiers prendrait son essor
pour voler dans les airs, aura un jour les ailes et l ’organisation intérieure
dont il auroit besoin pour cela, et que la nature lui a refusées
? Il est bien extraordinaire de supposer que l’homme et l’animal
acquièrent tout, lorsqu’il est démontré que, depuis la création du
monde, chaque espèce est restée constamment dans ses limites sans
rien perdre, mais aussi sans rien acquérir. Quand on attribue à la nature
des phénomènes qui n’existent point, elle dément elle-même ses historiens.
Nous voyons, il est vrai, que l’organisation est soumise à divers
changemens accidentels. Le nez peut être aplati ou releve ; les levres
peuvent être épaisses ou minces, les cheveux crépus ou lisses , la peau
blanche ou noire, les pieds plus courts ou plus longs, etc. Mais ces
changemens ont été produits par les lois mêmes de l’organisation
primitive, et jamais ils ne l’ont été par les besoins que les hommes
ont éprouvés. Quel besoin avoit l’homme d’avoir la peau de telle ou
telle couleur, les cheveux de telle ou telle qualité ? Les mêmes variétés
n’existent-elles pas aussi dans le règne végétal? Ne devons-nous pas les
attribuer en général aux causes extérieures, et surtout au concours fortuit
et à l’action mutuelle et réciproque des lois chimiques et organiques?
Tous les taureaux et tous les boucs ont une propension intérieure
à heurter avec la tête ; la nature a cependant produit quelques variétés
de ces animaux, dépourvues de cornes. Le lévrier et le basset poursuivent
également le lièvre et le blaireau , celui-ci dans son terrier, et le
lièvre sur les collines et dans les vallées. La différence qu’il y a entre
les jambes raccourcies du basset et les jambes allongées du lévrier, ne
vient donc pas d’un besoin extérieur particulier et différent dans ces
deux variétés de chiens. Lorsqu’il y a par hasard six doigts à une main,
est-ce un besoin nouveau qui a procuré l’acquisition du sixième doigt?
Et dans quelles difficultés ne tomberoit-on pas pour fixer les limites
où s’arrêteraient enfin la production e tl’augmentation des organes extérieurs
! L ’homme à qui souvent ses deux mains ne suffisent pas, se con-
tenteroit-il toujours de n’en avoir que deux? Ne lui viendrait-il pas des
yeux sur le dos ? De combien les pieds du héron, de lacicogne ,et le cou
du cygne s’allongeroient-ils encore ? D’un autre côté, du temps d’Aristote,
ces parties étoient aussi longues qu’aujourd’hui ; comment expliquer
cela? Est-ce, comme le dit M. de Lamark, parce que les oiseaux se sont
toujours maintenus dans les mêmes circonstances ? Mais, par cela même,
il reconnoît que la nature leur a originairement prescrit de se maintenir
dans ces circonstances. Quelle cause aurait empêché les oiseaux
des marécages d’essayer par degrés à s’enfoncer toujours davantage dans
l ’eau , et d’allonger de plus en plus leur cou et leurs pieds, par la continuité
de leurs efforts? Pourquoi les chats , les rats et les moutons, qui
exercent si peu leurs queues, ne les ont-ils pas encore perdues? Jusqu’où
s’étendrait la possibilité que les animaux auraient, d’après M. de Lamark,
d’augmenter le nombre de leurs membres, ou d’être transformés d’une
espèce dans une autre par leurs besoins accidentels? L’opinion de M. de
Lamark pourrait tout au plus être adoptée par quelques sectes philosophiques,
dont les unes supposent que l’ame dirige elle-même la for