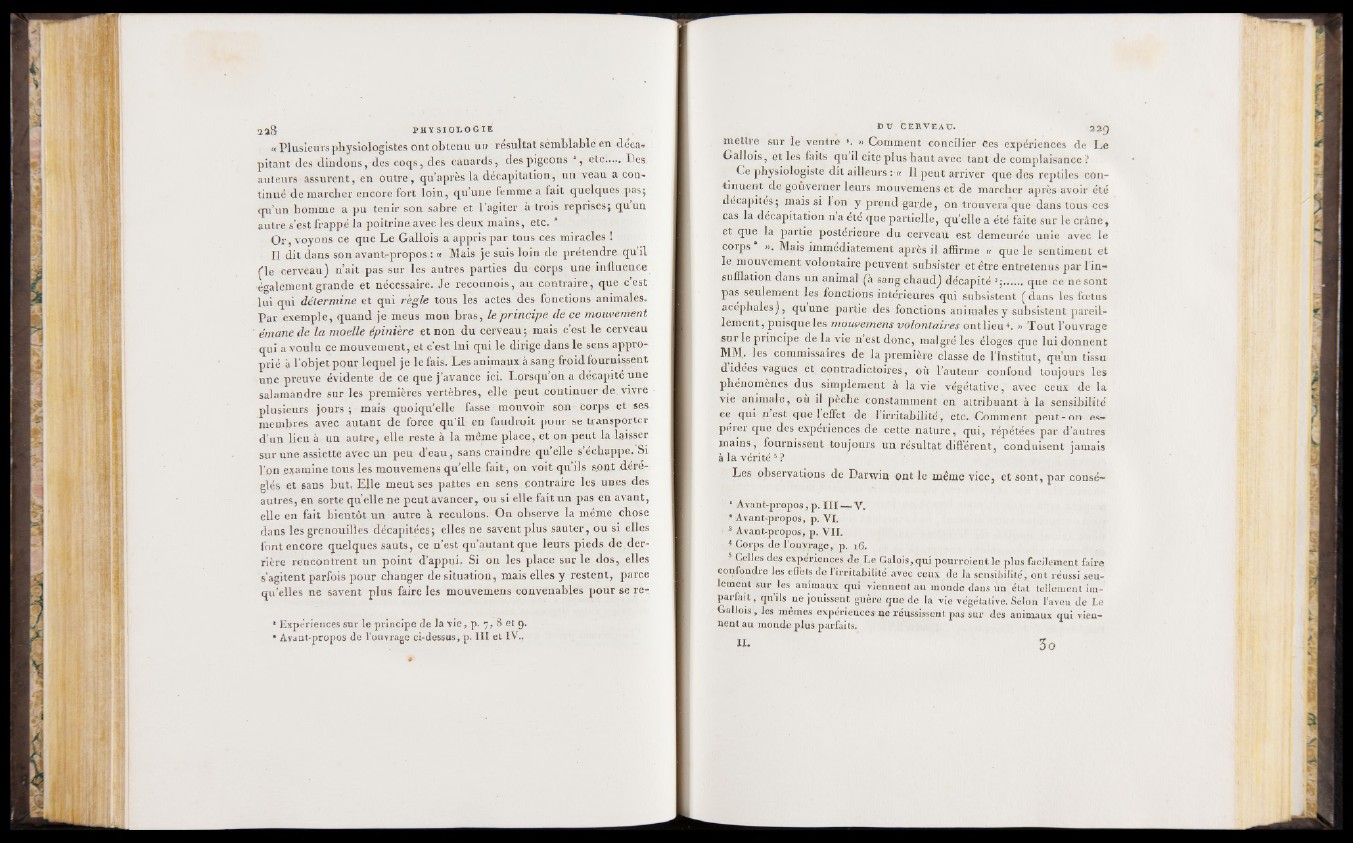
«Plusieurs physiologistes ont obtenu un résultat semblable en deçà*
pitant des dindons, des coqs, des canards, des pigeons 1, etc;..,. Des
auteurs assurent, en outre, qu’après la décapitation, un veau a continué
démarcher encore fort loin, qu’une femme a fait quelques.pas;
qu’un homme a pu tenir son sabre et l ’agiter à trois reprises; quun
autre s’est frappé la poitrine avec les deux mains, etc. ’
Or voyons ce que Le Gallois a appris par tous ces miracles !
Il dit dans son avantrpropos : « Mais je suis loin de prétendre quil
(]e cerveau) n’ait pas sur les autres parties du corps une influence
•égalementgrande et nécessaire. Je reconnois, au contraire, que c’est
lui qui détermine et qui règle tous les actes des fonctions animales.
Par exemple, quand je meus mon bras, le principe de ce mouvement
émane de la moelle épinière et non du cerveau; mais c’est le cerveau
qui a voulu ce mouvement, et c’est lui qui le dirige dans le sens approprié
à l’objet pour lequel je le fais. Les animaux à sang froid fournissent
une preuve évidente de ce que j’avance ici. Lorsqu’on a décapite une
salamandre sur les premières vertèbres, elle peut continuer de vivre
plusieurs jours ; mais quoiqu’elle fasse mouvoir son corps et ses
membres avec autant de force qu’il en faudroit pour se transporter
d’un lien à nn autre, elle reste à la même place, et on peut la laisser
sur une assiette avec un peu d’eau, sans craindre qu’elle s’échappe. Si
l’on examine tous les mouvemens qu elle fait, on voit qu’ils sont déréglés
et sans but. Elle meut ses pattes en sens contraire les unes des
autres, en sorte qu elle ne peut avancer, ou si elle fait un pas en avant,
elle en fait bientôt un autre à reculons. On observe la même chose
dans les grenouilles décapitées; elles ne savent plus sauter, ou si elles
font encore quelques sauts, ce n’est qu’autant que leurs pieds de derrière
rencontrent un point d’appui, Si on les place sur le dos, elles
s’agitent parfois pour changer de situation, mais elles y restent, parce
qu'elles ne savent plus faire les mouvemens convenables pour se re-
’ Expériences sur le principe de la vie, p. 7, 8 et 9.
* Ayant-propos de l’ouvrage ci-dessus, p. III et IV.,
mettre sur le ventre •. » Comment concilier Ces expériences de Le
Gallois, et les faits qu il cite plus haut avec tant de complaisance ?
Ce physiologiste dit ailleurs : « Il peut arriver que des reptiles continuent
de gouverner leurs mouvemens et de marcher après avoir été
décapites ; mais si 1 on y prend garde, on trouvera que dans tous ces
cas la décapitation n a été que partielle, qu’elle a été faite sur le crâne,
et que la partie postérieure du cerveau est demeurée unie avec le
corps ». Mais immédiatement après il affirme « que le sentiment et
le mouvement volontaire peuvent subsister et être entretenus par l’insufflation
dans un animal (a sang chaud) décapité 3;..... que ce ne sont
pas seulement les fonctions intérieures qui subsistent (dans les foetus
acéphales), quune partie des fonctions animales y subsistent pareillement
, puisque les mouvemens volontaires ont lieu4, » Tout l’ouvrage
sur le principe de la vie n’est donc, malgré les éloges que lui donnent
MM. les commissaires de la première classe de l’Institut, qu’un tissu
didées vagues et contradictoires, où l’auteur confond toujours les
phénomènes dus simplement à la vie végétative, avec ceux de la.
vie animale, ou il pèche constamment en attribuant à la sensibilité
ce qui n est que 1 effet de l’irritabilité, etc. Comment peut - on es-
perer que des expériences de cette nature, qui, répétées par d’autres
mains, fournissent toujours un résultat différent, conduisent jamais
à la vérité 5 ?
Les observations de Darwin ont le même vice, et sont, par consé-
■ Avant-propos, p. I II — V.
* Avant-propos, p. VI.
• 3 Avant-propos, p. VII.
4 Corps de l’ouvrage, p. 16.
5 Celles des expériences de Le Galois,qui pourraient le plus facilement faire
confondre les effets de 1 irritabilité avec ceux de la sensibilité, ont réussi seulement
sur les animaux qui viennent au monde dans un état tellement imparfait
, qu’ils ne jouissent guère que de la vie végétative. Selon l’aveu de Le
Gallois , les mêmes expériences »e réussissent pas sur des animaux qui viennent
au monde plus parfaits,
II. 5o