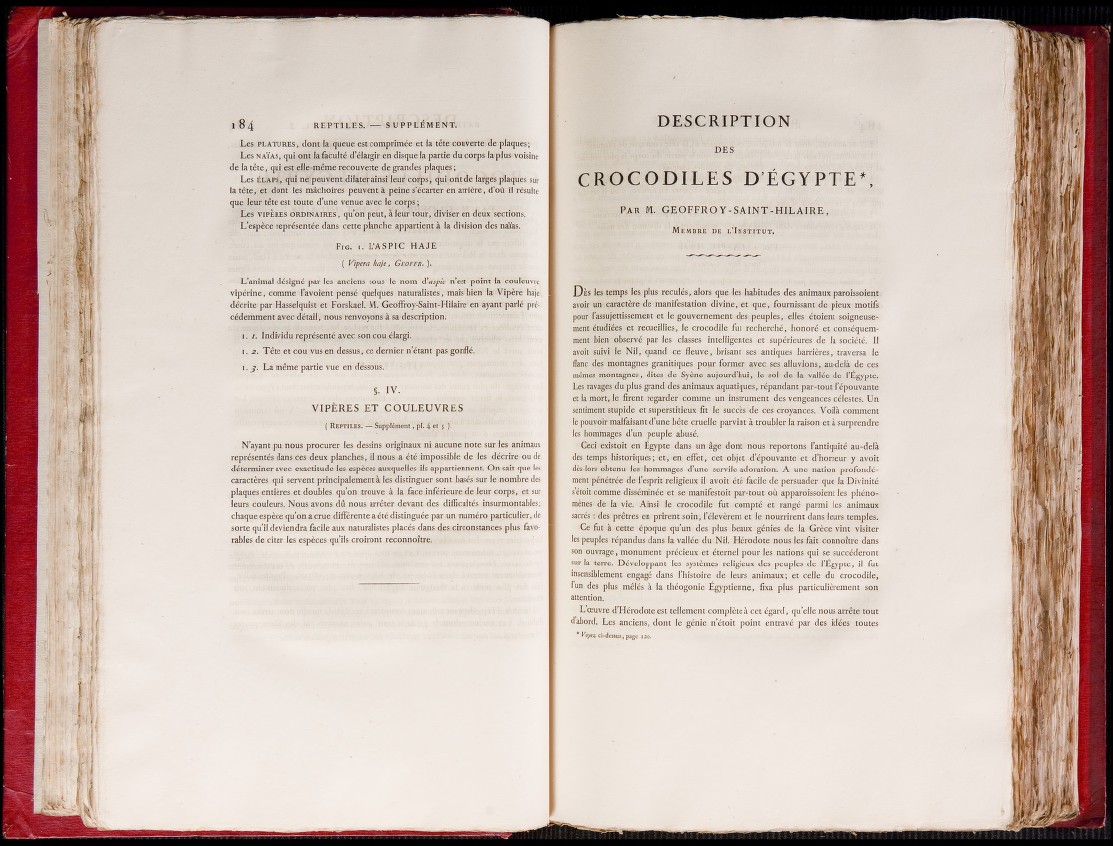
Les p l a t u r e s , dont la queue est comprimée et la tête couverte de plaques;
Les n a ï a s , qui ont la faculté d’élargir en disque la partie du corps la plus voisine
de la tête, qui est elle-même recouverte de grandes plaques ;
Les é l a p s , qui ne peuvent dilater ainsi leur corps, qui ont de larges plaques sur
la tête, et dont les mâchoires peuvent à peine s’écarter en arrière, d’où il résulte
que leur tête est toute d’une venue avec le corps ;
Les v i p è r e s o r d i n a i r e s , qu’on peut, à leur tour, diviser en deux sections,
L ’espèce représentée dans cette planche appartient à la division des naïas.
Fig. i. L’A S P IC HAJE
( Vipera h a je , G e o f f r . ).
L ’animal désigné par les anciens sous le nom A’aspic n’est point la couleuvre
vipérine, comme l’avoient pensé quelques naturalistes, mais bien la Vipère haje
décrite par Hasselquist et Forskael. M. Geoff'roy-Saint-Hilaire en ayant parlé précédemment
avec détail, nous renvoyons à sa description.
i . /. Individu représenté avec son cou élargi.
i. 2. Tête et cou vus en dessus, ce dernier n’étant pas gonflé.
i . La même partie vue en dessous.
§. IV.
V IP ÈR E S E T C O U L E U V R E S
( R e p t i l e s . — ■ Supplément, pl. 4 et $ ).
N ayant pu nous procurer les dessins originaux ni aucune note sur les animaux
représentés dans ces deux planches, il nous a été impossible de les décrire ou de
déterminer avec exactitude les espèces auxquelles ils appartiennent. On sait que les
caractères qui servent principalement à les distinguer sont basés sur le nombre des
plaques entières et doubles qu’on trouve à la face inférieure de leur corps, et sur
leurs couleurs. Nous avons dû nous arrêter devant des difficultés insurmontables;
chaque espèce qu’on a crue différente a été distinguée par un numéro particulier, de
sorte qu’il deviendra facile aux naturalistes placés dans des circonstances plus favorables
de citer les espèces qu’ils croiront reconnoitre.
DES
C R O CO D I L E S D ÉGYPTE*,
P A R m. g e o f f r o y - s a i n t - h i l a i r e ,
M e m b r e d e l ’ In s t i t u t .
D ès les temps les plus reculés, alors que les habitudes des animaux paroissoient
avoir un caractère de manifestation divine, et que, fournissant de pieux motifs
pour l’assujettissement et le gouvernement des peuples, elles étoient soigneusement
étudiées et recueillies, le crocodile fut recherché, honoré et conséquem-
ment bien observé par les classes intelligentes et supérieures de la société. Il
avoit suivi le Nil, quand ce fleuve, brisant ses antiques barrières, traversa le
flanc des montagnes granitiques pour former avec ses alluvions, au-delà de ces
mêmes montagnes, dites de Syène aujourd’hui, le sol de la vallée de l’Égypte.
Les ravages du plus grand des animaux aquatiques, répandant par-tout l’épouvante
et la mort, le firent regarder comme un instrument des vengeances célestes. Un
sentiment stupide et superstitieux fit le succès de ces croyances. Voilà comment
le pouvoir malfaisant d’une bête cruelle parvint à troubler la raison et à surprendre
les hominages d’un peuple abusé.
Ceci existoit en Égypte dans un âge dont nous reportons l’antiquité au-delà
des temps historiques; et, en effet, cet objet d’épouvante et d’horreur y avoit
dès-lors obtenu les hommages d’une servile adoration. A une nation profondément
pénétrée de l’esprit religieux il avoit été facile de persuader que la Divinité
s étoit comme disséminée et se manifestoit par-tout où apparoissoient les phénomènes
de la vie. Ainsi le crocodile fut compté et rangé parmi les animaux
sacrés : des prêtres en prirent soin, l’élevèrent et le nourrirent dans leurs temples.
Ce fut à cette époque qu’un des plus beaux génies de la Grèce vint visiter
les peuples répandus dans la vallée du Nil. Hérodote nous les fait connoître dans
son ouvrage, monument précieux et éternel pour les nations qui se succéderont
sur la terre. Développant les systèmes religieux des peuples de l’Égypte, il fut
insensiblement engagé dans l’histoire de leurs animaux; et celle du crocodile,
lun des plus mêlés à la théogonie Égyptienne, fixa plus particulièrement son
attention.
L oeuvre d’Hérodote est tellement complète à cet égard, qu’elle nous arrête tout
dabord. Les anciens, dont le génie n’étoit point entravé par des idées toutes
* Voyez ci-dessus, page 120.