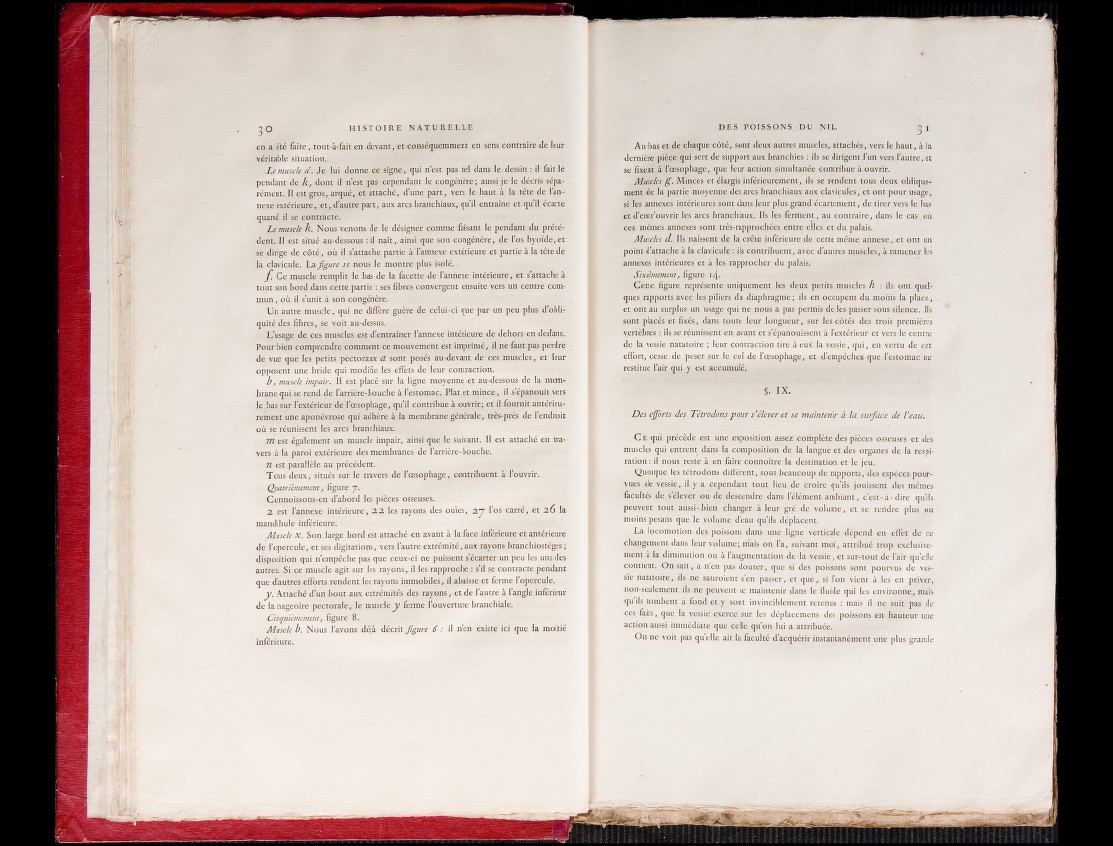
en a été faite, tout-à-fait en devant, et conséquemment en sens contraire de leur
véritable situation.
Le muscle a'. Je lui donne ce signe, qui n’est pas tel dans le dessin : ¡1 fait le
pendant de k , dont il n’est pas cependant le congénère ; aussi je le décris séparément.
Il est gros, arqué, et attaché, d’une part, vers le haut à la tête de l'annexe
extérieure, et, d’autre part, aux arcs branchiaux, qu’il entraîne et qu’il écarte
quand il se contracte.
Le muscle k . Nous venons de le désigner comme Élisant le pendant du précédent.
Il est situé au-dessous : il naît, ainsi que son congénère, de l’os hyoïde, et
se dirige de cô té , où il s’attache partie à l’annexe extérieure et partie à la tête de
la clavicule. \ jl figure // nous le montre plus isolé. -
f . C e muscle remplit le bas de la facette de l’annexe intérieure, et s’attache à
tout son bord dans cette partie : ses fibres convergent ensuite vers un centre commun
, où il s’unit à son congénère.
Un autre muscle, qui ne diffère guère de celui-ci que par un peu plus d’obliquité
des fibres, se voit au-dessus.
L ’usage de ces muscles est d’entraîner l’annexe intérieure de dehors en dedans.
Pour bien comprendre comment ce mouvement est imprimé, il ne faut pas perdre
de vue que les petits pectoraux Q. sont posés au-devant de ces muscles , et leur
opposent une bride qui modifie les effets de leur contraction.
b , muscle impair. II est placé sur la ligne moyenne et au-dessous de la membrane
qui se rend de l’arrière-bouche à l’estomac. Plat et mince, il s’épanouit vers
le bas sur l’extérieur de l’oesophage, qu’il contribue à ouvrir; et il fournit antérieurement
une aponévrose qui adhère à la membrane générale, très-près de 1 endroit
où se réunissent les arcs branchiaux.
m est également un muscle impair, ainsi que le suivant. Il est attaché en travers
à la paroi extérieure des membranes de l’arrière-bouche.
n est parallèle au précédent.
Tous deux, situés sur le travers de l’oesophage, contribuent à l’ouvrir.
Quatrièmement, figure 7.
Connoissons-en d’abord les pièces osseuses.
2 est l’annexe intérieure, 2 2 les rayons des ouïes, 2 y* 1 os carré, et 2 6 la
mandibule inférieure.
Muscle x . Son large bord est attaché en avant à la face inférieure et antérieure
de l’opercule, et ses digitations, vers l’autre extrémité, aux rayons branchiostéges;
disposition qui n’empêche pas que ceux-ci ne puissent s’écarter un peu les uns des
autres. Si ce muscle agit sur les rayons, il les rapproche ; s’il se contracte pendant
que d’autres efforts rendent les rayons immobiles, il abaisse et ferme l’opercule.
y. Attaché d’un bout aux extrémités des rayons, et de l’autre à l’angle inférieur
de la nageoire pectorale, le muscle y ferme l’ouverture branchiale.
Cinquièmement, figure 8.
Muscle b. Nous l’avons déjà décrit figure C : il n’en existe ici que la moitié
inférieure.
Au bas et de chaque côté, sont deux autres muscles, attachés, vers le haut, à la
dernière pièce qui sert de support aux branchies : ils se dirigent l’un vers l’autre, et
se fixent à l’oesophage, que leur action simultanée contribue à ouvrir.
Muscles fi. Minces et élargis inférieurement, ils se rendent tous deux obliquement
de la partie moyenne des arcs branchiaux aux clavicules, et ont pour usage,
si les annexes intérieures sont dans leur plus grand écartement, de tirer vers le bas
et d’entr’ouvrir les arcs branchiaux. Ils les ferment, au contraire, dans le cas où
ces mêmes annexes sont très-rapprochées entre elles et du palais.
Muscles d. Ils naissent de la crête inférieure de cette même annexe, et ont un
point d’attache à la clavicule : ils contribuent, avec d’autres muscles, à ramener les
annexes intérieures et à les rapprocher du palais.
Sixièmement, figure \l\.
Cette figure représente uniquement les deux petits muscles h : ils ont quelques
rapports avec les piliers du diaphragme ; ils en occupent du moins la place,
et ont au surplus un usage qui ne nous a pas permis de les passer sous silence. Ils
sont placés et fixés, dans toute leur longueur, sur les côtés des trois premières
vertèbres : ils se réunissent en avant et s’épanouissent à l’extérieur et vers le centre
de la vessie natatoire ; leur contraction tire à eux la vessie, qui, en vertu de cet
effort, cesse de peser sur le col de l’oesophage, et d’empêches que l’estomac ne
restitue l’air qui y est accumulé.
§. IX .
Des efforts des Tétrodons pour s ’élever et se maintenir à la surface de l ’eau.
C e qui précède est une exposition assez complète des pièces osseuses et des
muscles qui entrent dans la composition de la langue et des organes de la respiration
: il nous reste à en faire connoître la destination et le jeu.
Quoique les tétrodons diffèrent, sous beaucoup de rapports, des espèces pourvues
de vessie, il y a cependant tout lieu de croire qu’ils jouissent des mêmes
facultés de s’élever ou de descendre dans l’élément ambiant, c’est-à-dire qu’ils
peuvent tout aussi-bien changer à leur gré de volume, et se rendre plus ou
moins pesans que le volume d’eau qu’ils déplacent.
La locomotion des poissons dans une ligne verticale dépend en effet de ce
changement dans leur volume; mais on l’a, suivant moi, attribué trop exclusivement
à la diminution ou à l’augmentation de la vessie, et sur-tout de l’air qu’elle
contient. On sait, à n’en pas douter, que si des poissons sont pourvus de vessie
natatoire, ils ne sauraient s’en passer, et que, si l’on vient à les en priver,
non-seulement ils ne peuvent se maintenir dans le fluide qui les environne, mais
qu ils tombent à fond et y sont invinciblement retenus : mais il ne suit pas de
ces faits, que la vessie exerce sur les déplacemens des poissons en hauteur une
action aussi immédiate que celle qu’on lui a attribuée.
On ne voit pas qu’elle ait la faculté d’acquérir instantanément une plus grande