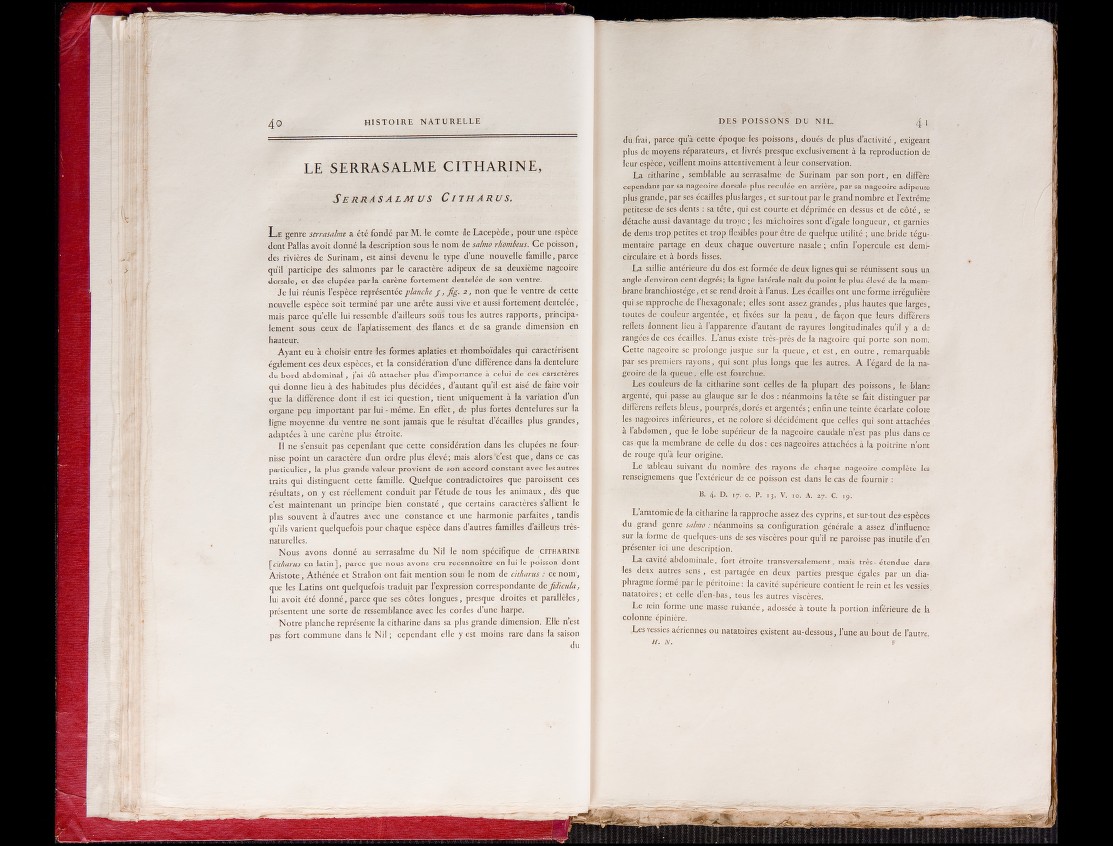
LE SERRASALME CITHARINE ,
S e r r a s a l m u s C i t h a r u s .
L e genre serrasalmt a été fondé par M. le comte de Lacepède \ pour une espèce
dont Pallas avoit donné la description sous le nom de salmo rhombens. C e poisson,
des rivières de Surinam, est ainsi devenu le type d’une nouvelle famille, parce
qu’il participe des salmones par le caractère adipeux de sa deuxième nageoire
dorsale, et des dupées par la carène fortement dentelée de son ventre.
Je lui réunis l’espèce représentée planche f , Jig. 2 , non que le ventre de cette
nouvelle espèce soit terminé par une arête aussi vive et aussi fortement dentelée,
mais parce qu’elle lui ressemble d’ailleurs sous tous les autres rapports, principalement
sous ceux de l’aplatissement des flancs et de sa grande dimension en
hauteur.
Ayant eu à choisir entre les formes aplaties et rhomboïdales qui caractérisent
également ces deux espèces, et la considération dune différence dans la dentelure
du bord abdominal, j’ai dû attacher plus d^importance à celui de ces caractères
qui donne lieu à des habitudes plus décidées, d’autant qu’il est aisé de faire voir
que la différence dont il est ici question, tient uniquement à la variation d’un
organe peu important par lui - même. En effet, de plus fortes dentelures sur la
ligne moyenne du ventre ne sont jamais que le résultat d’écailles plus grandes,
adaptées à une carène plus étroite.
Il ne s’ensuit pas cependant que cette considération dans les dupées ne fournisse
point un caractère d’un ordre plus élevé; mais alors “c’est que, dans ce cas
particulier, la plus grande valeur provient de son accord constant avec les autres
traits qui distinguent cette famille. Quelque contradictoires que paroissent ces
résultats, on y est réellement conduit par l’étude de tous les animaux, dès que
c’est maintenant un principe bien constaté , que certains caractères s’allient le
plus souvent à d’autres avec une constance et une harmonie parfaites, tandis
qu’ils varient quelquefois pour chaque espèce dans d’autres familles d’ailleurs très-
naturelles.
Nous avons donné au serrasalme du Nil le nom spécifique de citharine
[citharus en latin], parce que nous avons cru reconnoître en lui le poisson dont
Aristote, Athénée et Strabon ont fait mention sous le nom de citharus : ce nom',
que les Latins ont quelquefois traduit par l’expression correspondante de fidicula,
lui avoit été donné, parce que ses côtes longues, presque droites et parallèles,
présentent une sorte de ressemblance avec les cordes d’une harpe.
Notre planche représente la citharine dans sa plus grande dimension. Elle n’est
pas fort commune dans le Ni l ; cependant elle y est moins rare dans la saison
du fia i, parce qu’à cette époque les poissons, doués de plus d’activité , exigeant
plus de moyens réparateurs, et livrés presque exclusivement à la reproduction de
leur espèce, veillent moins attentivement à leur conservation.
La citharine, semblable au serrasalme de Surinam par son p ort, en diffère
cependant par sa nageoire dorsale plus reculée en arrière, par sa nageoire adipeuse
plus grande, par ses écailles plus larges, et sur tout par le grand nombre et l’extrême
petitesse de ses dents : sa tête, qui est courte et déprimée en dessus et de cô té, se
détache aussi davantage du tronc ; les mâchoires sont d’égale longueur, et garnies
de dents trop petites et trop flexibles pour être de quelque utilité ; une bride tégu-
mentaire partage en deux chaque ouverture nasale ; enfin l’opercule est demi-
circulaire et à bords lisses.
La saillie antérieure du dos est formée de deux lignes qui se réunissent sous un
angle d’environ cent degrés; la ligne latérale naît du point le plus élevé de la membrane
branchiostége, et se rend droit à l’anus. Les écailles ont une forme irrégulière
qui se rapproche de l’hexagonale ; elles sont assez grandes, plus hautes que larges,
toutes de couleur argentée, et fixées sur la peau , de façon que leurs différens
reflets donnent lieu à l’apparence d’autant de rayures longitudinales qu’il y a de
rangées de ces écaillés. L anus existe très-près de la nageoire qui porte son nom.
Cette nageoire se prolonge jusque sur la queue, et e s t , en outre, remarquable
par ses premiers rayons, qui sont plus longs que les autres. A l’égard de la nageoire
de la queue, elle est fourchue.
Les couleurs de la citharine sont celles de la plupart des poissons, le blanc
argenté, qui passe au glauque sur le dos : néanmoins la tête se fait distinguer par
différens reflets bleus, pourprés, dorés et argentés ; enfin une teinte écarlate colore
les nageoires inférieures, et ne colore si décidément que celles qui sont attachées
à l’abdomen, que le lobe supérieur de la nageoire caudale n’est pas plus dans ce
cas que la membrane de celle du dos : ces nageoires attachées à la poitrine n’ont
de rouge qua leur origine.
Le tableau suivant du nombre des rayons de chaque nageoire complète les
renseignemens que l’extérieur de ce poisson est dans le cas de fournir :
B. 4 * E). 17. o. P. 13. V. 10. A. 2,7. C. 19.
Lanatomie de la citharine la rapproche assez des cyprins, et sur tout des-espèces
du grand genre salmo : néanmoins sa configuration générale a assez d’influence
sur la forme de quelques-uns de ses viscères pour qu’il ne paroisse pas inutile d’en
présenter ici une description.
La cavité abdominale, fort étroite transversalement , mais très- étendue dans
les deux autres sens, est partagée en deux parties presque égales par un diaphragme
forme par le péritoine : la cavité supérieure contient le rein et les vessies
natatoires ; et celle d en-bas, tous les autres viscères.
Le rein forme une masse rubanée, adossée à toute la portion inférieure de la
colonne épinière.
.Les vessies aériennes ou natatoires existent au-dessous, l’une au bout de l’autre.