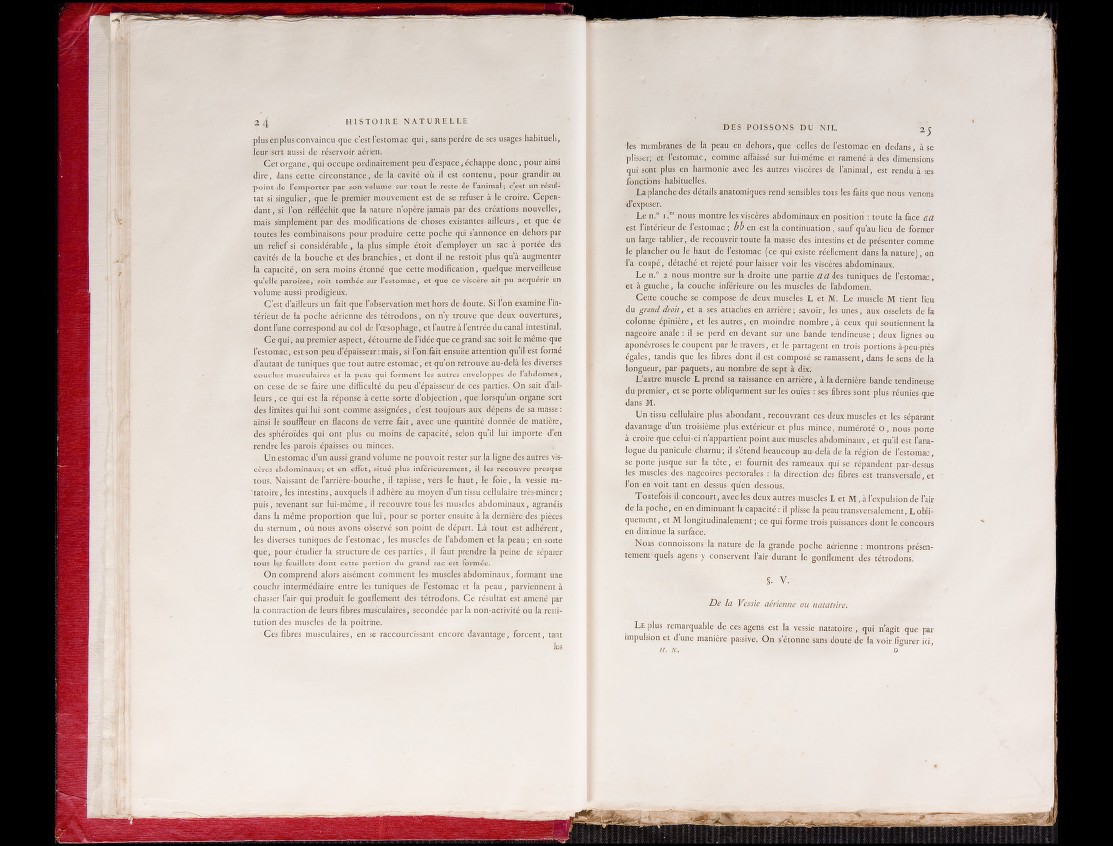
plus en plus convaincu que c’est l’estomac qui, sans perdre de ses usages habituels,
leur sert aussi de réservoir aérien.
Ce t organe, qui occupe ordinairement peu d’espace, échappe donc, pour ainsi
dire, dans cette circonstance, de la cavité où il est contenu, pour grandir au
point de l’emporter par son volume sur tout le reste de l’animal ; c’est un résultat
si singulier, que le premier mouvement est de se refuser à le croire. Cependant,
si l’on réfléchit que la nature n’opère jamais par des créations nouvelles,
mais simplement par des modifications de choses existantes ailleurs, et que de
toutes les combinaisons pour produire cette poche qui s’annonce en dehors par
un relief si considérable , la plus simple étoit d’employer un sac à portée des
cavités de la bouche et des branchies, et dont il ne restoit plus qu’à augmenter
la capacité, on sera moins étonné que cette modification, quelque merveilleusé
qu’elle paroisse, soit tombée sur l’estomac, et que ce viscère ait pu acquérir un
volume aussi prodigieux.
C ’est d’ailleurs un fait que l’observation met hors de doute. Si l’on examine l’intérieur
de la poche aérienne des tétrodons, on n’y trouve que deux ouvertures,
dont l’une correspond au col de l’oesophage, et l’autre à l’entrée du canal intestinal.
C e qui, au premier aspect, détourne de l’idée que ce grand sac soit le même que
l’estomac, est son peu d’épaisseur : mais, si l’on fait ensuite attention qu’il est formé
d’autant de tuniques que tout autre estomac, et qu’on retrouve au-delà les diverses
couches musculaires et la peau qui forment les autres enveloppes de l’abdomen,
on cesse de se faire une difficulté du peu d’épaisseur de ces parties. On sait d ailleurs
, ce qui est la réponse à cette sorte d’objection, que lorsqu’un organe sort
des limites qui lui sont comme assignées, c’est toujours aux dépens de sa masse :
ainsi le souffleur en flacons de verre fait, avec une quantité donnée de matière,
des sphéroïdes qui ont plus ou moins de capacité, selon qu’il lui importe d’en
rendre les parois épaisses ou minces.
Un estomac d’un aussi grand volume ne pouvoit rester sur la ligne des autres viscères
abdominaux; et en effet, situé plus inférieùrcment, il les recouvre presque
tous. Naissant de l’arrière-bouche, il tapisse, vers le haut, le foie, la vessie natatoire,
les intestins, auxquels il adhère au moyen d’un tissu cellulaire très-mince;
puis, revenant sur lui-même, il recouvre tous les muscles abdominaux, agrandis
dans la même proportion que lui, pour se porter ensuite à la dernière des pièces
du sternum, où nous avons observé son point de départ. Là tout est adhérent,
les diverses tuniques de l’estomac, les muscles de l’abdomen et la peau ; en sorte
que, pour étudier la structure de ces parties, il ntut prendre la peine de séparer
tous le,s feuillets dont cette portion du grand sac est formée.
On comprend alors aisément comment les muscles abdominaux, formant une
couche intermédiaire entre les tuniques de l’estomac et la peau, parviennent à
chasser l’air qui produit le gonflement des tétrodons. C e résultat est amené par
la contraction de leurs fibres musculaires, secondée par la non-activité ou la restitution
des muscles de la poitrine.
Ces fibres musculaires, en se raccourcissant encore davantage, forcent, tant
les
les membranes de la peau en dehors, que celles de l’estomac en dedans, à se
plisser; et l’estomac, comme affaissé sur lui-même et ramené à des dimensions
qui sont plus en harmonie avec les autres viscères de l’animal, est rendu à ses
fonctions habituelles.
La planche des détails anatomiques rend sensibles tous les faits que nous venons
d’exposer.
Le n.° i n o u s montre lés viscères abdominaux en position : toute la face a a.
est l’intérieur de l’estomac ; ¿B en est la continuation, sauf qu’au lieu de former
un large tablier, de recouvrir toute la masse des intestins et de présenter comme
le plancher ou le haut de l’estomac (ce qui existe réellement dans la nature), on
l’a coupé, détaché et rejeté pour laisser voir les viscères abdominaux.
Le n.° 2 nous montre sur la droite une partie a a des tuniques de l’estomac,
et à gauche, la couche inférieure ou les muscles de l’abdomen.
Cette couche se compose de deux muscles L et M. Le muscle M tient lieu
du grand droit, et a ses attaches en arrière; savoir, les unes, aux osselets de la
colonne épinière, et les autres, en moindre nombre, à ceux qui soutiennent la
nageoire anale : il. se perd en devant sur une bande tendineuse ; deux lignes ou
aponévroses le coupent par le travers, et le partagent en trois portions à-peu-près
égales, tandis que les fibres dont il est composé se ramassent, dans le sens de la
longueur, par paquets, au nombre de sept à dix;
L ’autre muscle L prend sa naissance en arrière, à la dernière bande tendineuse
du premier , et se porte obliquement sur les ouïes ; ses fibres sont plus réunies que
dans M.
Un tissu cellulaire plus abondant, recouvrant ces deux muscles et les séparant
davantage d’un troisième plus extérieur et plus mince, numéroté O, nous porte
à croire que celui-ci n appartient point aux muscles abdominaux, et qu’il est l’analogue
du panicule charnu ; il s’étend beaucoup au-delà de la région de l’estomac,
se porte jusque sur la tête, et fournit des rameaux qui se répandent par-dessus
les muscles des nageoires pectorales : la direction des fibres est transversale, et
l’on en voit tant en dessus qu’en dessous.
Toutefois il concourt, avec les deux autres muscles L et JVT, à l’expulsion de l’air
de la poche, en en diminuant la capacité : il plisse la peau transversalement, L obliquement,
et M longitudinalement ; ce qui forme trois puissances dont le concours
en diminue la surface.
Nous connoissons la nature de la grande poche aérienne : montrons présentement
quels agens y conservent 1 air durant le gonflement des tétrodons.
§- v.
D e la Vessie aérienne ou natatoire.
Le plus remarquable de ces agens est la vessie natatoire , qui n’agit que par
impulsion et dune manière passive. On s’étonne sans douté de la voir figurer ici.
H. N . D