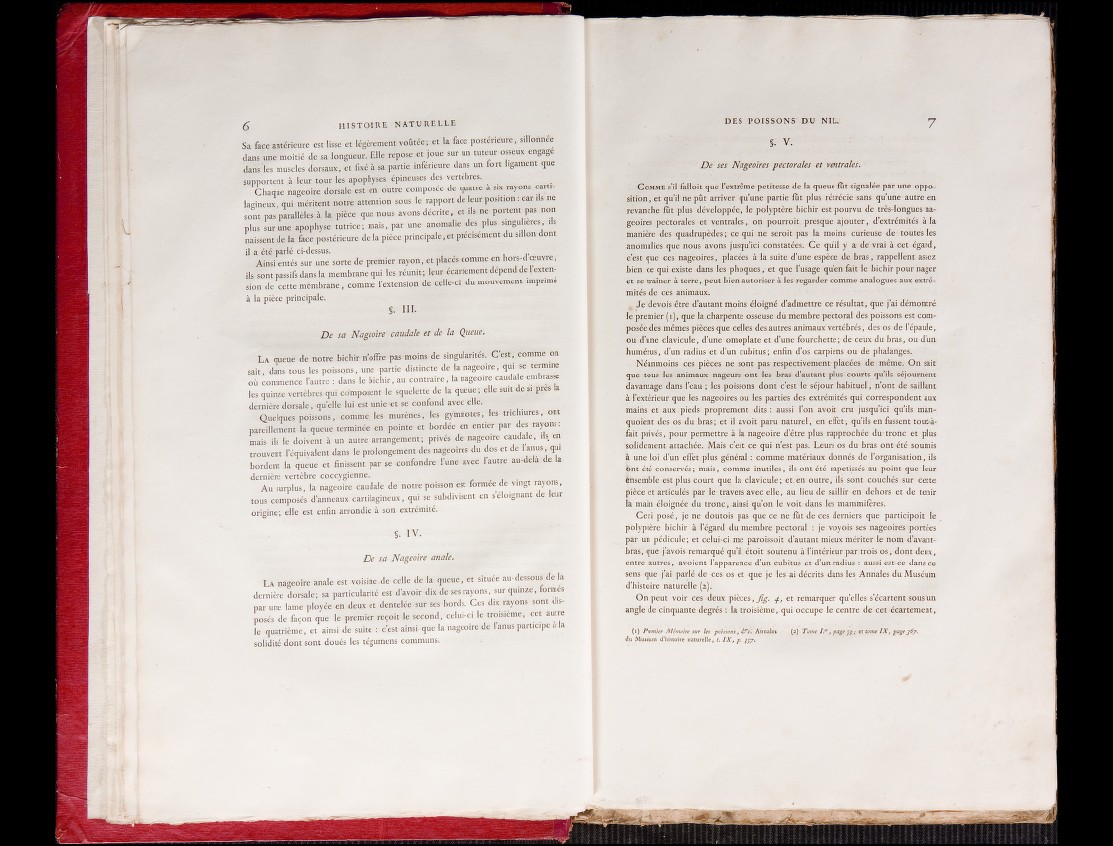
h i s t o i r e n a t u r e l l e D E S P O I S S O N S D U N I L . 7
Sa face antérieure est lisse et légèrement voûtée; et la face postérieure, sillonnée
dans une moitié de sa longueur. Elle repose et joue sur un tuteur osseux engage
dans les muscles dorsaux, et fixé à sa partie inférieure dans un fort ligament que
supportent à leur tour les apophyses épineuses des vertèbres. I
Chaque nageoire dorsale est en outre composée de quatre a six rayons cartilagineux,
qui méritent notre attention sous le rapport de leur position : car ils ne
sont pas parallèles à la. pièce que nous avons décrite, et ils ne portent pas non
plus sur une apophyse tutrice; mais, par une anomalie des plus singulières ils
naissent de la fkce postérieure de la pièce principale, et précisément du sillon dont
il a été parlé ci-dessus. ■>
Ainsi entés sur une sorte de premier rayon, et placés comme en hors-d oeuvre,
ils sont passifs dans la membrane qui les réunit; lçur écartement dépend de 1 extension
de cette membrane, comme l’extension de celle-ci du mouvement imprime
à la pièce principale.
§. III.
D e sa Nageoire caudale et de la Queue.
L a queue de notre bichir n'offre pas moins de singularités. C ’est, comme on
sait, dans tous les poissons, une partie distincte de la nageoire, qui se termine
où commence l’autre : dans le bichir, au contraire, la nageoire caudale embrasse
les quinze vertèbres qui composent le squelette de la queue ; elle suit de si près la
dernière dorsale, qu’elle lui est unie -et se confond avec elle.
Quelques poissons,, comme, les murènes, les gymnotes, les trichiures, ont
pareillement la queue terminée en pointe et bordée en entier par des rayons:
mais ils le doivent à un autre arrangement; privés de nageoire caudale, ils en
trouvent l’équivalent dans le prolongement des nageoires du dos et de 1 anus qui
bordent la queue et finissent par se confondre l’une avec l’autre au-dela de la
dernière vertèbre coccygienne.
Au surplus, la nageoire caudale de notre poisson est formée de vingt rayons,
tous composés d’anneaux cartilagineux, qui se subdivisent en s’éloignant de leur
origine ; elle est enfin arrondie à son extrémité.
D e sa Nageoire anale.
L a nageoire anale est voisine.de celle de la queue, et s i t u é e au-dessous de la
dernière dorsale; sa particularité est d’avoir dix de ses rayons, sur quinze, formes
par une lame pioyée en deux et dentelée sur ses bords. Ces dix rayons sont disposés
de façon que le premier reçoit le second, celui-ci le troisième, cet autre
le quatrième, et ainsi de suite : c’est ainsi que la nageoire de l’anus partic.pe a la
solidité dont sont doués les tégumens communs.
§. v.
D e ses Nageoires pectorales et ventrales.
C om m e s’il falloir que l’extrême petitesse de la queue fut signalée par une opposition
, et qu’il ne pût arriver qu’une partie fut plus rétrécie sans qu’une autre en
revanche fût plus développée, le polyptère bichir est pourvu de très-longües nageoires
pectorales et ventrales, on pourroit presque ajouter, d’extrémités à la
manière des quadrupèdes; ce qui ne seroit pas la moins curieuse de toutes les
anomalies que nous avons jusqu’ici constatées. C e qu’il y a de vrai à cet égard,
e’est que ces nageoires, placées à la suite d’une espèce de bras, rappellent assez
bien ce qui existe dans les phoques, et que l’usage qu’en fait le bichir pour nager
et se tramer à terre, peut bien autoriser à les regarder comme analogues aux extrémités
de ces animaux.
„ Je devois être d’autant moins éloigné d’admettre ce résultat, que j’ai démontré
le premier (i), que la charpente osseuse du membre pectoral des poissons est composée
des mêmes pièces que celles des autres animaux vertébrés, des os de l’épaule,
ou d’une clavicule, d’une omoplate et d’une fourchette; de ceux du bras, ou d’un
humérus, d’un radius et d’un cubitus; enfin d’os carpiens ou de phalanges.
Néanmoins ces pièces ne sont pas respectivement placées de même. On sait
que tous les animaux nageurs ont les bras d’autant plus courts qu’ils séjournent
davantage dans l’eau ; les poissons dont c’est le séjour habituel, n’ont de saillant
à l’extérieur que les nageoires ou les parties des extrémités qui correspondent aux
mains et aux pieds proprement dits: aussi l’on avoit cru jusqu’ici qu’ils màn-
quoient des os du bras; et il avoit paru naturel, en effet, qu’ils en fussent tout-à-
fait privés, pour permettre à la nageoire d’être plus rapprochée du tronc et plus
solidement attachée. Mais c’est ce qui n’est pas. Leurs os du bras ont été soumis
à une loi d’un effet plus général : comme matériaux donnés de l’organisation, ils
6nt été conservés; mais, comme inutiles, ils ont été rapetissés au point que leur
énsemble est plus court que la clavicule; et. en outre, ils sont couchés sur cette
pièce et articulés par le travers avec elle, au lieu de saillir en dehors et de tenir
la main éloignée du tronc, ainsi qu’on le voit dans les mammifères.
Ceci posé, je ne doutois pas que ce ne fût de ces derniers que participoit le
polyptère bichir à l’égard du membre pectoral : je voyois ses nageoires portées
par un pédicule; et celui-ci me paroissoit d’autant mieux mériter le nom d’avant-
bras, que j’avois remarqué qu’il étoit soutenu à l’intérieur par trois os, dont deux,
entre autres, avoient l’apparence d’un cubitus et d’un radius : aussi est-ce dans ce
sens que j’ai parlé de ces os et que je les ai décrits dans les Annales du Muséum
d’histoire naturelle (2).
On peut voir ces deux pièces, jig . 4 , et remarquer quelles s’écartent sous Un
angle de cinquante degrés : la troisième, qui occupe le centre de cet écartement,
(1) Premier Mémoire sur les poissons, éfc. Annales (2) Tome I . " , page jp ; et tome IX , page36?.
du Muséum d’histoire naturelle, t. I X , p. 357,